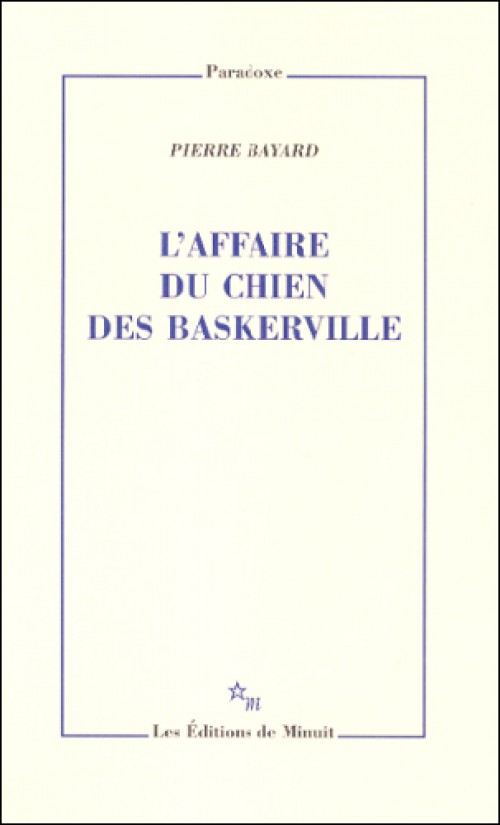
Pierre Bayard
L'Affaire du chien des Baskerville
2008
Collection Paradoxe , 176 p.
ISBN : 9782707320216
14.70 €
* Réédition dans la collection de poche double .
Les personnages littéraires ne sont pas, comme on le croit trop souvent, des êtres de papier, mais des créatures vivantes, qui mènent une existence autonome à l"intérieur des textes et vont jusqu’à commettre des meurtres à l’insu de l’auteur.
Faute de l’avoir compris, Conan Doyle a laissé Sherlock Holmes se tromper dans sa plus célèbre enquête, Le Chien des Baskerville, et accuser à tort un malheureux animal, permettant au véritable assassin d’échapper à la justice. Ce livre rétablit la vérité.
ISBN
PDF : 9782707326317
ePub : 9782707326300
Prix : 7.99 €
En savoir plus
Philippe Lançon, Libération, jeudi 17 janvier 2008
Contre-enquête. Après Agatha Christie et Shakespeare, Conan Doyle rectifié par un « psycho-écrivain ».
«Que pensez-vous de mon hypothèse… Elle tient, non ?» Il guette la réponse avec un sourire étroit : paquet de nerfs tranquille, assez froid. Son hypothèse est que Sir Charles Baskerville n'a pas été victime d"un meurtre, que le chien phosphorescent n’est responsable de rien et que le vrai coupable, dans le roman où Conan Doyle ressuscite Sherlock Holmes, est… «mais vous n’allez pas le dire dans l’article, hein ?» On verra.
L’Affaire du chien des Baskerville est une contre-enquête littéraire. Elle boucle une «trilogie anglaise», ouverte par Qui a tué Roger Ackroyd ?, poursuivie avec Enquête sur Hamlet. A chaque fois, l’idée est qu’un crime écrit peut en cacher un autre et que l’auteur nous dissimule des choses, quand il ne se ment pas à lui-même. Pourquoi Baskerville ? «Après Agatha Christie et Shakespeare, Conan Doyle était une nécessité logique. Holmes est le symbole de l’enquête policière. J’ai relu ses aventures, choisi la plus célèbre, et, heureusement, j’ai tout de suite vu qu’il y avait des trucs qui clochaient.»
A la relecture, c’est vrai : ça flotte du côté de chez Baskerville, c’est aussi pour ça qu’on l’aime ; l’imagination peut gambader dans les brumes de la lande et du récit. Conan Doyle a-t-il voulu se venger d’un détective dont ses lecteurs l’empêchaient de se débarrasser en affaiblissant sa logique ? Ou bien Holmes et les autres ont-ils une vie propre, échappant à leur auteur ? Même s’il se donne du mal, un paranoïaque n’en a aucun à dévoiler les défauts et vérités masquées des chefs-d’œuvre «les mieux bouclés». C’est pourquoi il a toujours raison. Bayard s’amuse à le rappeler.
Chemin faisant, il définit des concepts et des types de lecteurs, les «ségrégationnistes», les «intégrationnistes», ceux qui, confondant personnages de fiction et du monde réel, sont atteints du «complexe de Holmes». La littérature permet à l’analyste de perfectionner des discours délirants «pour voir jusqu’où ils se tiennent». Un jour, dans un hôpital psychiatrique, il a rencontré un patient qui «ne parlait que par l’intermédiaire de personnages de western». Il les parlait d’autant mieux qu’il se prenait pour eux. Quand on lit, c’est à devenir fou, quand on écrit aussi. Et quand on vit, n’en parlons pas.
Absurde. Pierre Bayard est-il un paranoïaque qui se prend pour un érudit ou un érudit qui, face aux œuvres, imagine qu’il est un paranoïaque ? Maigre, pâle, âgé d’une cinquantaine sans âge, tendu entre ses nombreuses bibliothèques, entièrement vêtu de tissu noir lui collant à la peau, d’une acuité sans compassion envers son interlocuteur et d’un respect sans négligence pour sa réputation et ses textes : voici l’homme, universitaire à Vincennes, psychanalyste et essayiste sans peur mais non sans reproche envers toute la littérature qu’il aime et, pour cette raison, rectifie par l’absurde.
Il reçoit chez lui, dans la petite pièce où il écrit. C’est aussi celle où il analyse ses patients. L’ordinateur luit à un petit mètre du divan. Il y a du désordre. Pour arriver au bureau, on remonte un couloir couvert de livres dans lequel traînent des objets appartenant aux enfants. Après les rayons des Agatha Christie, qu’il admire et a entièrement relue avant d’écrire Qui a tué Roger Ackroyd ?, il y a une bibliothèque en idéogrammes de sa femme, franco-japonaise. Ils voyagent régulièrement au Japon. L’extrême gentillesse des gens le surprend, le soulage. Il parle japonais.
Bayard lit un ou deux livres par jour. Quand il enseignait dans des lycées du Nord, deux heures de train lui permettaient d’épuiser un livre à l’aller, un au retour : «Deux heures, c’est le temps qu’il faut pour lire un Simenon.» Les trains le connaissent. Fils d’ouvrier cheminot, possédant une licence de lettres mais ayant raté l’Ecole normale supérieure, son père travaillait à la SNCF. La famille le suit de gare en gare : «Toute mon enfance, dit-il, j’ai entendu le bruit des trains.» Les gares étaient, comme le futur critique, décalées : à l’écart des grandes villes, dans des endroits qui n’existent que par les nœuds ferroviaires qu’on y a mis. Ainsi Bayard a-t-il créé ses propres nœuds, entre fiction et théorie, lisant beaucoup «pour établir un corpus qui n’existait pas».
Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?, publié l’an dernier, débute par ces mots : «Né dans un milieu où on lisait peu, ne goûtant guère cette activité et n’ayant de toute manière pas le temps de m’y consacrer…» On l’a cru, tout est faux. Enfant, il regardait sa sœur écrire, fasciné : «J’ai toujours lu pour écrire, dans l’admiration ou l’envie.» Dans la bibliothèque familiale, il y avait des auteurs catholiques, Daniel-Rops, Bernanos ; ses Œuvres romanesques en «Pléiade» sont encore rangées non loin du divan. En entrant à Normale, dit Bayard, «j’ai réalisé le vœu de mon père.»
Ses ombres sourient légèrement. Ce sont Borges («Je suis content lorsqu’on me dit qu’en me lisant on pense à lui», il n’est pas le seul), Perec, l’Oulipo, et «le maître de tout le monde, Sterne». Et Frédéric Berthet, l’ami, écrivain mort en 2003, rencontré à l’Ecole normale supérieure en 1974. Pendant des années, ils passèrent leurs soirées ensemble. Berthet lui fit découvrir la littérature américaine, lui donna l’idée de certains livres : «Il était habité par la littérature. C’est la personne dont j’aurais besoin pour lire mes livres. C’est une perte pour moi irréparable.» On travaille sous l’œil de ses disparus.
«Mérou». Demain est écrit est dédié à sa mémoire. Bayard y étudie comment les écrivains annoncent leurs morts dans leurs œuvres. Le travail de Berthet annonçait la sienne, solitaire, alcoolique, chez lui un soir de Noël. Bayard : «A Normale, il y avait les autres, et il y avait lui, le plus brillant. Quand on allait à la cantine, lui allait déjeuner avec Barthes. Il avait vingt ans, un humour fou. Il montrait que la littérature avait une capacité unique à décrypter le monde.» Berthet, Journal de Trêve, livre posthume : «Le dialogue est à peu près aussi impossible entre un écrivain et un universitaire qu’entre un mérou et le directeur d’un centre océanographique.» Bayard essaie de donner forme à ce dialogue.
L’idée qui guide son travail est donc simple : abattre la barrière entre fiction et théorie, en faire une zone trouble, indéterminée, un centaure littéraire à tête de Sainte-Beuve et à corps de Proust, puis l’imaginer jusque dans ses moindres détails : «Ce qui m’intéresse dans la littérature, c’est son indécidabilité. Elle et la psychanalyse sont alliées dans les espaces complexes qu’elles ouvrent contre un certain type de discours politique, aujourd’hui porté à la caricature.»
Bayard écrit des livres de passe-muraille. Mieux vaut les lire au second degré, même si, parfois, c’est le premier qui les fait vendre. Mais est-on responsable de la lourdeur - ou de l’angoisse – de ses lecteurs ? Pierre Bayard aimerait ne pas l’être tout en les accueillant. Travailleur, distancié, d’une ambiguïté soignée, il veut tout : l’assise de la théorie, le plaisir du récit, la reconnaissance de l’universitaire et les ventes du page turner. Il a inventé un ton et une perspective qui correspondent à ses discours, ses plaisirs, son désir.
Face aux textes qu’il aime, il pousse le théoricien qui l’habite jusqu’à la «folie interprétative», comme pour mieux en vivre et s’en détacher. Ce théoricien se demande quelle théorie aurait inventé Freud s’il avait lu Maupassant, qui a vraiment tué le père de Hamlet, Roger Ackroyd ou, aujourd’hui, Sir Charles Baskerville. Il se demande aussi de quelle façon améliorer un chef-d’œuvre, délivrer Proust de ses digressions, parler des livres qu’on n’a pas lus ou qu’on a oubliés. Il y en a qui croient tout ce qu’ils lisent : «Des universitaires proustiens m’ont écrit pour me rappeler que les digressions étaient essentielles dans l’œuvre de Proust, comme si je l’ignorais.» Les malentendus de lecture créent parfois des vocations. Ils sont au cœur de son Enquête sur Hamlet, mais aussi de la réception de son avant-dernier ouvrage, Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ?.
Ce livre a souvent été lu ou présenté comme une sorte de guide intelligent, dans le genre best-seller de vie bonne, cherchant à décomplexer les non-lecteurs, ou ceux qui s’ennuient lorsqu’ils essaient de lire des œuvres trop complexes pour l’idée qu’ils se font d’eux-mêmes. Le livre fut un succès en France, à l’étranger. C’est également le seul texte français retenu par le New York Times dans sa liste – les listes sont faites pour flatter ceux qui les font – des 100 «livres notables» de l’année 2007.
Des lecteurs ont remercié Bayard de les avoir soulagés en les autorisant à ne pas lire. A l’époque, on l’a parfois entendu encourager cette lecture : elle nourrissait son succès. Son discours a changé : «Le nombre de gens qui m’ont fait des confidences sur leur souffrance en classe, c’est effarant ! Si mon livre a pu réparer des blessures narcissiques, c’est bien, mais moi je ne l’ai pas écrit pour ça ! Jamais je n’ai conseillé de ne pas lire. Comment l’aurais-je pu ? Je ne fais que ça, et ce livre m’a d’ailleurs demandé un nombre de lectures considérable.»
Pour l’écrire, Bayard a dû chercher des personnages se retrouvant dans des situations où ils doivent justement parler de livres qu’ils n’ont pas lus. Il lit ou relit Philip Roth, persuadé qu’il trouvera quelque chose – en vain : «Rechercher des exemples, c’est difficile. Non seulement il faut les trouver, mais il faut qu’ils soient rentables, humoristiquement et théoriquement.» L’humour est une politesse due au désespoir dont la lecture nous délivre. La théorie est le corps du récit. Bayard la répartit en quatre champs : «Amélioration des chefs-d’œuvre, critique anachronique, critique policière, littérature et psychanalyse.» Ses premiers livres ne trouvaient pas encore le ton qui a fait son succès, et qui est une conséquence étudiée de sa vie.
«Messes».Althusser et Derrida exercent à Normale quand Bayard y entre. Les cafés du quartier lui permettent surtout de rencontrer les psychanalystes de l’Ecole de la cause freudienne (à laquelle il n’a jamais appartenu). Il suit les séminaires de Dolto, de Lacan, «qui ne parlait presque plus, c’étaient malheureusement des messes». Pendant dix ans, il est psychanalysé par Serge Leclaire, le premier des lacaniens. Il suit des études de psychologie, sans arrêter la littérature. Une thèse, sous la direction du critique Jean-Pierre Richard, porte sur les œuvres autobiographiques de Rousseau ; une autre est consacrée à la critique littéraire freudienne. Il publie ensuite des livres sur Balzac, sur Stendhal, qu’il a rayés de sa bibliographie. Le premier ouvrage revendiqué analyse Romain Gary, «parce qu’il est très drôle».
Aujourd’hui, Bayard se sent plus proche de Jean-Philippe Toussaint, d’Olivia Rosenthal ou d’Eric Chevillard, «mon grand homme», que des théoriciens des sciences humaines : «Inventer un univers où je me sente complètement à l’aise m’a pris du temps. Mais, une fois installé, ce fut un très grand bonheur.» Chaque homme choisit son fou : il a trouvé les siens.
A la sortie, comme il a senti d’entrée une réticence devant son hypothèse concernant l’affaire de Baskerville, il y revient : «Réfléchissez, et vous verrez que ça tient, le coupable c’est bien…» Finalement, on ne l’écrira pas, et Pierre Bayard, qui a mauvaise mémoire, n’oublie jamais rien.
Jacques Dubois, Les Inrockuptibles, 22 janvier 2008
Pierre Bayard poursuit sa lecture iconoclaste des œuvres et revisite Le Chien des Baskerville : Sherlock Holmes se serait-il planté ?
Pierre Bayard, il y a deux ans, nous conseillait sans vergogne de parler des livres que nous n’avions pas lus. Le voilà qui, avec le même aplomb, nous démontre qu’on ne lit jamais les fictions d’assez près. C’est qu’il cultive un génie du paradoxe, qui va de pair avec l’humour ravageur qu’il mêle à un sérieux implacable dans la démonstration.
Bayard s’en prend aujourd’hui à un monument littéraire et le soumet impitoyablement à ce qu’il nomme sa « critique policière ». En l’occurrence, il s’agit de démonter pièce par pièce Le Chien des Baskerville, chef-d’œuvre de Conan Doyle, et de montrer comment l’immodeste Holmes s’est planté d’un bout à l’autre de son enquête. Occasion de rappeler que Bayard n’en est pas à son coup d’essai et qu’il prit naguère en flagrant délit d’aveuglement le Poirot d’Agatha Christie (voir Qui a tué Roger Ackroyd ?).
Ici comme là, il est question de mener une enquête sur l’enquête. Jeu jubilatoire dès qu’il aboutit, et c’est bien le cas, à une parfaite inversion des rôles : l’innocente victime s’avère diabolique meurtrière et l’assassin prétendu se révèle n’être qu’un brave collectionneur de papillons. Disons-le net : d’un bout à l’autre, la maestria de Bayard est confondante, et Sherlock a visiblement tout faux. Voilà certes qui donne à penser. Où va-t-on si les plus grands justiciers se fourrent le doigt dans l’œil ? Si tant de crimes restent impunis ? Si d’innocentes victimes sont condamnées à jamais ?
Bien sûr, nous sommes dans la fiction. Mais, outre que l’Angleterre entière a pleuré à la mort de Holmes, le doute est ainsi jeté sur la fiction elle-même. Et si les romanciers n’étaient pas maîtres de leurs personnages ? Et si les plus grands champions de la détection nous trompaient, se trompant eux-mêmes ?
Partant de quoi, l’enquête sur l’enquête rebondit. En théoricien goguenard qu’il s’aime à être, Pierre Bayard pose la question des rapports qu’entretiennent avec les personnages de la fiction les auteurs d’un côté, les lecteurs de l’autre. Or, nous rappelle-t-il, quand il écrit son Baskerville, Conan Doyle en est venu à ne plus supporter Sherlock. C’est au point que le désamour s’est mué en véritable « complexe de Holmes », le poussant à précipiter son héros dans une vision délirante de l’énigme à résoudre.
C’est pourquoi l’on voit l’impayable Sherlock donner à fond dans la légende fumeuse qui coiffe le roman et selon laquelle, depuis toujours, les Baskerville sont victimes d’un chien maléfique. Cela suffit pour qu’il multiplie les erreurs et que l’auteur ne soit pas loin de le fantasmer en canin meurtrier. Nouvelle preuve, nous dit Bayard, que les créatures de roman peuvent mener une vie à eux, loin parfois des dires de l’auteur. Car c’est bien à cette idée que le critique-détective voulait en venir : quand ils sont « grands », les personnages dédaignent la clôture du texte et invitent les lecteurs avisés à en faire autant.
On a dit que Sigmund Freud et Conan Doyle s’étaient rencontrés à Vienne à la fin du XIXe siècle. Si ce n’est pas une fable, on imagine qu’ils ont parlé de lapsus et d’indices, confrontant leurs métonymiques méthodes. A suivre Bayard, on souhaiterait que Doyle ait saisi l’occasion pour s’étendre sur le divan freudien et confier au père Sigmund l’étrange haine qui l’agitait.
Erwan Desplanques, Télérama, 20 février 2008
Sherlock avait tout faux
Une contre-enquête drôle et brillante, qui milite pour la lecture critique
La meilleure place d'un livre, c'est peut-être sur un ring. Au corps à corps avec le lecteur, qui en tord les pages dans tous les sens et en tiraille le sens à toutes les pages. A ce petit jeu, le psychanalyste et écrivain Pierre Bayard est imbattable. Il a déjà infligé une correction notoire à Agatha Christie (Qui a tué Roger Ackroyd ?, 1998), un soufflet à Shakespeare (Enquête sur Hamlet, 2002), s'est même fendu de réécrire Proust (Comment améliorer les œuvres ratées ?, 2000), non pour les humilier – la tâche serait ardue –, mais pour dire subtilement au lecteur que celui-ci a tous les droits. Y compris celui de ne pas lire, ajouterons-nous. Car Pierre Bayard est, depuis l'an dernier, d'abord connu pour cela : Comment parler des livres que l'on n'a pas lus, un (bon) ouvrage qui s'est (bien) vendu sur le malentendu de son titre : certains ont cru acheter un manuel de cuistrerie pour les nuls ; ils sont repartis avec un éloge savant de la lecture buissonnière, l'une des pierres les plus brillantes d'un édifice critique solide, pertinent, qui semble gagner en puissance de livre en livre. Professeur d'université, Pierre Bayard sait que l'humour permet à l'intelligence d'avancer masquée. Alors, il s'y drape, pince-sans-rire, et poursuit sous cape son travail sur la réception des textes littéraires, à la manière d'un Blanchot qui aurait assimilé Chevillard. En mitonnant des études de cas faussement absurdes, comme ce Chien des Baskerville dont il conteste joliment les conclusions.
Frondeur vif-argent, il chicane, ruse, se faufile dans les interstices du texte – la littérature est
« un univers troué » –, dépiaute la mécanique romanesque de Conan Doyle, lutte au flair avec Sherlock Holmes, met peu à peu en doute la fiabilité du narrateur et, par capillarité, la culpabilité du chien. Sa démonstration est généreuse (elle ne requiert pas la lecture préalable du roman), mais aussi haletante et implacable. Bayard repère dans le livre de Conan Doyle des indices que son propre héros n'aurait pas vus. Et nous oriente vers un autre coupable. Derrière la prouesse, on comprend le message : un livre s'écrit toujours à deux. « C'est le lecteur qui vient achever l'oeuvre et refermer, d'ailleurs temporairement, le monde qu'elle ouvre, et il le fait à chaque fois d'une manière différente. » Le roman fonctionne sur un principe de démocratie participative : libre à chacun de le réinventer selon ses goûts, de s'y investir sans crainte, d'en quereller le sens, de batailler avec l'auteur, ligne à ligne, quitte à contredire Bayard lui-même (tenez, page 152, l'argument sur la taille du coupable nous laisse sceptique).
Elémentaire, ce cher Bayard. Mais aussi retors et vibrionnant, il ruse à la perfection dans cet audacieux combat de boxe qu'est la lecture.
Maurice Mourier, La Quinzaine littéraire, 1er mars 2008
Les gens très intelligents sont bien agréables, d'abord parce qu"ils nous vengent du crétinisme ambiant, dans lequel l’examen critique des textes nous immerge souvent. Ils nous permettent surtout d’exercer à la rencontre ou à l’encontre de leurs élucubrations, les nôtres propres, qui ne sont pas moins problématiques : fécond et jubilatoire échange de fantaisies par volume interposé.
Ainsi l’amateur de jeu littéraire s’amusera-t-il considérablement à suivre pas à pas le cheminement de l’exégèse déliée, marquée au coin de quelque logique imperturbable et pince-sans-rire, que Pierre Bayard consacre au Chien des Baskerville, l’œuvre sans doute la moins oubliée de Conan Doyle (1902), où Sherlock Holmes ressuscité démêle l’affaire la plus enveloppée de fantastique de sa carrière.
Procédant avec une réjouissante habileté à un travail d’élucidation méthodique qui emprunte alternativement aux techniques de l’enquête policière à suspense et à celles de l’analyse textuelle à tiroirs (une hypothèse en contient une autre qui ouvre un nouveau mystère à éclaircir, etc.), Bayard repasse par tous les points du labyrinthe d’une intrigue hors du sens commun et semble n’avoir aucune peine, tant son style est limpide, à démonter l’insuffisance et le bâclé de l’histoire reconstituée par Sherlock Holmes. Il parvient ainsi, avec une grâce il faut le dire très convaincante, à innocenter le chien, devenu sous sa plume un brave toutou, et à découvrir le vrai coupable des crimes commis sur la lande de Dartmoor, coupable que nous nous garderons naturellement de révéler, afin de ne pas ôter un grain de son sel aux ruses déductives de l’exégète.
Pourtant, même cette révélation, si nous avions la muflerie d’y céder, n’enlèverait à vrai dire que bien peu de chose au charme de ce livre. Car ici une déconstruction réussie cache un tout autre enjeu que celui, déjà piquant, de remettre à sa place Sherlock Holmes, à qui le meurtrier file littéralement sous le nez.
Tout part d’une interrogation de Bayard sur la curieuse destinée de ce personnage devenu peu ou prou le parangon de la rigueur policière fondée scientifiquement. S’appuyant sur sa double compétence d’universitaire et de psychanalyste, l’audacieux enquêteur en second remarque en effet que Le Chien des Baskerville correspond à la résurrection de Sherlock Holmes, que Conan Doyle, exaspéré par le triomphe médiatique d’un héros qui occultait complètement ses autres livres - auxquels il attachait beaucoup plus de prix – avait pourtant fait mourir en 1893 au désespoir de ses milliers de fans.
Forcé de le repêcher près de dix ans plus tard, l’écrivain, telle est du moins l’astucieuse thèse de Bayard, cède avec réticence aux clameurs de la vox populi et produit inconsciemment une intrigue qu’Holmes résout en se trompant sur toute la ligne. Ainsi est-il anéanti dans ce qui fait l’essence même de son génie, sa capacité à venir à bout logiquement de tout embrouillamini d’apparences. L’inconscient de l’auteur s’est vengé de sa créature. Rien d’étonnant, dans ces conditions, à ce qu’il soit nécessaire de faire intervenir un inquisiteur moderne (Bayard, en l’occurrence) pour confondre les divers faux-semblants du livre de Conan Doyle. Borges le notait déjà, dans Examen de l’œuvre d’Herbert Quain (Le Jardin aux sentiers qui bifurquent, 1941) : « Le lecteur de ce livre singulier est plus perspicace que le détective. »
Cette lecture argumentée d’une enquête erronée (en ce qu’elle aboutit à la désignation d’un faux coupable, d’autant plus inapte à se défendre qu’étant chien il n’est pas doué de la parole, ce qui le met aussi hors de portée de la psychanalyse) n’est elle-même qu’un coffre à double fond qui cache une vérité textuelle plus dérangeante encore. Car si Conan Doyle n’a pas consciemment bâti une intrigue visant à ridiculiser son héros, c’est qu’il a lui-même été victime de la perversité du personnage qui est le véritable assassin.
Comment cette perte de leadership du maître théorique de l’intrigue est-elle possible ? S’insère alors dans le livre une brillantissime et (à notre sens) parfaitement délirante thèse dans la thèse, fiction dans la fiction, où Bayard oppose les « ségrégationnistes » – qui ne croient pas à l’existence des personnages fictifs en dehors du texte qu’ils informent et par là même en dehors de leur créateur – aux « intégrationnistes » dont il confesse faire partie. Voici l’intime conviction de ces derniers : « Les personnages littéraires bénéficient d’une certaine autonomie, à la fois à l’intérieur du monde où ils vivent et dans les circulations qu’ils effectuent entre ce monde et le nôtre..(..).. Nous ne contrôlons pas complètement, et l’auteur pas plus que les autres lecteurs, leurs faits et gestes. ». On aura reconnu, mais portée à un degré vertigineux de certitude, l’idée soutenue par quelques écrivains que leurs personnages leur échappent. Doué en quelque sorte d’une existence réelle, l’assassin du Chien des Baskerville n’a pas seulement glissé entre les mains de Sherlock Holmes, il a faussé compagnie à Conan Doyle pour accomplir à son insu des forfaits qui ne sont d’ailleurs (dernier double fond ou jeu avec la fiction) que la réalisation d’une vengeance différée de plusieurs siècles : celle d’une antique victime innocente de la malédiction qui pèse sur le manoir et la famille des Baskerville.
L’intrépidité exégétique de Bayard, chevalier sans peur des plus dangereux tourniquets fictionnels, ne recule donc devant aucun paradoxe. Nous le savons d’ailleurs coutumier du fait puisque auteur de joyeusetés telles que Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? et autres travaux aussi savants que cocasses édités dans la même collection. Est-il pour autant sans reproche ? Il nous semble que non. Car il se pourrait bien aussi que Conan Doyle eût été conscient et n’eût ourdi son enquête qu’en forme de complot, afin d’exciter le talent déductif du plus malin de ses lecteurs. Pourquoi ne pas attribuer au créateur du Chien des Baskerville le talent d’avoir créé une intrigue si déceptive et si retorse qu’il nous fallût, cent ans après, la décortiquer pièce à pièce pour prouver, comme l’a fait si excellemment Bayard, que Sherlock Holmes est le plus mauvais détective du monde ?
Dans ce différent schéma de lecture, l’enquêteur célèbre est joué sciemment par son auteur ennemi comme masque. Garant absolu de vérité pour le commun des amateurs de romans policiers (n’est-il pas celui qui ailleurs n’échoue jamais ?(1)), il dissimule seulement pour un temps, aux yeux pédonculaires des nouveaux Dupin, un jeu d’esprit fait pour être dénoué, déjoué, entre les lignes d’un livre.
Les textes qui nous sollicitent encore sont certes parcourus par des entités plus tangibles souvent et plus vivantes que nombre de nos contemporains. Mais il s’agit bien moins des héros créés que de leurs créateurs, bien moins de Frère Jean que de Rabelais, dont le rire résonne toujours à notre oreille virtuelle, moins de Pons que de Balzac, de Bardamu que de Céline.
Les Grands Transparents existent sans aucun doute. Ils circulent avec une divine aisance du monde présent et terne aux mondes invisibles et rutilants d’ici et de maintenant, du passé et du futur. Ce ne sont pas les personnages des livres – qui se souviendrait de Nadja, sans Breton ? -, ce sont, à la condition expresse qu’ils le méritent, leurs auteurs logés en nos cervelles.
1 Ce serait du reste à vérifier. Et si toutes les enquêtes du fameux policier étaient bidon ? Voilà du pain sur la planche pour les loisirs studieux du chevalier Bayard.
Du même auteur
- Le Paradoxe du menteur, 1993
- Maupassant, juste avant Freud, 1994
- Le Hors-sujet, 1996
- Qui a tué Roger Ackroyd ?, 1998
- Comment améliorer les œuvres ratées ?, 2000
- Enquête sur Hamlet, 2002
- Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse, 2004
- Demain est écrit, 2005
- Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?, 2007
- L'Affaire du chien des Baskerville, 2008
- Le Plagiat par anticipation, 2009
- Et si les œuvres changeaient d'auteur ?, 2010
- Comment parler des lieux où l'on n'a pas été ?, 2012
- Aurais-je été résistant ou bourreau ?, 2013
- Il existe d'autres mondes, 2014
- Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer ?, 2015
- Le Titanic fera naufrage, 2016
- L'Enigme Tolstoïevski, 2017
- La Vérité sur 'Dix petits nègres', 2019
- Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?, 2020
- La Vérité sur 'Ils étaient dix', 2020
- Oedipe n'est pas coupable, 2021
- Et si les Beatles n'étaient pas nés ?, 2022
- Hitchcock s'est trompé, 2023
- Aurais-je été sans peur et sans reproche ?, 2024
- Je sommes plusieurs, 2025
Poche « Double »
- Qui a tué Roger Ackroyd ?, 2008
- L'Affaire du chien des Baskerville , 2010
- Enquête sur Hamlet, 2014
- La Vérité sur 'Ils étaient dix', 2021
- Aurais-je été résistant ou bourreau ?, 2022
- Œdipe n'est pas coupable, 2023
- Et si les Beatles n'étaient pas nés ?, 2024
- Hitchcock s'est trompé, 2025
Livres numériques
- Comment parler des lieux où l'on n'a pas été ?
- Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?
- Comment améliorer les œuvres ratées ?
- Demain est écrit
- Et si les œuvres changeaient d'auteur ?
- L'Affaire du chien des Baskerville
- Le Hors-sujet
- Le Paradoxe du menteur
- Le Plagiat par anticipation
- Maupassant, juste avant Freud
- Peut-on appliquer la littérature à la psychanalyse
- Qui a tué Roger Ackroyd ?
- Enquête sur Hamlet
- Aurais-je sauvé Geneviève Dixmer ?
- Le Titanic fera naufrage
- L'Enigme Tolstoïevski
- Comment parler des faits qui ne se sont pas produits ?
- La Vérité sur 'Ils étaient dix'
- Aurais-je été résistant ou bourreau ?
- Et si les Beatles n'étaient pas nés ?
- Hitchcock s'est trompé
- Oedipe n'est pas coupable
- Œdipe n'est pas coupable
- Aurais-je été sans peur et sans reproche ?
- Et si les Beatles n'étaient pas nés ?
- Hitchcock s'est trompé
- Je sommes plusieurs
