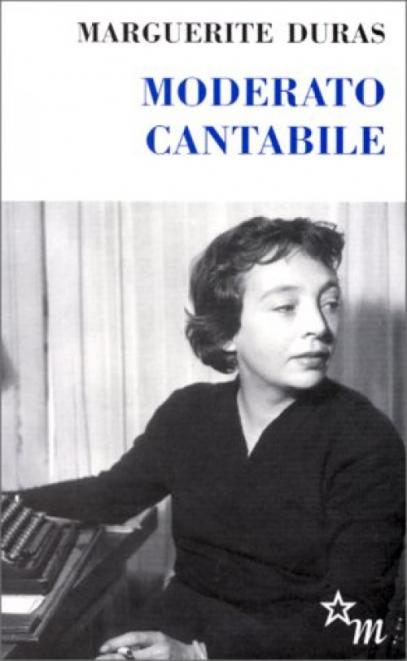
Marguerite Duras
Moderato cantabile
suivi de Moderato cantabile dans l’œuvre de Marguerite Duras
par Gaëtan Picon et de Moderato cantabile et la presse française
1980
collection de poche double n°2, 172 pages
ISBN : 9782707303141
7.90 €
* Première publication aux Éditions de Minuit en 1958.
« Qu’est-ce que ça veut dire, moderato cantabile ?
– Je sais pas. »
Une leçon de piano, un enfant obstiné, une mère aimante, pas de plus simple expression de la vie tranquille d’une ville de province. Mais un cri soudain vient déchirer la trame, révélant sous la retenue de ce récit d’apparence classique une tension qui va croissant dans le silence jusqu’au paroxysme final.
« Quand même, dit Anne Desbaresdes, tu pourrais t’en souvenir une fois pour toutes. Moderato, ça veut dire modéré, et cantabile, ça veut dire chantant, c’est facile. »
ISBN
PDF : 9782707330017
ePub : 9782707330000
Prix : 7.49 €
En savoir plus
Claude Delmont (L’Heure de Paris, 20 février 1958)
Une voie nouvelle
« (...) J’ai dit de Moderato cantabile en commençant qu’il s’agissait d’un livre rare. Il faudrait dire aussi que ce livre, pour rare qu’il soit, ouvre au milieu du désert du roman une voie nouvelle. Nous sommes las de ces romans où, à la mode d’Hemingway, un “ sous-roman ” psychologique s’écoule sous les propos de table et l’énumération des gestes quotidiens, convenu comme une rivière canalisée. Nous sommes las également du symbolisme imité de Kafka qui donne, au mieux, Beckett, et La Peste dans le pire des cas. Ce que Marguerite Duras a tenté et réussi avec son dernier roman, c’est un livre où les gestes et les mots, en même temps qu’ils ne veulent dire que ce qu’ils disent, dénoncent immédiatement leur transcendance. On pense, en la lisant, aux livres magistraux où, par une mystérieuse osmose, chaque événement nous happe au monde des idées. On pense à Proust et à Melville. »
Claude Mauriac (Le Figaro, 12 mars 1958)
L’étouffant univers de Marguerite Duras
« Le nouveau roman que Mme Marguerite Duras publie aux Éditions de Minuit, Moderato cantabile, est d’une grande brièveté. À peine plus de cent cinquante pages très aérées, imprimées en gros caractères. D’où vient qu’étant court ce récit nous retienne longuement ? (Non qu’il nous donne l’impression de n’en plus finir : c’est nous qui n’en finissons pas avec lui.) D’où que, se tenant semblait-il à la superficie des êtres, il nous paraisse aller si profond ?
Marguerite Duras a pu être officiellement enrôlée dans l’équipe des pionniers qui tentent d’ouvrir au roman ses voies nouvelles. Réunion d’écrivains assez hétéroclite et ne méritant peut-être pas tous l’honneur d’être nommés en même temps que Nathalie Sarraute et Alain Robbe-Grillet. Mais pour Marguerite Duras (comme au pôle opposé pour Jean Cayrol) de tels rapprochements sont défendables : il faut simplifier avant de comprendre.
L’univers de Robbe-Grillet, c’est celui des hommes parmi les objets. Le domaine de Marguerite Duras, celui des hommes-objets. À l’un et à l’autre je préfère le monde de Nathalie Sarraute avec ses petites planètes les unes aux autres étrangères et communiquant par appels chiffrés (l’auteur s’applique à retrouver les codes). Mais la vision d’un Robbe-Grillet, celle d’une Marguerite Duras n’en arrivent pas moins à s’imposer à nous et à nous en imposer.
Dans le récit précédent de Marguerite Duras, Le Square, nous avions, entre deux êtres simples, un vain dialogue qui ne menait à rien, sinon à nous rendre sensibles notre propre solitude et notre inanité : comme ces êtres démunis aussi bien qu’à l’exemple du plus grand des poètes, nous n’étions pas au monde. Exclusion qui est de nouveau le thème du dernier roman de Marguerite Duras, Moderato cantabile.
La difficulté matérielle de vivre distrait (mais à quel prix !) l’immense majorité des hommes de la difficulté d’être. En outre, chacun joue son personnage, comme le garçon de café de Jean-Paul Sartre : tels sont les jeux les plus constants des hommes, négligés par Roger Caillois dans son passionnant Les Jeux et les Hommes (Gallimard). Tel est notre oxygène.
Seuls les romanciers peuvent réaliser les conditions de l’impossible expérience qui consiste à nous en priver. Et c’est, par exemple, l’irrespirable univers de Samuel Beckett, ou celui non moins étouffant de Marguerite Duras où la personne humaine n’est plus personne mais souffre. Il y a dans Moderato cantabile un admirable chapitre qui nous permet enfin de situer les personnages et de comprendre le peu qui, en eux, peut être compris. Bien des lecteurs auront fermé le livre avant d’y arriver. C’est que la nouvelle littérature ne flatte pas notre paresse ni nos goûts et qu’elle doit être méritée. »
Anne Villelaur (Les Lettres françaises, 6 mars 1958)
Une noix creuse
« (...) De ce dialogue harassant, il se dégage bien quelques petites choses : le désarroi de cette femme, la tristesse de sa vie, un vague désir de communiquer, par-delà les mots, avec quelqu’un – et pourquoi pas, après tout, avec ce Chauvin qui s’est trouvé là ? Mais pourquoi ces saouleries au vin rouge ? Ce brusque désir de rompre avec la vie normale ? Il y a une sorte d’outrance qui fait que le lecteur ne peut, derrière ce comportement qu’on nous dit, imaginer qu’un monde superficiel dans lequel vit un être superficiel. Cette coquille de noix que Marguerite Duras nous offre ne ressemble en rien à celle dont parlait Joyce lorsqu’il disait vouloir mettre all space in a nutshell, car elle est, au départ, aussi faussement bariolée qu’un œuf de Pâques. »
Dominique Aury (La Nouvelle Nouvelle Revue Française, 1 juin 1958)
La caverne de Platon
« De quel poids le destin des autres pèse-t-il sur ceux qui en sont témoins ? Pourquoi le cri soudain d’une inconnue et la vue de son corps en sang ont-ils troublé si fort Anne Desbaresdes, qui est une femme jeune et riche, uniquement attachée à son petit garçon ? Pourquoi retourne-t-elle au café sur le port, où le cadavre de l’inconnue s’était écroulé dans le jour tombant ? Pourquoi interroge-t-elle cet autre inconnu, Chauvin, témoin comme elle ? Une étrange ivresse s’empare d’elle, où les verres de vin qu’elle se fait servir, et qu’elle boit lentement, ne sont au mieux que des prétextes. Sur le lieu du crime commis par un autre elle revient chaque jour. Chaque jour elle interroge plus avant, parle elle-même un peu plus longuement. L’enfant joue dehors pendant qu’elle s’attarde. Mais un jour elle viendra seule. Un jour elle aura la réponse. Que cherchait-elle donc ? L’amour de Chauvin ? La mort des mains de cet homme qu’elle désire, et qui la désire, comme l’avait obtenue de son amant la femme assassinée ? Un immense scandale silencieux s’est enflé autour d’Anne et de Chauvin et se résout dans le silence par leurs mains qui se joignent une seconde seulement, les lèvres posées sur les lèvres une seconde. Adieu. Tout est dit.
À peine si ce livre a cent cinquante pages. Pas une seule de ces pages qui ne soit limpide, pas une seule où ne figure une phrase qui pourrait figurer aussi bien dans un compte rendu de faits divers. Pas une obscurité dans le récit. Il est impossible de concevoir des moyens plus stricts et plus rigoureux. Cette simple clarté, cette brièveté dure et nue sont pourtant chargées de foudre et jettent le lecteur dans un puits sans fond, dans un interminable labyrinthe sans issue, qui est en vérité la caverne de Platon. Car ici rayonnent pour chacun de nous les images de la destinée. Le mystère des corps et des cœurs, le voilà, non pas expliqué, non pas résolu, mais saisi dans son essence par le biais et par le reflet. L’extraordinaire acuité de l’oreille et du regard, l’extraordinaire discrétion de l’écriture vont de pair chez Marguerite Duras avec une intensité presque diabolique, qu’il s’agisse de la présence des êtres ou de celle des choses. Elle dit en ne disant pas. Elle impose en éludant. Elle forme une espèce de creux où ce qu’elle ne décrit ni ne nomme s’engouffre irrésistiblement, s’établit, éclate avec évidence. Que dit-elle de ces deux personnages dont le dialogue fait le centre du récit ? Bien peu de choses. Anne a les cheveux blonds, Chauvin a les yeux bleus. Il est ouvrier, sans doute, dans ces Fonderies qui sans doute encore appartiennent au mari d’Anne. Mais d’eux on sait comme malgré soi tout le reste, sans que personne ait pris la peine de le préciser. Les grands couloirs vides inondés de lumière, dans la grande maison d’Anne Desbaresdes, l’odeur du magnolia en fleur, le ressac de la mer proche – si le détail de cet univers paisible et menaçant remplissait des pages et des pages, il ne pourrait être plus présent qu’il ne l’est en dix lignes, en vingt lignes. Ce bref récit a des prolongements de roman-fleuve, et le titre en est trompeur. Modéré et chantant, peut-être, mais Moderato cantabile est moins fait de musique et de mélodie que de lumière silencieuse, perçante et brusque comme la lumière des phares tournants ; et comme la tranchante lumière laisse dans l’oeil une trace de feu, Marguerite Duras laisse dans l’esprit une sourde traînée de phosphore, qui brûle. »
Claude Roy (Libération, 1er mars 1958)
Madame Bovary réécrite par Bela Bartok
« Le nouveau roman de Marguerite Duras, Moderato cantabile, pourrait se définir : Madame Bovary réécrite par Bela Bartok – s’il ne s’agissait, avant tout, d’un roman de Marguerite Duras (qui ne ressemble finalement à personne) et de son meilleur livre (ce qui est dire beaucoup).
Dès son troisième livre, Un barrage contre le Pacifique, l’écrivain avait atteint pourtant la maîtrise. Quand elle a eu dominé le métier du roman traditionnel, on dirait que cela n’a plus intéressé du tout Duras. Elle a entrepris autre chose, avec des bonheurs inégaux, et une personnalité constante. J’aime beaucoup le début du Marin de Gibraltar, trois ou quatre des nouvelles de son recueil de contes. Les Petits Chevaux de Tarquinia est un livre qui me laisse toujours à la fois séduit et irrité. Le Square est une cérémonieuse et déchirante allégorie, œuvre d’art et d’artifice. Mais tout ce qu’elle avait essayé, tenté, tâtonné, entrevu, dépassé et repris, esquissé et raté dans ses précédents romans, tous remarquables et jamais tout à fait achevés, s’accomplit dans Moderato cantabile.
C’est un récit d’un extraordinaire dépouillement, construit avec une rigueur formelle admirable, et qui pourtant ne laisse jamais le souci d’architecture, la volonté de sécheresse dans l’expression, le métier rigoureux étouffer ou atténuer l’émotion. (…)
Il est bien entendu impossible de parler d’un roman sans “ raconter ” ce dont il s’agit. Mais si le roman de Marguerite Duras n’était que cette anecdote, il décevrait sans doute. Puisque le titre (et un des thèmes conducteurs) du roman nous invitent à penser à la musique, disons que les modulations, l’harmonisation et les accords de Moderato cantabile constituent l’essentiel. J’ai entendu dire et lu, ici et là, qu’il y avait dans le livre je ne sais quoi de systématique et de froid. On comparera Marguerite Duras aux écrivains dont elle tend en effet à se rapprocher, aux phénoménologues du roman “ nouveau ”, acharnés à porter sur le monde et les êtres un regard objectif et froid comme le verre d’un objectif. Ce qui me semble pourtant dominer dans ce livre net et précis, c’est précisément l’émotion, la sensibilité, le murmure savamment réprimé d’une plainte vraiment belle et tout à fait déchirante. Ici un écrivain de tête écrit raisonnablement ce que dicte celui qui a des raisons que la raison ne connaît pas. »
Robert Poulet (Rivarol, 10 juillet 1958)
La règle du jeu transgressée
« Moderato cantabile, c’est de la littérature d’essai ; un roman-exercice. L’auteur a prouvé précédemment qu’il sait raconter une histoire ; et même il y fourrait des agréments extérieurs en quantité superflue. Était-ce une raison de tomber aujourd’hui dans l’excès opposé ? En tout cas, l’aventure d’Anne Desbaresdes, telle qu’elle nous est présentée, passerait difficilement pour un divertissement, fût-ce du type le plus noble. Le lecteur doit à ce point tendre sa pensée, pour comprendre où l’on se trouve, qui est en scène, ce qui se passe, qu’aucun enchantement romanesque ne saurait avoir prise sur elle.
Marguerite Duras n’a pas tort de croire que le même fait peut prendre diverses couleurs et produire des émotions différentes, selon la manière dont il est narré. Encore faut-il qu’il soit narré. En l’occurrence, nous voyons une dame qui revient sans cesse au même endroit pour poser sans cesse les mêmes questions ; et, peu à peu, ce manège assez hagard nous permet de deviner à moitié les événements et les sentiments qui furent à sa source. Hélas, une telle recherche ne s’accorde absolument pas avec le phénomène mental par l’effet duquel la fable littéraire nous séduit et nous égare. En définitive, qu’il soit arrivé telle ou telle chose à Chauvin, à Mlle Giraud, au petit garçon d’Anne, cela nous est bien égal, ces fantômes étant restés pour nous des fantômes, auxquels nulle sympathie ne nous attache.
On nous remontre qu’à ce prix nous ressentons, grâce à ces “ dialogues harassants ”, une “ présence éclatante du monde et de la vie ”. Erreur manifeste ! ... Il en faut beaucoup moins ou beaucoup plus.
C’est quand une voix basse et tranquille commence : “ Il était une fois ” (le Petit Poucet, la chèvre de M. Seguin, la princesse de Clèves, le cousin Pons, Arthur-Gordon Pym, Augustin Meaulnes), que le monde et la vie nous semblent tout à coup présents : une vie et un monde toujours nouveaux, à mille lieues des nôtres, et où quand même nous nous trouvons transportés en un clin d’oeil avec toute la puissance de notre être. On peut tout faire dans le roman, excepté en troubler les conditions essentielles, excepté y couper le courant, lequel ne passe dans les mots, dans les fictions (on l’oublie toujours), que par miracle.
Proust et Joyce eux-mêmes furent contraints, lorsqu’ils voulurent nous enchanter dans les règles, de prendre, vis-à-vis de Palamède de Charlus ou de Stephen Dedalus, la même attitude que l’aède homérique vis-à-vis du bouillant Achille. Ce récit supporte d’être coupé, suspendu, enfoui sous une magie étrangère, enveloppé de discours et de réflexions, reflété dans la cervelle d’un témoin comme dans une glace, mêlé comme un jeu de cartes ou truqué comme une balance : il ne souffre pas d’être remplacé par autre chose. Une composition décorative et statique où paraissent des personnages imaginaires n’est pas un roman, n’agit pas sur nous comme un roman, quelles que soient ses qualités humaines et ses mérites intellectuels. Surtout, il ne nous rend présents ni le monde, ni la vie.
Il y a dans l’art éternel du romancier cent innovations merveilleuses à tenter dont personne ne s’avise. Tout une jeune école s’épuise à modifier précisément ce qui, par nature, doit rester invariable, à savoir : l’illusion narrative. Un accablement sans nom, qu’adoucit le respect des naïfs, s’abat sur ces travaux de laboratoire. Ils s’évanouiraient en une seconde, au premier aspect de cet astre : un tempérament. »
Madeleine Alleins (Critique, 1er juillet 1958)
Un langage qui récuse la quiétude du savoir
« Moderato cantabile amène le lecteur à devenir le témoin d’une aventure métaphysique vécue organiquement, dans l’obscurité, presque dans l’imbécillité. Nous voilà loin des consciences bavardes et des qualifications rassurantes, qui, à force de cataloguer les choses, font croire qu’elles sont à notre portée.
Pour oser s’évader de l’ordre extérieur de son existence, Anne Desbaresdes aura recours au vin. Tremblement, émoi, sourire de délivrance, grimace perplexe, constatation d’une envie inhabituelle de rire ou de ne pas rentrer chez elle, tous ces signes nous montrent que l’auteur se place au plus bas niveau possible, au-dessous du niveau des histoires, des interprétations commodes, des limitations, des fausses compréhensions de l’intelligence, qu’il se refuse aux explications, aux déroulements clairs, aux enchaînements savants.
Il ne s’agit pas d’une démission de la littérature. Jamais livre ne fut plus rigoureusement construit. D’une quinzaine de pages chacun, sept dialogues tâtonnants, – qui pourraient paraître nés du hasard ou de mouvements aveugles ayant échappé au schématisme de l’intellect, – et un dîner d’une perfection formelle presque irritante tant elle est concertée, nous mettent en face et de la nuit intérieure et de l’éclat des apparences sur lesquelles le regard glisse ‘sans pouvoir pénétrer. Nécessaire, juste, presque contrôlé, dirait-on, au dictionnaire, le mot joue son rôle strict, qui n’est pas de suggérer par des artifices le mystère, mais d’en faire constater l’existence.
Ici le langage garde toute sa beauté, toute sa magie aussi, mais il est dépouillé de ce qu’on lui accorde si volontiers, la confiance en ses pouvoirs de saisie. Il lui est ôté cette facilité qui consiste, en nommant les choses, à les faire disparaître derrière un écran de familiarité. La quiétude du savoir est troquée contre l’inquiétude, l’étonnement, l’émotion presque religieuse où doit nous plonger une réalité rétablie dans sa distance par rapport à nous.
Par la place qu’elle fait au silence en refusant de nommer, de raconter, de distraire, de meubler les blancs, Marguerite Duras force le lecteur attentif à se réveiller, à écarter les explications habituelles ou du moins à les vérifier. Ce livre ne nous permet pas de nous laisser glisser de geste en geste, d’événement en événement ; avec lui nous sommes forcés de constater l’inconnu, qui est peut-être, qui demeurera peut-être l’inconnaissable.
Dans l’œuvre déjà importante de Marguerite Duras, chaque livre est une nouvelle recherche. On se souvient sans doute que dans Le Marin de Gibraltar, à travers des dialogues touffus, sans directions apparentes, de multiples aventures géographiques, un homme et une femme s’aimaient dans la poursuite sans terme d’un marin mythique. Le Square, dont le propos paraît l’inverse de Moderato cantabile, traitait à peu près le même sujet, la rencontre de deux êtres et leurs tentatives de communication jusqu’à son point le plus extrême, l’amour, en utilisant au maximum les possibilités de formulation du langage.
Plus que l’apport d’un procédé nouveau, une habileté technique, le dernier livre de Marguerite Duras, – et il faut espérer que le Prix de Mai qui vient de lui être attribué incitera les lecteurs à l’attention qu’il nécessite, – représente une attitude d’esprit qui contient peut-être pour le roman une de ses plus réelles chances de renouvellement. »
Jean Mistler (L’Aurore, 12 mars 1958)
Un essai non une œuvre achevée
« Mme Marguerite Duras a rejoint aux Éditions de Minuit où paraît son nouveau livre, Moderato cantabile, MM. Butor, Robbe-Grillet et Claude Simon, la jeune et intéressante équipe de ces romanciers-enregistreurs, pour qui l’écrivain doit être rigoureusement absent de son récit et se borner à rapporter, en vrac, comme elles lui parviennent, ses sensations à l’état brut.
Mme Duras ne fait pas figure de tardive recrue dans ce groupe. Son livre, Le Square, paru il y a trois ans je crois, ressortissait déjà à la même esthétique, les rendez-vous sur un banc de jardin public de son terne héros et de sa médiocre héroïne étaient, dans la lenteur et la banalité voulues de leur conversation, comme une première épreuve de Moderato cantabile.
Le critique est en droit de se demander pourquoi ce second essai, car il ne peut s’agir que d’un essai en vue de créer plus tard une œuvre achevée. En voici le thème : Anne Desbaresdes a assisté par hasard à un crime passionnel dans un café du port, pendant que son petit garçon prenait sa leçon de piano. Elle ira à plusieurs reprises dans ce café et elle interroge un homme qu’elle y retrouve chaque fois. Nous avons l’impression que l’homme n’en sait pas plus long qu’Anne et que d’ailleurs elle n’écoute guère ce qu’il lui raconte. Après cinq ou six rencontres, aucune action ne se sera engagée, mais nous sentons vaguement que les positions psychologiques se sont transformées. Malheureusement, cette évolution qui nous intéressait tant dans La Modification de Michel Butor ne réussit guère ici à nous retenir. Je crois très sincèrement que Mme Duras s’enfonce dans une impasse et je le déplore, car elle sait peindre, à touches menues, des scènes vivantes et vraies, par exemple la leçon de piano du gamin qui met toute la mauvaise volonté du monde à jouer une Sonatine de Diabelli et ne veut pas se rappeler que moderato veut dire modéré et cantabile, chantant. »
Maurice Nadeau (France Observateur, 6 mars 1958)
L’art de ne rien conclure
« (...) Le propre des solutions imaginaires est de demeurer constamment ouvertes et, précisément, de ne rien conclure. Anne et Chauvin se reverront-ils ? Deviendront-ils amants ? La tragédie qu’ils ont mimée dans l’ivresse des possibilités offertes par l’envoûtement du sang versé, du vin bu, des paroles échangées, la vivront-ils, eux-mêmes ou avec d’autres partenaires ? La voie que voulait se frayer Anne conduit-elle à l’amour, à l’indépendance, ou à la frustration ? Quel rôle joue l’enfant dans les déterminations d’Anne ? Nous n’en saurons rien. L’auteur se referme sur ses secrets et, après nous avoir tendu divers fils d’Ariane, nous abandonne à la sortie du labyrinthe. C’est sans doute de sa part une ruse supplémentaire. Libre à nous, au grand jour, de nous frotter les yeux ou de retourner aux rêves de la nuit. Si quelque irritation nous visite, elle est encore le fruit de la parfaite science de Marguerite Duras, de sa maîtrise. Sa réussite voulait l’inaccomplissement. »
Du même auteur
- Moderato cantabile, 1958
- Détruire dit-elle, 1969
- Le Camion, 1977
- Les Lieux de Marguerite Duras, 1978
- L’Homme assis dans le couloir, 1980
- Agatha, 1981
- L’Homme atlantique, 1982
- Savannah Bay, 1982
- La Maladie de la mort, 1983
- L'Amant, 1984
- La Pute de la côte normande, 1986
- Les Yeux bleus cheveux noirs, 1986
- Emily L., 1987
- L'Amant (Édition spéciale), 2024
Poche « Double »
- Moderato cantabile, 1980
- Détruire dit-elle, 2007
- Savannah Bay, 2007
- Emily L., 2008
- L'Été 80, 2008
- Les Lieux de Marguerite Duras, 2012
- Les Parleuses, 2013
- Les Yeux bleus cheveux noirs, 2014
Livres numériques
- Les Parleuses
- Agatha
- Détruire dit-elle
- Emily L.
- L'Amant
- L'Été 80
- L’Homme assis dans le couloir
- L’Homme atlantique
- La Maladie de la mort
- La Pute de la côte normande
- Le Camion
- Les Yeux bleus cheveux noirs
- Moderato cantabile
- Savannah Bay
- L'Amant (Édition spéciale)
