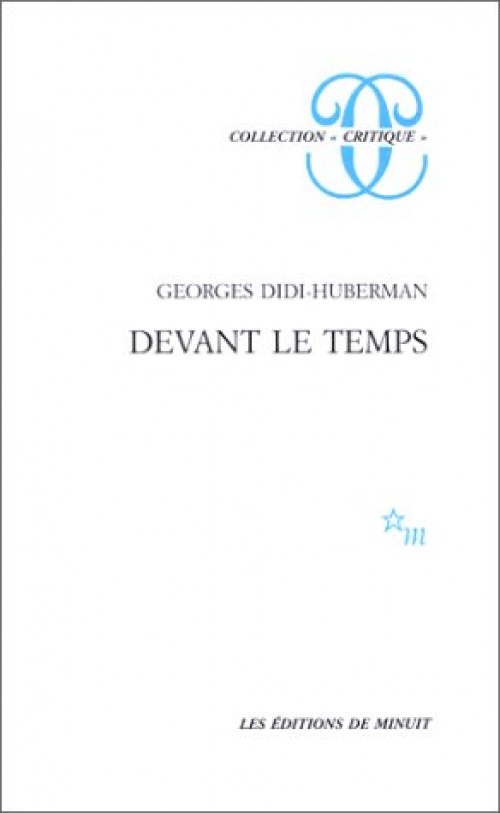
Georges Didi-Huberman
Devant le temps
Histoire de l’art et anachronisme des images
2000
Collection Critique, 288 pages, 24 illustrations in texte
ISBN : 9782707317261
24.00 €
Mettre le temps au centre de toute pensée de l’image : nous sommes devant l’image comme devant du temps – car dans l’image c’est bien du temps qui nous regarde.
Quel genre de temps ? Durée ou instantanéité ? Continuité ou discontinuité ? Écoulement ou écroulement ? Généalogie ou nouveauté ? Les questions sont multiples. Ce livre tente de les reformuler, dans toute l’ampleur des débats qui conditionnent, aujourd’hui encore, notre approche des images : depuis l’antique fondation d’une histoire de l’art chez Pline l’Ancien jusqu’aux plus récents débats sur l’art contemporain.
Au cœur de ces dilemmes surgit une position dialectique qu’incarnent spécialement quelques penseurs non académiques des années vingt et trente, spécialement Walter Benjamin et Carl Einstein. Leur travail théorique est ici relu comme une pensée de l’anachronisme : les images ne sont ni les purs fétiches intemporels que prône l’esthétique classique, ni les simples chroniques figuratives que prône l’histoire de l’art positiviste. Elles sont des montages de temporalités différentes, des symptômes déchirant le cours normal des choses. Quand l’image survient, l’histoire se “ démonte ”, dans tous les sens du mot. Mais alors, le temps se montre, il s’ouvre dans toute sa complexité, dans son montage de rythmes hétérogènes formant anachronismes.
Façon de repenser, dans l’image, les rapports de notre Maintenant avec l’Autrefois. Façon de critiquer une certaine conception de l’histoire en proposant, via l’anachronisme – cette part maudite de l’historien – un nouveau modèle de temporalité. Façon de mettre l’image au centre de toute pensée du temps.
‑‑‑‑‑ Table des matières ‑‑‑‑‑
Ouverture
L’histoire de l’art comme discipline anachronique
Devant l’image : devant le temps. Paradoxe et part maudite. Il n’y a d’histoire qu’anachronique : le montage. Il n’y a d’histoire que d’anachronismes : le symptôme. Constellation de l’anachronisme : l’histoire de l’art devant notre temps.
I. Archéologie de l’anachronisme
1. L’image-matrice. Histoire de l’art et généalogie de la ressemblance
L’histoire de l’art commence toujours deux fois. Pline l’Ancien : « La ressemblance est morte. » Empreintes du visage, empreintes de la loi. Ressemblance par génération et ressemblance par permutation. L’origine comme tourbillon.
2. L’image-malice. Histoire de l’art et casse-tête du temps
L’histoire de l’art est toujours à recommencer. Walter Benjamin, archéologue et chiffonnier de la mémoire. L’image survient : l’histoire se démonte. Connaissance par le montage. Kaléidoscope et casse-tête : « Le temps s’élance comme un bretzel... »
II. Modernité de l’anachronisme
3. L’image-combat. Inactualité, expérience critique, modernité
« L’histoire de l’art est la lutte de toutes les expériences... » Carl Einstein à la pointe de l’histoire : le risque anachronique. Expérience de l’espace et expérience intérieure : le symptôme visuel. « Je ne parle pas de façon systématique... »
4. L’image-aura. Du maintenant, de l’autrefois et de la modernité
Supposition de l’objet : « Une réalité dont aucun œil ne se rassasie. » Supposition du temps : « L’origine, c’est maintenant. » Supposition du lieu : « L’apparition du lointain. » Supposition du sujet : « Je suis le sujet. Je suis aussi le verbe... »
Note bibliographique – Index des noms – Index des notions –Table des figures
Robert Maggiori (Libération, 23 novembre 2000)
Le temps de voir
L’histoire de l’art exige un art de l’Histoire, un art de la mémoire. Aussi, l’arrêt sur l’image – une fresque de la Renaissance ou une toile de Barnet Newman – est-il arrêt sur le temps.
« Quand on s’intéresse à l’histoire de l’art, on s’intéresse, en général, plus à l’art qu’à l’histoire. On ne peut, il est vrai, courir tous les lièvres à la fois. La difficulté est déjà immense de savoir si une œuvre est une œuvre d’art, et s’il faut, pour en saisir le sens, faire confiance à l’érudition traditionnelle du connoisseur, à la sociologie de la culture, à une approche “ euchronique ” (“ l’artiste et son temps ”), à l’histoire sociale, qui en étudie les conditions de production et d’usage, à une lecture formaliste, qui en analyse les qualités stylistiques et les modes de création, à une interprétation psychologique ou psychanalytique, qui tente d’en révéler le mystère en pénétrant la personnalité de son créateur, etc. La question de l’historicité elle-même, du temps, on comprend, dès lors, qu’on veuille la laisser aux seuls historiens. Ce n’est pas l’avis de Georges Didi-Huberman, qui enseigne à l’École des hautes études en sciences sociales, et dont on publie aujourd’hui Devant le temps.
De livre en livre – depuis l’Invention de l’hystérie, une étude de l’iconographie photographique de la Salpetrière, publiée en 1982 –, Georges Didi-Huberman élabore en effet une sorte de “ gai savoir ”, à la fois esthétique, philosophique et historique, qui, traquant dans l’image non le visible mais le visuel, non “ ce qui se donne à voir ” mais le symptôme de ce qui devrait être vu, non un “ espace ” où se déploient formes, signes et couleurs mais une concrétion de temps, un montage de temps hétérogènes, oblige l’histoire de l’art à (re)devenir un art de la mémoire et de l’histoire. “ Devant une image – si ancienne soit-elle – le présent ne cesse jamais de se reconfigurer, pour peu que la dépossession du regard n’ait pas complètement cédé la place à l’habitude infatuée du « spécialiste » Devant une image – si récente, si contemporaine soit-elle – le passé en même temps ne cesse jamais de se reconfigurer, puisque cette image ne devient pensable que dans une construction de la mémoire, si ce n’est de la hantise. Enfin (... ) nous sommes devant elle l’élément fragile, l’élément de passage, et elle est devant nous l’élément du futur, l’élément de la durée. ”
II est, dans le couvent de San Marco, à Florence, un curieux “ pan de peinture renaissante ”. La partie inférieure de la Madone des ombres de Fra Angelico. Un pan de fresque rouge, un “ fond ” sur lequel le pigment clair aurait été projeté à distance, en pluie, et qui ferait comme une myriade d’étoiles désordonnées. Pas un “ tableau ” donc, mais un “ objet visuel ”, à négliger sans doute, et qui paraît en tous cas dénué de sens, aussi dénué de sens que cette éclaboussure, ce filet de couleur sang sortant de la couture d’un coussin posé à côté de la Dentellière de Vermeer et qui “ ne représente rien, presque rien ”. Ce n’est pas un “ motif ”, ni une “ allégorie ”, ni même un “ sujet ” ou un “ thème ”. Des voies ouvertes par la tradition esthétique, aucune dès lors n’est fréquentable, pas même celle de l’iconologie “ canoniquement ” fixées par Erwin Panofsky. Quand on n’a plus de saints à qui se vouer, on se doit de tout recommencer, ou du moins de rendre à nouveau opératoires certaines “ ruptures épistémologiques ”, effacées ou refoulées, qui, au lieu d’apporter d’autres réponses aux mêmes questions, ont changé les questions. En l’occurrence, pour comprendre aussi bien la “ double naissance de l’histoire de l’art ”, avec Pline l’Ancien et Vasari, que les débats sur l’art contemporain, il faut “ revenir ” à ces penseurs qui, au début du siècle, en Allemagne, ont engagé “ une réflexion philosophique sur l’épistémé de leur discipline ”, Heinrich Wölfflin, Alois Riegl, Max Dvorak, et, surtout, Aby Warburg, Carl Einstein ou Walter Benjamin. Et poser d’autres axiomes, dont celui-ci, essentiel : “ Toujours, devant l’image, nous sommes devant le temps. ” Dès lors, Didi-Huberman peut entreprendre son “ archéologie critique de l’histoire de l’art ”. Entreprise difficile, parce qu’obligée de se dérouler en gymkhana entre des paradoxes : l’un visuel, l’autre temporel. Même au sein d’une œuvre qu’on penserait depuis longtemps “ apprivoisée ” parle regard, il n’y a jamais de “ tableau ”, mais des apparitions, des incongruités, des fulgurances qui en destructurent la signification et renvoient cependant à d’autres structures où le sens se constitue en énigme, en échappée, en ricochet, en symptôme. Aucune œuvre ne peut même être “ vue ”, car jamais l’image ne se donne entièrement au regard : elle parle en instants, en durée, en simultanéités, en successions, au conditionnel et au futur antérieur, elle parle, autrement dit, à la mémoire. Dans un cas, c’est le cours de la représentation qui est interrompu, dans l’autre le cours de l’histoire chronologique. Ce que propose Didi-Huberman paraît alors particulièrement audacieux : une pensée de l’image qui impliquerait, eût dit Deleuze, la différence et la répétition, le symptôme et l’anachronisme, un inconscient de la représentation et un inconscient de l’histoire. Reste à savoir à qui profite ce “ crime ” méthodologique, qui lèse la majesté de la tradition, tant en histoire de l’art qu’en histoire, classique ou “ nouvelle ”. Une chose est sûre en tout cas : les historiens n’accepteront pas facilement de faire entrer dans leur bergerie le loup de l’anachronisme. Et il est sûr également qu’on ne doit jamais accepter d’aller visiter un musée en compagnie de Georges Didi-Huberman : on risque d’en sortir aussi bien aujourd’hui, après-demain qu’avant-hier. »
Philippe Dagen (Le Monde, 27 octobre 2000)
Les tourbillons du temps
Invoquant Walter Benjamin et Carl Einstein, Georges Didi-Huberman se livre à une critique sans concession de la notion d’histoire. Avec cette certitude en point de mire : sous couvert de parler du passé, toute époque parle d’abord d’elle-même.
« Voici un livre aux travers irritants, à la composition discutable, au titre légèrement grandiloquent – un livre néanmoins remarquable. Il est de ceux dont on sait qu’on les relira pour tout ou partie. De ceux aussi qui exigent à leur endroit une conduite claire, approbation forte ou refus tout aussi fort. Lui-même tranchant, parfois péremptoire, il appelle des réactions non moins tranchées. Sans doute touche-t-il à des questions d’histoire des arts et d’esthétique qui semblent dénuées de toute conséquence sérieuse, mais son premier mérite est de les empoigner de telle façon que leur gravité et leurs conséquences se révèlent avec violence. C’est là une raison suffisante pour penser que Devant le temps est l’un des meilleurs ouvrages de Georges Didi-Huberman et pour le défendre.
Et pourquoi encore ? Parce que les habitudes des historiens de l’art y sont observées et démontées avec une grande dextérité dialectique et les usages qu’ils font de la notion de temps analysés jusque dans leurs a priori avec une énergie polémique rare. Parce que Didi-Huberman refuse que les œuvres soient réduites à des dates et des définitions et leur rend leur densité de pensées devenues visibles. Et aussi parce que l’une des parties du livre, « L’image-combat », est d’une lecture politiquement précieuse aujourd’hui. Ce texte tombe bien, étant donnée la situation actuelle des arts plastiques et des discours qui flottent autour d’eux.
Cette approbation, cette gratitude n’empêchent pas de voir les défauts du volume. Critiquable est la propension de l’auteur à réunir articles et textes de conférences sans s’inquiéter des répétitions auquel ce procédé contraint. Que le remâchement soit le mode naturel de la pensée n’oblige pas à le montrer à nu. Mais Didi-Huberman ne cultive ni l’allusion, ni l’ellipse. Obsessionnel des notes de bas de page, il leste ses textes de bibliographies, citations et autocitations peu utiles.
Tout cela n’a cependant qu’une importance mineure. La dynamique du livre en est ralentie, mais pas arrêtée. Pour commencer, Didi-Huberman y désarticule en tous sens la temporalité historique. On connaît l’espoir increvable des historiens : accéder à une connaissance irréfutable d’un morceau de passé. Il serait ainsi possible de regarder et de comprendre une peinture comme la regardait et la comprenait un contemporain de sa création. À quoi Didi-Huberman rétorque qu’une œuvre ne peut être perçue que sur le mode de l’anachronisme – “ objet de temps complexe, écrit-il, de temps impur : un extraordinaire montage de temps hétérogènes formant anachronismes ”. Il en appelle à une “ archéologie critique de l’histoire de l’art ” et l’applique à ses propres travaux.
Pourquoi avoir prêté attention à des parties des fresques de Fra Angelico à San Marco dénuées de figures que les spécialistes n’avaient pas prises en considération – ce que fit Didi-Huberman pour écrire Fra Angelico. Dissemblance et figuration en 1990 ? Entre autres raisons parce qu’il avait en mémoire les drippings de Pollock. Non qu’il prétende que Fra Angelico serait l’ancêtre de Pollock, ce qui serait absurde. Mais, sans Pollock, il n’aurait pas vu cet Angelico-là : “ L’émergence de l’objet historique comme tel n’aura pas été le fruit d’une démarche historique standard – factuelle, contextuelle ou euchronique –, mais d’un moment anachronique presque aberrant. ” La remarque peut se généraliser : l’historien, tout en s’en défendant frénétiquement, ne cesse de commettre des anachronismes. Il ne peut en être autrement. Didi-Huberman cite à ce propos Marc Bloch : “ À la vérité, consciemment ou non, c’est toujours à nos expériences quotidiennes que, pour les nuancer, là où il se doit, de teintes nouvelles, nous empruntons, en dernière analyse, les éléments qui nous servent d reconstituer le passé (...). ” Voilà qui devrait permettre d’en finir avec l’objectivité, l’histoire positive, le fantasme d’une science exacte. De quelque manière qu’ils s’y prennent, les historiens écrivent un passé à la lumière de leur présent.
Walter Benjamin l’affirme autrement : “ Mais aucune réalité de fait n’est jamais, d’entrée de jeu, à titre de cause, un fait déjà historique. Elle l’est devenue, à titre posthume, grâce à des événements qui peuvent être séparées d’elle par des millénaires. ” Benjamin, “ chiffonnier de la mémoire ”, est l’un des héros de Devant le temps. Didi-Huberman se délecte à circuler longuement, selon des itinéraires sinueux, entre les essais de Benjamin, ses Thèses sur la philosophie de l’histoire et ses analyses d’images, où chacune est comme un motif musical qu’il s’agit d’orchestrer afin qu’il résonne plus loin, plus longtemps, plus fort. Echos sans cesse relancés, sous-entendus multipliés, réminiscences ressuscitées : chaque œuvre, ancienne ou récente, est matière à réflexions, rapprochements, généalogies, retours, réapparitions, entrecroisements.
Celui qui regarde bien une image y découvre des passés et des présents, comme Benjamin dans les planches de botanique photographiées par Blossfedt. “ Il devient clair désormais – observe Didi-Huberman – que l’ouvrage de Blossfeldt aura intéressé Benjamin pour sa structure kaléidoscopique : les formes ne s’y suivent que pour se transformer, les morphologies ne s’y montrent, ne s’y décomposent que pour se métamorphoser. ” Irrésistible plasticité des images, à mettre en rapport avec la plasticité de la pensée de Benjamin, qui “ a mis le savoir, et plus exactement, le savoir historique, en mouvement ”.
Cari Einstein met ce même savoir et ces mêmes images en ordre de bataille. Figure centrale de « L’Image-combat », le romancier et critique allemand n’a bénéficié jusqu’ici en France que d’une attention beaucoup trop restreinte en dépit des efforts et des traductions de Liliane Meffre. Or cet ami de Kahnweiler et de Bataille, ce mentor de Leiris, cet analyste de l’art nègre et de l’art moderne, cet antinazi qui combattit en Espagne et se suicida en 1940 – comme Benjamin – a maintenu sans faiblir sa pensée et ses actes au plus haut degré de la lucidité et du courage.
Didi-Huberman, qui lui consacre une analyse-hommage justement passionnée, cite de lui ces mots : “ Il est évident que la confection des œuvres d’art comporte beaucoup d’éléments de cruauté et d’assassinat. Car toute forme précise est un assassinat des autres versions (...). ” Et ceci : “ Les images ne possèdent un sens que si on les considère comme des foyers d’énergie et de croisements d’expériences décisives. (...) Les œuvres d’art n’acquièrent leur véritable sens que grâce à la force insurrectionnelle qu’elles renferment. ” Il n’est pas mauvais – euphémisme – que, par nos temps de mollesse éclectique généralisée, un auteur fasse réentendre de tels aphorismes. Que cet auteur ait écrit sur Simon Hantai et Pascal Convert, des vivants, accroît la force de sa position. Benjamin et Einstein, ainsi traités, ne sont plus des autorités de bibliothèque, mais des contemporains essentiels. En se faisant leur truchement pour aujourd’hui, Didi-Huberman fait œuvre nécessaire. »
Rencontre
Du même auteur
- La Peinture incarnée, 1985
- Devant l’image, 1990
- Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, 1992
- L’Étoilement, 1998
- Phasmes, 1998
- La Demeure, la souche, 1999
- Devant le temps, 2000
- Être crâne, 2000
- Génie du non-lieu, 2001
- L’Homme qui marchait dans la couleur, 2001
- L’Image survivante, 2002
- Images malgré tout, 2004
- Gestes d’air et de pierre, 2005
- Le Danseur des solitudes, 2006
- La Ressemblance par contact, 2008
- Quand les images prennent position, 2009
- Survivance des lucioles, 2009
- Remontages du temps subi, 2010
- Atlas ou le gai savoir inquiet, 2011
- Écorces, 2011
- Peuples exposés, peuples figurants, 2012
- Blancs soucis, 2013
- Phalènes, 2013
- Sur le fil, 2013
- Essayer voir, 2014
- Sentir le grisou, 2014
- Passés cités par JLG, 2015
- Sortir du noir, 2015
- Peuples en larmes, peuples en armes, 2016
- Passer, quoi qu'il en coûte, 2017
- Aperçues, 2018
- Désirer désobéir, 2019
- Eparses. Voyage dans les papiers du ghetto de Varsovie, 2020
- Imaginer recommencer, 2021
- Le Témoin jusqu'au bout, 2022
- Brouillards de peines et de désirs, 2023
- La Fabrique des émotions disjointes, 2024
- Les Anges de l'Histoire, 2025
Livres numériques
- Atlas ou le gai savoir inquiet
- Écorces
- Blancs soucis
- L’Étoilement
- Sur le fil
- Essayer voir
- Sentir le grisou
- Sortir du noir
- Devant l’image
- Gestes d’air et de pierre
- La Peinture incarnée
- Le Danseur des solitudes
- Survivance des lucioles
- Passer, quoi qu'il en coûte
- Aperçues
- Désirer désobéir
- Eparses. Voyage dans les papiers du ghetto de Varsovie
- Imaginer recommencer
- Le Témoin jusqu'au bout
- Brouillards de peines et de désirs
- La Fabrique des émotions disjointes
- Les Anges de l'Histoire
