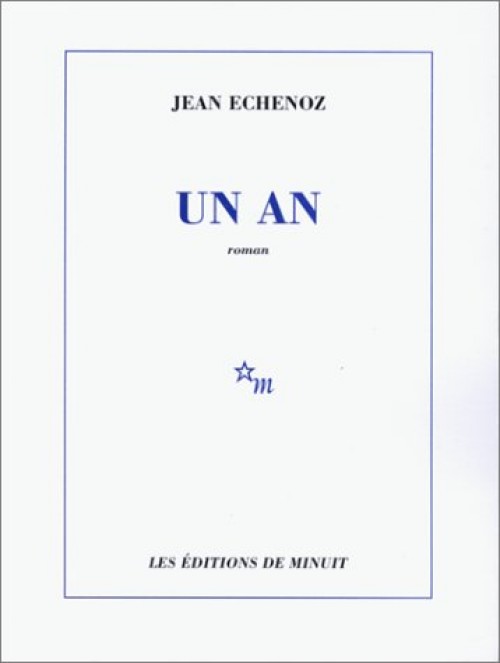
Jean Echenoz
Un an
1997
112 pages
ISBN : 9782707315878
16.00 €
99 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
N’étant que trop sûre d’avoir provoqué la mort de Félix, Victoire aime autant s’éloigner. Où qu’elle se trouve alors, Louis-Philippe passe l’informer de temps en temps des suites de cette affaire. Or Louis-Philippe ment.
ISBN
PDF : 9782707323798
ePub : 9782707323781
Prix : 6.49 €
En savoir plus
Éric Reinhardt (Les Inrockuptibles, 5 mai 1997)
Victoire chez les SDF
Avec son nouveau roman, Un an, ou l’histoire d’une victoire qui se perd, Jean Echenoz fait sa première incursion dans le domaine du réalisme social. Mais comme nous sommes tout de même chez Echenoz, cette chronique de la métamorphose a l’air revisitée par Alfred Hitchcock, et le réel – pour présent qu’il soit – semble le produit d’un cervau dérangé.
« Un an débute comme toutes les sales histoires, c'est-à-dire abruptement, et s'articule ensuite sur le mode du cauchemar tranquille : Victoire s'éveille un matin et découvre à ses côtés le cadavre de Félix, son compagnon.
Comme il n'en faut pas plus pour mettre en branle le train rapide du mauvais rêve, la sixième ligne du livre surprend Victoire grimpant dans un taxi, la onzième ligne la voit franchir les portes de la gare Montparnasse, la quarantième nous la décrit dans les couloirs d'un train. N'ayant aucun souvenir de la soirée, Victoire redoute d'être accusée ; elle est jolie, jeune, brune, élégante – nous révèle un miroir de la SNCF –, et transporte dans son sac l'ensemble de ses économies. Victoire échoue à Saint-Jean-de-Luz, passe une nuit dans un hôtel, loue une maison meublée dans un quartier résidentiel désert, le long d'un golf et face à la mer. Une atmosphère de volets blancs rouillés, de bars fermés, d'appartements vacants, de plages désertes profondément griffées par les tracteurs qui les ratissent imprègne la ville et ses panoramas maritimes – métaphore efficace de l'amnésie de Victoire, du vide étrange qui semble régner dans sa tête, celle-ci n'étant plus qu'une sorte de Saint-Jean-de-Luz hivernal. Elle lit la presse, espérant y trouver des détails sur la mort de Félix, hésite à sortir pendant la journée, déambule sur la plage, passe le plus clair de son temps cloîtrée chez elle – dans une maison dont l'étrangeté renforce encore l'atmosphère inquiétante du récit. On pense à Psychose, depuis le début du livre, à Janet Leigh en fuite réfugiée dans un motel, et l'on redoute à chaque ligne une terrible transposition échenozienne de l'épisode de la douche. À l'exemple des violons menaçants d'Herrmann, le compositeur d'Hitchcock, L’écriture étrangement précise d'Echenoz et ses digressions dérisoires désignent à tout instant l'imminence d'un événement cruel : la sonnette retentit dans la maison vide, Victoire entend des bruits non identifiables, son meilleur ami débarque comme un fantôme, lui conseille de rester cachée puis s'éloigne – sans même avoir éteint le moteur de sa Fiat. Dans quelle étrange cervelle nous sommes-nous aventurés ? Quel dénouement cette longue attente irréelle annonce-t-elle ? À quelle sauce Echenoz va-t-il dévorer son héroïne ? Il sera moins expéditif qu'Hitchcock, en l'occurrence, et plus sadique, on peut même dire que le livre entier fait office de cabine de douche, car ce à quoi l'on a commencé d'assister est l'histoire d'une mort affreusement lente, d'un assassinat social, le récit du processus qui conduit une jeune femme ordinaire au statut de sans-domicile fixe.
Il suffira en effet d'un amant sans scrupules projeté par le romancier dans les bras de Victoire pour que celle-ci, dévalisée, fasse un bond de six mois sur le calendrier : avec seulement 10 000 F en poche, la voici désormais en lisière du vagabondage. De fait, peu de pages plus tard, Victoire achète une bicyclette, allège son sac, renonce aux hôtels confortables, déjeune et dîne dehors. La trajectoire du livre, qu'on avait prise initialement pour une ligne droite, un trait tragique tiré à la règle, est en fait une spirale : page 56, Victoire dormira à la belle étoile. Et comme on l'imagine alors avec effroi, le processus de clochardisation est amorcé.
Bien entendu, il est possible de lire Un an comme une contribution d'Echenoz à la dénonciation sociale ambiante. On sent dans cet ouvrage, en filigrane, une conscience politique aiguë, une inquiétude et des sentiments critiques à l'égard de notre époque – comme lorsque Echenoz dénonce explicitement la législation interdisant la présence des SDF dans certaines villes. Jamais à ma connaissance, il n'avait fait référence dans l'un de ses livres à un fait d'actualité aussi précis, et cette incursion est significative. Notre époque et ses travers imprègnent la prose d'Echenoz depuis son premier livre, certes, le vagabond est une figure récurrente de son univers, une composante esthético-métaphysico-beckétienne qu'il affectionne, mais cette fois-ci il n'en importe pas l'archétype dans sa narration : il fabrique un SDF de toutes pièces. Et, ce faisant, Echenoz en investit la réalité humaine et sociale, nous fait comprendre qu'il ne s'agit pas d'une maladie individuelle mais d'une gangrène de tout le système. On le savait déjà, bien entendu, à ceci près que le roman présente sur le discours politique l'immense avantage de pouvoir nous faire frémir. Cela étant, Un an n'est pas réductible à cette seule dimension sociale. C'est même tout le contraire d'un livre réaliste, en ce sens que la réalité qu'il décrit semble émaner d'un cerveau malade. Par certains côtés, on pourrait dire qu'Un an est un récit mental – comme peuvent l'être Le Voyeur, le livre de Robbe-Grillet, ou Lost highway, le film de David Lynch. Un an s'élabore autour d'un trou noir – la mort de Félix –, Victoire n'y pense qu'épisodiquement, n'éprouve aucune tristesse, ne cherche aucune explication plausible à cette disparition et à sa fuite. Alors même qu'il conviendrait d'étudier un instant la nature et les conséquences de cette situation, Echenoz décrit la fantasmagorie des nuages, le contenu des tiroirs des commodes, le bruissement des balles de golf dans les hautes herbes du jardin. Victoire se comporte effectivement comme Janet Leigh dans Psychose, à cette différence près qu'elle est innocente – c'est l'évidence même. En revanche, Victoire ne serait-elle pas coupable d'avoir souhaité la mort de Félix, s'interroge alors le lecteur, de l'avoir souhaitée à tel point qu'elle disjoncte, qu'elle n'est plus capable d'assumer cette pensée inconsciente et sa culpabilité refoulée ? Félix n'était-il pas tout simplement en train de dormir – la bouche légèrement entrouverte – lorsqu'elle s'est réveillée ? Echenoz nous raconterait-il l'histoire d'un effondrement maniaco-dépressif ? Un an serait-il un livre aussi terrible, hors champ, en aval de la première ligne, que les premières scènes de Lost highway – tableau sordide d'un couple à la dérive ? Echenoz, d'ailleurs, semble nous orienter sur cette voie : “ Enfin voilà, conclut-elle, j’ai l'impression de m’être perdue. Ce n'est pas forcément plus mal, dit Poussin. Si nous ne nous perdions pas, nous serions perdus. ”
Cette hypothèse d'un égarement mental circonstanciel est d'autant plus tentante qu’Un an s'impose comme un beau livre sur le refoulement – un refoulement du mental et du monde, celui-ci nous apparaissant comme bizarrement lacunaire : le monde est là, sous nos yeux, réaliste, mais il manque la moitié des choses, L’inventaire est incomplet – comme un appartement à moitié déménagé. Echenoz excelle dans cet exercice de déréalisation, jamais son attention portée aux détails les plus infimes de l'existence ne s'était trouvée justifiée à ce point par la nécessité intrinsèque d'un récit, et jamais sans doute il n'était allé aussi loin. Alors que le fantasme le plus communément partagé par les écrivains est celui d'atteindre à l'universel en s'emparant des thématiques les plus nobles, Echenoz déploie son talent et l'acuité lumineuse de son style sur les bas morceaux : lorsqu'il décrit le bruit produit par une sonnette quand on est dans son bain, on se dit que c'est exactement ça – et ses phrases nous confondent. Ne vous est-il jamais arrivé de chercher des balles dans des buissons ? Voici : “ Victoire, ayant enfin compris l'origine des bruits anonymes qui l'intriguaient depuis son arrivée, découvrit les semaines suivantes d'autres balles dans le jardin. (…) Son œil s'étant habitué à discriminer les petites sphères blanches à peau d’agrume, chacune semblait dès lors en engendrer une autre comme si leur forme, une fois identifiée, permettait de les reconnaître indéfiniment. ” Et ceci : “ Elle essaya d'agiter ses lèvres, si sèches au demeurant qu'elles paraissaient des croûte grumeleuses et racornies, corps étrangers à sa personne. ” Echenoz nous donne aujourd'hui, avec Un an, un livre intense qui nous console de la virtuosité un peu vaine de certains chapitres de Nous trois et des Grandes blondes, ses deux précédents livres. Victoire restera dans notre souvenir comme une amie touchante et chère, une sœur – Echenoz s'affirmant une fois de plus, après les aventures poignantes de Gloire Abgral publiées l'année dernière, comme l'un des subtils explorateurs du comportement féminin. »
Renaud Matignon (Le Figaro, 20 mars 1997)
Echenoz : des mythologies en baskets
« Victoire va prendre le train. C'est à la gare Montparnasse. Le temps est “ assez froid pour élargir les carrefours et paralyser les statues ”. Le train va à Bordeaux, d'où elle en prendra un autre pour Saint-Jean-de-Luz. Ah, oui ! on oubliait : si elle quitte Paris, c'est qu'elle a découvert, au petit matin, près d'elle, dans leur lit, mort, Félix. Elle ne se rappelle rien de la soirée ni du rôle qu'elle a pu y jouer. Le paysage, par la fenêtre, évoque une immense banlieue, comme une phrase dénuée de sens dont il ne resterait que la ponctuation. On dirait que le monde a quitté les personnages de Jean Echenoz, comme une femme verrait son ombre se séparer d'elle, reprendre sa liberté, n'en faire qu'à sa tête.
On est saisi, dès la première page, par le très court récit de Jean Echenoz, un peu comme on est saisi par le froid ou par la pluie : il raconte des choses étranges et graves, sur le ton narquois, précis et détaché dont on relate une fuite de gaz ou une panne d'ascenseur, au tabac du coin. Cette étrangeté familière ne laisse pas de répit au lecteur. Un an – c’est le titre du roman – est un des très rares livres dont il faille se contraindre à ralentir la lecture. Car, dans cette écriture brève et dense, chaque phrase est noire et jaune, bizarrerie et poésie, et porteuse elle-même de cette précision hagarde qui éclaire l'aventure singulière de Victoire. Plus que dans ses précédents livres sans doute, Jean Echenoz a trouvé le point de rencontre entre la perfection du naturel et le comble de l'artifice.
C'est qu'ils ressemblent à tout et à rien, ces bougres de personnages. Ils ont des noms de caissières de grandes surfaces, de plombier ou de roi : Victoire, Félix, Louis-Philippe. Des valises toutes bêtes, avec un magazine un linge de rechange et une brosse à dents. Ils titubent tranquillement dans le métaphysique, comme on manie un tournevis. Victoire a vidé son compte en banque des quelque 50 000 F qu'elle y possédait encore, et elle s'installe dans une bicoque de location, sur la côte basque, après une entrevue avec Noëlle, “ sa propriétaire qui, appelez-moi Noëlle, lui dessina les grands traits de sa vie ”. Ce genre de raccourci, plaisir de gastronome, fourmille chez Echenoz, entre le propos de table et le grand art.
Dans cet univers quasi anthropométrique, le chimérique et l'invraisemblable frappent à la porte comme des voisins de palier. Recluse, par peur des recherches, ou d'une culpabilité ignorée d'elle-même, Victoire n'a prévenu personne, et voici pourtant que débarque Louis-Philippe, dans sa petite voiture blanche, salut je ne fais que passer. Victoire ne s'étonne pas : elle s'est installée dans sa propre absence.
Elle va peu à peu s'enfoncer dans la misère, et dans une hallucination où l'ordinaire et l'extraordinaire ne savent sur quel pied danser. Elle rencontrera Gérard, qui lui volera son argent puis la retrouvera plus tard. Pas de commentaires non plus. Elle reverra aussi Louis-Philippe, alors qu'elle a soigneusement caché son dernier point d'errance. Elle ne fait pas la moindre déclaration, ne manifeste pas d'émotion ni de surprise. “ Victoire est ainsi, écrit l'auteur, comme il faut bien parler quand on rencontre du monde, elle s'en sort en posant des questions ”. Quel est son destin ? A-t-elle des chaussettes pour demain ? Il n'y a pas de différence de nature, pour elle, pour Jean Echenoz, pour nous peut-être, entre ces deux questions. Où est passé le réel ? C'est peut-être une des grandes questions de notre fin de siècle que pose M. Echenoz, qui fait claudiquer, sous les dehors de clochards et de pauvresses, des mythologies en baskets.
Quand, après avoir touché le fond du dénuement et de la clochardisation, elle reverra Félix – mais oui – en compagnie d'une autre femme, et qu'elle apprendra que Louis-Philippe, qu'elle a vu il y a deux mois, est mort depuis un an, Victoire ne posera pas davantage de questions – “ ce qui eût risqué d'infléchir l'ambiance ”. Elle n'invoquera pas la fatalité, L’amour, ou d'autres grandes choses de ce genre. Les grandes choses sont aussi minuscules que tout le reste. L'univers est microscopique. L'humour le découpe en petite phrases fines comme des notes d'harmonica. Victoire se faufile entre ces phrases et entre ces visages, et elle les traverse comme des rues dont on n'atteindrait jamais le trottoir. Elle bute parfois sur “ un bâtiment sourd-muet ” ou sur “ un salon résigné ”, qu'elle paie 3 600 F par mois. Et puis, elle poursuit son itinéraire – “ le trajet brisé d'une mouche enclose dans une chambre ”. Rimbaud l'avait bien dit : “ On ne part pas. ” Nos destins de poussière ne pèsent pas lourd et voyagent peu. Victoire est posée sur le monde comme une bulle de savon. Nous aussi, peut-être. »
Du même auteur
- Le Méridien de Greenwich, 1979
- Cherokee, 1983
- L’Équipée malaise, 1987
- L’Occupation des sols, 1988
- Lac, 1989
- Nous trois, 1992
- Les Grandes blondes, 1995
- Un an, 1997
- Je m'en vais, 1999
- Jérôme Lindon, 2001
- Au piano, 2003
- Ravel, 2006
- Courir, 2008
- Des éclairs, 2010
- 14, 2012
- Caprice de la reine, 2014
- Envoyée spéciale, 2016
- Vie de Gérard Fulmard, 2020
- Les éclairs, Opéra, 2021
- Bristol, 2025
Poche « Double »
- L’Équipée malaise , 1999
- Je m'en vais , 2001
- Cherokee , 2003
- Les Grandes blondes , 2006
- Lac, 2008
- Nous trois , 2010
- Un an, 2014
- Au piano, 2018
- Envoyée spéciale, 2020
- Vie de Gérard Fulmard, 2022
- 14, 2024
Livres numériques
- Cherokee
- Courir
- Des éclairs
- Je m'en vais
- Jérôme Lindon
- L’Équipée malaise
- L’Occupation des sols
- Lac
- Le Méridien de Greenwich
- Les Grandes blondes
- Nous trois
- Ravel
- Caprice de la reine
- Un an
- Au piano
- Envoyée spéciale
- Vie de Gérard Fulmard
- Les éclairs, Opéra
- Vie de Gérard Fulmard
- 14
- Bristol
