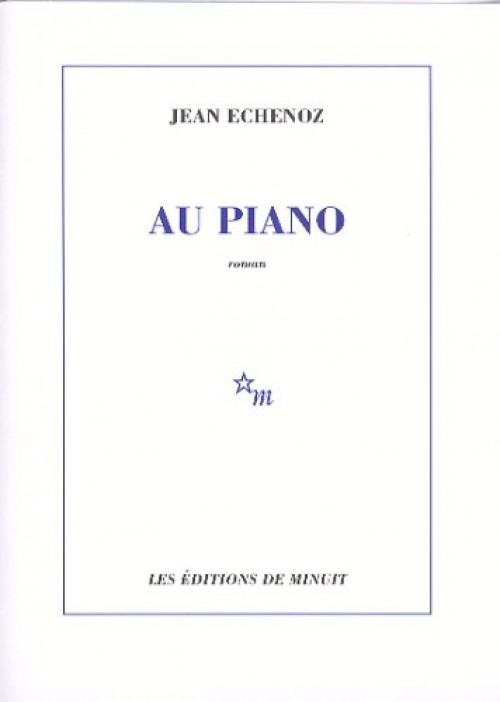
Jean Echenoz
Au piano
2003
224 pages
ISBN : 9782707318121
18.00 €
99 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
La pratique professionnelle du piano suppose une discipline stricte. Elle exclut tout divertissement susceptible d'éloigner l'artiste de son clavier. Pourtant il aimerait, lui aussi, jouir de la lumière du monde, de la douceur de vivre, de la tiédeur de l'air et de l'amour des femmes. Eh bien non : mort ou vif, le pianiste se doit d'abord à son public.
ISBN
PDF : 9782707344366
ePub : 9782707344359
Prix : 7.49 €
En savoir plus
Jean-Pierre Tison (Lire, février 2003)
Attention aux revenants
Dans quelle dimension sommes-nous ? Dans quelle géhenne nous entraîne Max, le pianiste timide au cœur en berne ? Comme à son habitude, Echenoz brouille les pistes et la réalité avec un art consommé de l'escamotage et de la résurrection.
« L'au-delà est un milieu casse-gueule. On a vu plus d'un créateur y perdre sa réputation. D'ores et déjà, Jean Echenoz fait partie des rescapés. Plébiscité pour ses prouesses acrobatiques – qui lui ont valu prix Médicis et Goncourt, tirages astronomiques, multiples traductions, critique unanime et public ravi, le virtuose se lance un nouveau défi. Les disparitions, résurrections et réincarnations opérées dans ses romans précédents par déguisement, maquillage, faux papiers et autres escamotages dépassent cette fois le savoir-faire des officines humaines. Si ses personnages ont souvent disparu, loin, très loin, dans une autre vie, sous un autre avatar, jamais fiction ne les avait aspirés aussi haut que dans Au piano. Ce roman nous entraîne vraiment dans une autre dimension : au-delà de la mort.
Ce qui se passe de grotesque au-delà de la mort, et qui ne fait pourtant pas rire l'amateur de littérature religieuse ou fantastique, aurait de quoi rebuter le lecteur habituel de Jean Echenoz. On pourrait donc penser que, de la même manière qu'il a parodié les polars ou les livres d'espionnage, il a fait son miel du suspense surnaturel. Ce n'est pas si faux. Ni si simple.
On tourne autour du pot parce qu'on veut à tout prix que les coups de théâtre d'Au piano demeurent des surprises pour le lecteur. Révélons quand même le début : ce qui rend infernale l'existence de Max Delmarc, héros de ce roman, c'est le trac. Or, il est pianiste. Et célèbre. Autre enfer : la timidité. Or, il adore les femmes. Et pour vaincre ces deux handicaps, il s'enfonce dans une troisième damnation : la boisson. L'incapacité à saisir le bonheur qui se présente l'a fait souffrir très tôt. Étudiant au conservatoire, il était secrètement amoureux d'une étudiante “ trop belle pour lui ”, Rose, violoncelliste. Il s'installait chaque jour à la même heure à la terrasse de café où elle avait ses habitudes. Il la voyait toujours en grande conversation avec un barbu. Ses études terminées, elle était partie Dieu sait où. Rencontrant un peu plus tard le barbu, celui-ci avait alors dit à Max que Rose n'avait fréquenté quotidiennement ce café que pour le voir, lui, Max, dont elle était amoureuse... Trente ans après, Rose hante tellement Max qu'il croit souvent l'apercevoir. Et il part illico à sa poursuite. Rien ne dit qu'il ait la berlue. Le spectre de Rose peut parfaitement évoluer dans Paris incognito. Max fera lui-même bientôt cette expérience. Mais c'est déjà en dire trop. Aux séismes, chutes, collisions, agressions qui rendent ses livres si mouvementés, M. Echenoz ajoute donc cette fois une déstabilisation encore plus fatale, pour laquelle il avait tâté le terrain dans Les Grandes blondes. Il y avait introduit une créature d'un autre monde, un ange gardien à l'apparence de gnome et au nom de démon, Béliard. Dans Au piano, c'est ainsi que s'appelle un élégant quidam, également ange gardien, à sa façon. Un autre nom provient des Grandes blondes, Paul Salvador.
Le mot Malice, qui définit si bien le prodigieux talent de Jean Echenoz, est à prendre dans son acception diabolique. Il y a du “ grappin ” dans son art. Impossible de s'arracher à son emprise. Du parc Monceau à un autre parc, plus vaste et plus magique, se succèdent les notations cocasses. Ainsi nous fait-on observer que des jeunes femmes d'origines très variées déclament toutes sur le même ton un “ alexandrin parfait, classiquement balancé avec césure à l'hémistiche : C'est quinze euros la pipe et trente euros l'amour ”. Mais, pour revenir au “ fond ”, rien ne prouve qu'on ait vu juste en croyant que ce roman nous entraînait au-delà de la mort. Car, la mort, c'est vite dit. Une soudaine dépression, un licenciement sont autant de façons de “ disparaître ”. Sortir d'une maison de repos ou d'une agence pour l'emploi fait de vous un revenant à l'impeccable transparence. Avec la crise économique, la fabrique de fantômes tourne à plein rendement. Sans que le “ premier degré ” perde son attrait, on peut voir aussi dans Au piano une allégorie de la puberté. Du passage à l'âge adulte. La vie d'amour, la vie d'artiste dont rêve le puceau, en proie à une peur intense, cède brutalement la place à la vraie vie, parmi les “ vraies gens ”. Et à une trouille plus éparse. Enfin, libre à chaque lecteur d'interpréter sur son piano intérieur la partition échenozienne, en y ajoutant transcendance et symboles de son choix. En tout cas, s'il est un enfer que l'écrivain rend reconnaissable avec un réalisme impressionnant, c'est bien celui de la pauvreté. Ici-bas, nul besoin de flammes ni de glace : être dans la géhenne, c'est être dans la gêne. Tel Max, dans une veste usagée de barman, dans une chambre de service “ avec douche collective et toilettes sur le palier ”, dans les corvées domestiques ou dans les bras d'une réceptionniste informe promue “ grande blonde ” par défaut. Dans l'obscure impasse qui tient lieu de destinée à la plupart des hommes, combien de coups de foudre pour si peu d'éclairs ! Combien de frottements pour si peu d'étincelles ! Heureusement que parfois Jean Echenoz passe par là ! Cet as de la voltige sait conduire les vies les plus plates au bord du vertige, ménager volontairement des temps morts pour les remplir avec une invention étourdissante. Et nous éblouir d'ironie, d'humour, de drôlerie sans jamais manquer de fraternité avec les âmes en peine. »
Chistophe Kantcheff (Politis, 23 janvier 2003)
Des deux côtés du miroir
Dans Au piano, Jean Echenoz entrelace le réel et l'imaginaire. Un roman délicieusement riche.
« L'un des clichés les mieux répandus à propos des “ bons ” écrivains consiste à louer leur regard d'une précision chirurgicale sur les mœurs de nos contemporains ; leur regard serait “ d'entomologiste ”. Jean Echenoz s'apparenterait davantage à un topographe, attaché à décrire les reliefs et la configuration des lieux où se trouvent ses personnages, et comment ils s'y affairent. Un topographe au sourire en coin. On se souvient d'une nouvelle publiée en 1988 dont le titre pourrait convenir à son œuvre entière, L'Occupation des sols. “ ...Et des airs ”, faut-il seulement ajouter pour Au piano.
Relever les nouveaux territoires explorés par Au piano n'est donc pas un petit jeu gratuit. Par exemple, dans Paris, au début du roman, Jean Echenoz emmène ses personnages dans le parc Monceau. Ses personnages : Max Delmare, la cinquantaine, bien habillé, “ mort de peur ”, on ne sait pas encore pourquoi ; Bernie, plus jeune mais moins chic, pour qui le parc est truffé de pièges à éviter pour assurer la protection de Delmarc dont il est chargé. Il lui faut ainsi éloigner Delmarc des débits d'alcool – trop attractif pour lui, aux conséquences incertaines – et... de la statue de Frédéric Chopin !
Cette vision du parc Monceau et de ses dangers n'appartient qu'à Echenoz. Elle nous est presque étrangère, insolite, sauf à être pianiste virtuose soi-même, et à avoir déjà tourné dans le parc, en proie à un trac terrorisant, avant de donner un concert aux salles Pleyel ou Gaveau toutes proches, avec au programme le Concerto n°2 en fa mineur, op. 21, de Frédéric Chopin. Ce qui est justement le cas de Max Delmarc, En outre, comme à son habitude, l'auteur ne lésine pas sur la cocasserie ou l'ironie, ce dont on ne peut que le féliciter. Exemple : “ Mais regardez un peu, monsieur Max, comme c'est beau, s’enflamma-t-il. Le monde est beau. Le monde est beau, vous ne trouvez pas ? Sans ralentir le pas ni lui répondre, Max feignit de jeter un coup d'œil sur le monde et haussa légèrement les épaules. Bon, dit Bernie d'un ton penaud, d'accord. Convenez quand même qu'il est bien éclairé. ”
La même singularité caractérise l'exploration de la ligne 6 du métro, qui relie Étoile à Nation par le sud, en grande partie aérienne. L'inventaire hétéroclite de ce qui défile comme en travelling devant les yeux de Delmarc répond à sa désolation, à l'élan désespéré qui l'a fait monter dans la rame pour rattraper la femme aimée qu'il a ratée, il y a trente ans, et qu’il croit apercevoir un peu partout depuis. Max Delmarc est un homme profondément seul, sans doute le personnage d'Echenoz dont la solitude est la plus grande. Qui n'a eu de relation intense qu'avec son piano. Leur confrontation quotidienne est celle de tout artiste avec sa matière, tel l'écrivain avec la langue. Ce n'est pas toujours une sinécure : “ (Max) se tient devant son clavier dans un état fébrile d'excitation, de découragement et d'anxiété mêlés. ”
On ne révélera rien ici de l'intrigue, la surprise étant l'un des ressorts de l'écriture et de la narration echenoziennes, et une source permanente de plaisir pour le lecteur. Disons seulement que dans le deuxième tiers d'Au piano, Delmarc, qui n'est plus exactement lui-même, bascule dans un univers fantasmagorique. Il se retrouve dans un étrange établissement avec de mystérieux pensionnaires, surveillé par un drôle de type au nom maléfique, Béliard, et dont la description relève du même réalisme humoristique et décalé que celles du parc Monceau ou des stations de métro. S'ajoute au trouble l'organisation en miroirs du récit, assez caractéristique des romans de Jean Echenoz (cf. Un an, publié en 1997). Ainsi Doris Day et Dean Martin, qui semblent être en chair et en os dans cet établissement, avaient été déjà vus par Delmarc auparavant, dans son domicile parisien, sur l'écran de son téléviseur qui diffusait un film avec les deux acteurs, Artists and Models. Ou encore la très réelle voisine de Delmarc, qui l'attirait beaucoup, est qualifiée par le narrateur de “ surnaturellement belle ”... Alors, comment démêler les souvenirs du présent, les morts des morts-vivants dans un univers où le réel peut être l'imaginaire et réciproquement ? C'est un des enseignements précieux que vient rappeler Au piano, roman délicieusement riche : plus le spectre des représentations sur lequel joue l'auteur est large, plus la littérature a de chance de produire du sens. L'injonction contemporaine sur la nécessité de la littérature de s'emparer du réel, et seulement du réel, risque de déboucher sur des œuvres hémiplégiques. Jean Echenoz suggère bien mieux la complexité du monde en y incluant sa face inventée. »
Patrick Kéchichian (Le Monde, 17 janvier 2003)
Echenoz, dense avec légèreté
Avec Au piano, un livre euphorique et méticuleux, le Prix Goncourt 1999 démontre à nouveau qu'il sait jouer, avec un art de haut vol, des registres, en apparence contradictoires, de la gravité et de la drôlerie
« On est en terrain de connaissance. Du moins le croit-on. Avec une certaine insouciance, avec même une sorte de foi que chaque livre assure davantage, on attend le bénéfice promis. Bénéfice simple, élémentaire, sans ombre, qui éclaire (et même éclaircit) l'esprit. Dès la première page, presque dès la première phrase, le plaisir s'installe. Raffiné. Stylé. On se félicite. On est heureux.
Jean Echenoz est donc une valeur sûre, presque ancienne à présent. Depuis 1979 et Le Méridien de Greenwich, en une dizaine de romans, il a fait ses preuves. Et même les jurys des prix littéraires n'ont pas tardé à le reconnaître, par deux fois (1). C'est dire. Mais en même temps, car rien n'est si simple, car l'ombre est partout, ce terrain apparaît moins familier, moins balisé qu'on ne le pensait. En fait, bien vite, on ne sait plus où l'on est. Le plaisir est bien là, mais il est mélangé. Pas réduit, pas arrêté : mélangé. Et de quoi donc ? d'émotion inquiète, d'angoisse lointaine et informe, de certitude vacillante, d'infimes fêlures dans la trame de la réalité. Tout cela, Au piano, dernier opus d'Echenoz, le montre et le cache, le révèle comme une évidence et le met en énigme. Magnifiquement.
Max Delmarc est pianiste. Un pianiste angoissé justement, flanqué d'un acolyte-garde du corps et factotum, Berme, et d'un impresario à “ la silhouette massive et dégarnie ”, Parisy. Il y a aussi quelques femmes, certaines en chair et en os, une autre, Rose, à l'état de souvenir dont Max poursuit le fantôme sur la ligne 6 du Métropolitain. L'action commence autour du parc Monceau à Paris. Une action bien délimitée, du moins quant à son issue provisoire : Max va mourir dans vingt-deux jours, comme il est d'emblée précisé – Echenoz est un écrivain de haute précision. En attendant, il vaque à ses occupations de concertiste, négociant, avec force boissons alcoolisées, les anxiétés afférentes. Au bout de 86 pages, il meurt donc, d'un mauvais coup de couteau ; le tiers du roman est à peine dépassé. “ Non, pas d'élévation, pas d'éther, pas d'histoires. Il semblait qu'une fois mort, Max continuât de ressentir les choses. ”
La deuxième partie a pour cadre un établissement étrange, mi-hôpital mi-prison de luxe, quelque chose entre Tati et Kafka. Au déroulement de la narration, aux anachronismes dont le héros est victime (ou bénéficiaire) et à quelques autres détails de géographie céleste, on aura reconnu le purgatoire. Laissons au lecteur le soin, et surtout le bonheur, de découvrir lui-même l'enchaînement accéléré des faits, jusqu'à l'épilogue, dont on ne sait pas s'il relève “ de la justice immanente ou de la névrose de destinée ”.
Revenons à ce qu'il faut nommer la méthode. La méthode Echenoz. Elle désigne une certaine manière de construire le roman à l'aide de quelques éléments narratifs disparates et surtout à partir de son unité de base, qui est aussi son unité de valeur : la phrase. Une phrase conçue, construite, travaillée avec un art inégalable – rappelons que le maître de Jean Echenoz reste Gustave Flaubert –, une phrase qui pense, qui raconte, qui respire. Il en est de plusieurs sortes.
Descriptive et presque objective, au début du chapitre 11 : “ Bel-Air est une station aérienne isolée entre deux tunnels, une île qui surplomberait en oasis la rue du Sahel dépeuplée. ” Toujours descriptive, mais déjà beaucoup moins objective (chapitre 16) : “ Plus vide encore que d'habitude, le couloir de son étage rendait un écho glaçant d'internat désert pendant les congés scolaires, quand tous les autres sont partis dans leur famille et qu'on reste seul avec le personnel, qu'on soit puni ou orphelin. ” (Ne vous sentez-vous pas immédiatement ce “ puni ” ou cet “ orphelin ” ?) Active, ou même éruptive (fin du chapitre 17) : “ C'était encore Doris qui entra sous un prétexte futile, prétendant que les femmes de service y avaient oublié quelque chose puis se retournant fougueusement vers Max et, contre toute attente, lui tombant dans les bras. ” (Doris, c'est Doris Day bien sûr, “ embaumant plus que jamais le végétarisme et la science chrétienne ”, comme plus loin, c'est Dean Martin en personne qui intervient, déguisé en valet de chambre désinvolte...) Synthétique et destinée à qualifier un temps sans le détailler lourdement (chapitre 22) : “ Il eut des coups de cafard, il eut des jours d'ennui, de cet ennui trop lourd qu'engendre le mariage de la solitude avec les petits moyens. ” En forme d'apophtegme indépassable (chapitre 11) : “ Une salle de bain un petit peu sale a toujours l'air plus sale que n'importe quelle non-salle de bain beaucoup plus sale. ”
On pourrait multiplier les exemples et les catégories. On pourrait insister également sur la ponctuation, la soustraction des guillemets, les chevilles, souligner l'usage de l'onomastique (“ ... Ah toutes les fois dans une vie qu'on doit écrire son nom. ”), de la citation et de l'autocitation (Les Grandes Blondes, roman de 1995, par exemple), interpréter ce tissage presque invisible de la narration qui relie un livre à l'autre... Il faudrait aussi observer le temps des verbes, le tremblement des pronoms et celui du narrateur (ainsi, au début du chapitre 9, lorsqu'il apostrophe le lecteur), relever les licences bien tempérées dans la partition grammaticale...
Mais il serait parfaitement injuste de faire de Jean Echenoz un formaliste obsédé par la combinaison des mots et le pur agencement des phrases. Pour faire naître le plaisir, et pour le mélanger comme il convient, l'histoire, avec son temps et ses lieux, demeure, classiquement, l'élément essentiel. C'est à son service que le romancier, avec un scrupule extrême et une non moins extrême jubilation, met tous ses moyens. Et il n'en manque pas. En passant, il détourne à son profit et au nôtre quelques genres traditionnels comme le roman d'aventures, de voyage ou d'espionnage.
Une sorte de faux monde naît ainsi sous la plume du raconteur euphorique et méticuleux. Non pas un monde de simple gratuité concocté pour nous distraire et nous éloigner de ce qui vaut et importe – on accusa un jour Echenoz d'être le promoteur de ce type de distraction inoffensive –, mais comme un envers du nôtre. Non pas son imitation mais sa reconstruction, son invention. L'humour, dont nous avons ici l'un des maîtres actuels, renforce notre surprise et conforte notre plaisir. Mais la drôlerie peut être inquiétante. Un trouble s'insinue. Dans le monde de fiction qui est celui de Jean Echenoz, la pesanteur des sentiments, la densité des choses et des êtres, se font légèreté. Inversement, ce qui est léger peut soudain prendre un poids de gravité, de malaise. »
(1) Le Médicis en 1983 pour Cherokee et le Goncourt en 1999 avec Je m'en vais.
Michèle Gazier (Télérama, 15 janvier 2003)
« Le style de Jean Echenoz, phrases coupées court, poésie du quotidien, brutalité des états d’âme, absence de psychologie, situations franchement comiques, précisions scientifiques ne cesse de surprendre. Les personnages se dévoilent dans leur rapport au monde. Dans tout un jeu de vides et de pleins. Les genres littéraires sont explosés. On peut seulement dire qu’il s’agit ici de littérature. Au piano n’est pas seulement le plus beau livre de Jean Echenoz. C’est le plus personnel. Le plus risque-tout. On y parle de l’approche de la mort, de la vie mal pesée, de la fuite en avant, de la femme inaccessible. Du non-sens perpétuel dans lequel il faut quand même trouver ses marques. »
Marie-Laure Delorme (Journal du Dimanche, 12 janvier 2003)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
« Dire qu’Echenoz s’en donne à cœur joie avec le récit, donne à peine la mesure de son audace, de sa manière de casser les convenances et de nous phagocyter. Merveille du romancier magicien et malin ! L’art d’Echenoz est un art de la fugue. De glissement en glissement, de mise à distance en zoom, de vérités géographiques en dérives folles, il nous promène à travers les paysages mentaux revisités du paradis, du purgatoire et de l'enfer. Comme Orphée le musicien, Max le pianiste cherche désespérément son Eurydice, alias Rose, pour la ramener jusqu’à lui. Comme Dante, hanté par son amour pour Béatrice, il parcourt les trois lieux sacrés de l’après-vie. Jouant avec les mythes antiques, l’éternité et le salut, le romancier nous prend par la main et nous fait entrer dans sa ronde. »
Entretien paru dans la revue Zooey n°3, (12 rue Gustave Simon, 54000 Nancy)
propos recueillis par Mathieu Remy
Je ne peux pas envisager un roman sans mouvement. C'est peut-être encore lié à ma grande sensibilité à l'ennui. Si ça ne bouge pas, d'une manière ou d'une autre, ça me fige de façon insupportable. Je ne sais pas pourquoi mais je ne peux pas concevoir un roman sans ce mouvement, sans qu'il passe par des lieux qui, s'ils n'ont pas l'air d'être fascinants pour le personnage qui les traverse, le sont pour moi. Soit parce que je les ai vus, soit parce que je les ai reconstitués. Il faut que ces lieux possèdent, encore une fois, une pertinence romanesque. Cette pertinence-là, on ne la trouve pas partout. Et je ne sais pas toujours au juste pourquoi. Ça peut être le Pavillon des abats, par exemple, au Marché d'intérêt national de Rungis. J'y arrive une nuit, au hasard d'un repérage, et je me dis aussitôt : voilà, c'est ça. Nous y voilà. Ça peut être une ville du Nord-Est du Pérou – j'ai un peu voyagé au Pérou – où je me suis dit : voilà l'endroit. Voilà un endroit générateur. Qui n'a pas seulement une existence réelle, mais qui a aussi et surtout – pour moi – une existence romanesque évidente. Je vais alors essayer de reconstituer cette fascination-là. Ce qui n'a évidemment rien à voir avec des critères esthétiques.
Du même auteur
- Le Méridien de Greenwich, 1979
- Cherokee, 1983
- L’Équipée malaise, 1987
- L’Occupation des sols, 1988
- Lac, 1989
- Nous trois, 1992
- Les Grandes blondes, 1995
- Un an, 1997
- Je m'en vais, 1999
- Jérôme Lindon, 2001
- Au piano, 2003
- Ravel, 2006
- Courir, 2008
- Des éclairs, 2010
- 14, 2012
- Caprice de la reine, 2014
- Envoyée spéciale, 2016
- Vie de Gérard Fulmard, 2020
- Les éclairs, Opéra, 2021
- Bristol, 2025
Poche « Double »
- L’Équipée malaise , 1999
- Je m'en vais , 2001
- Cherokee , 2003
- Les Grandes blondes , 2006
- Lac, 2008
- Nous trois , 2010
- Un an, 2014
- Au piano, 2018
- Envoyée spéciale, 2020
- Vie de Gérard Fulmard, 2022
- 14, 2024
Livres numériques
- Cherokee
- Courir
- Des éclairs
- Je m'en vais
- Jérôme Lindon
- L’Équipée malaise
- L’Occupation des sols
- Lac
- Le Méridien de Greenwich
- Les Grandes blondes
- Nous trois
- Ravel
- Caprice de la reine
- Un an
- Au piano
- Envoyée spéciale
- Vie de Gérard Fulmard
- Les éclairs, Opéra
- Vie de Gérard Fulmard
- 14
- Bristol
