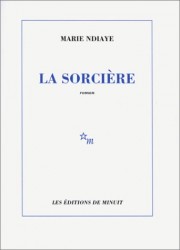
Marie NDiaye
La Sorcière
1996
192 pages
ISBN : 9782707315694
30 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
* Réédition dans la collection de poche double n°21
Lucie n'est pas une sorcière talentueuse. Ses deux filles, elles, se révèlent extrêmement douées, au-delà des prétentions et des espoirs de Lucie qui n'aspirait qu'à en faire des sorcières efficaces. Quant à la mère de Lucie, son génie est absolu. Mais qui sont les corneilles ? Est-on plus libre, de prendre la place des oiseaux, leur forme et leur aspect, et d'imiter leur cri ?
Marc Weizmann (Les Inrockuptibles, 16 octobre 1996)
Sereine étrangeté
Après Quant au riche avenir, premier livre au titre prémonitoire publié à dix-sept ans, Marie NDiaye revient, onze ans et cinq romans plus tard, avec La Sorcière, l'histoire drôle et triste d'une magicienne honteuse, où l'on retrouve un univers inclassable et troublé, entre brouillage identitaire, périple onirique et description réaliste.
Dans l'une des scènes d'un roman précédent, En famille, Fans, l'héroïne qui tente en vain de se faire accepter par son entourage, s'efforce pour y parvenir de convaincre son cousin Eugène au mariage : “ On nous regarderait, rétorque le cousin. Que tu es ma cousine, cela s'oublierait vite, mais pas que... – Quoi donc ? – Oh, tu m'ennuies ! (...) Est-ce que tu as l'air d'être ma cousine ? ”Tout l'art de Marie NDiaye tient dans ce “ quoi donc ? ” obstiné auquel rien ne vient jamais répondre. Pas une fois, en effet, le livre ne dit quel est cet air mystérieux qui vaut à Fanny de n'être reconnue de personne au sein de sa propre famille, au point d'être attaquée même par les chiens, violée par l'un de ses oncles, et d'errer, en quête perpétuelle d'un énigmatique pardon, dans un paysage rural à chaque page plus étroit, plus laid, plus cauchemardesque, auquel elle essaie pourtant désespérément de s'intégrer. Dans le roman suivant, Un temps de saison, on retrouvera cette même dérive dans des campagnes hostiles, avec l'histoire d'Hermann, professeur de mathématiques parisien en vacances qui, après s'être absenté l'espace d'un instant, constate l'inexplicable disparition de sa femme et de son fils et se heurte au silence indifférent des habitants du village. On se rassurerait à peu de frais en voyant chez Marie NDiaye l'enfant d'un mariage mixte en quête d'origines, et dans ses livres, une dénonciation cryptée, rassurante, et somme toute fort convenue, de la xénophobie quotidienne. En réalité, qu'il s'agisse de Fanny, d'Hermann ou, comme dans le dernier, de Lucie la sorcière honteuse, ses meilleurs romans décrivent un type de personnage bien précis, dont le mystère reste entier : qu'est-ce qui, contre toute évidence, pousse certains à vouloir, de toutes leurs forces, s'assimiler au milieu qui leur est le plus hostile, sachant d'avance que leur tentative ne fera que renforcer et légitimer cette hostilité, et s'acharnant pourtant dans cette déperdition d'être à mi-chemin entre haine et culpabilité, jusqu'à se façonner, au-delà de toute identité, une étrange forme de séditieuse, minante et dangereuse dignité ? “ Que me faisaient, s'interroge l'héroïne de La Sorcière, que me faisaient toutes ces existences auxquelles il me fallait sacrifier mon énergie, quelle importance et quelle espèce d'intérêt pouvaient avoir pour moi les petits mystères de leurs destinées ? ”
Est-ce vraiment de la haine, d'ailleurs, cette étrangeté inquiète et réductible à rien qui pousse, par exemple, la mère de la narratrice à punir son époux quand ce dernier la surprend en train d'accomplir un prodige de sorcellerie ? “ Cette volonté de le châtier de l'estourbir, de le détruire, elle la sentait s'installer en elle, sans espoir d'apaisement. Elle ne le haïssait pas, non, mais cette part énigmatique d'elle-même qui ne se dévoilait que dans la solitude et l'obscurité, cette part glacée, souveraine, violente, combattait ses sentiments habituels de bienveillance. ” Nous sommes moins définis par ce que nous sommes que par l'étrangeté qui nous fonde et nous échappe en permanence. À côté, ou en dessous, des “ sentiments habituels ”, il y a quelque chose, quelque chose d'inassimilable, de clandestin, de vaguement menaçant, qu'il faut garder secret. Et à vrai dire, pas plus que dans les romans précédents, on ne sait précisément de quoi il s'agit. “ La sorcellerie, explique Marie NDiaye, rien de ce qui se rapporte de près ou de loin aux pratiques de magie noire ou d'occultisme, ne m'intéresse en quoi que ce soit. ”
Dans le livre, la magie en question semble se limiter essentiellement à des talents de visionnaire (les femmes voient l'avenir en pleurant des larmes de sang) et, surtout, à des métamorphoses. La mère de la narratrice se change parfois en serpent, ses filles préfèrent la forme des corbeaux, en tout état de cause des animaux inquiétants.
Comme dans les précédents livres, donc, l'apparence des personnages est légèrement problématique, mais cette fois, c'est l'inverse de ce qui se produisait dans En famille. Non plus une héroïne cherchant à s'intégrer, mais une transmission familiale à l'héritage difficile. Lucie est en quelque sorte une sorcière de la seconde génération. Sa mère, magicienne de renom aux pouvoirs volontairement limités, n'exerce son talent qu'en secret, dans un désir d'oubli de soi peut-être renforcé par l'attitude de réprobation dégoûtée de ses maris successifs lorsqu'il leur arrive de surprendre I'une ou l'autre de ses métamorphoses. “ Sa propre puissance d'une incomparable intensité, lui répugnait tant qu'elle n'en faisait jamais usage. Elle refusait de l'évoquer et s'efforçait sans doute même de ne plus y croire, la reléguant dans le fatras des superstitions que lui avait relégué sa propre mère illettrée, raconte Lucie. Elle m'avait appris ce que je connaissais maintenant (…) avec un dégoût perceptible qui me faisait me tortiller de confusion sur mon siège. ” Quant aux filles de la narratrice, tout juste initiées – le livre commence par leur initiation -, elles vivent leurs nouveaux pouvoirs d'abord comme une corvée plutôt voir des courants prosaïque, avec cette sorte de détachement que l'on a pour les choses inévitables. “ Le secret de leurs pouvoirs était jugé par mes filles strictement intime et en même temps fondamentalement inintéressant. En d’autres temps, elles en auraient éprouvé une légère honte. Mais (...) elles n'avaient que très peu de pudeur, étaient rarement gênées par quoique ce fût. (...) Elles auraient oublié bientôt, prophétise la narratrice au début du livre, que la transmission de notre don était une loi. ” Or, ce n'est justement pas ce qui se passe. Progressivement, le détachement initial des deux enfants va se muer en mépris muet et sarcastique pour leur entourage, jusqu'au moment où elles vont se révéler plus douées que leur mère (ou moins complexées), pour le malheur de cette dernière. “ Il me semblait chaque jour que mon talent s'étiolait un peu plus. Est-ce que je manquais de volonté, de fureur et de rage ? Il me manquait par trop, me disais-je, le goût du pouvoir et le dégoût de la fatalité. ” On peut noter au passage que, de son écriture simple, concise, fragile et précise comme celle d'un conte, Marie NDiaye parvient à formuler le problème sur lequel achoppent les ethnosociologues et les militants politiques qui se penchent depuis des années sur le désormais fameux problème de l'intégration. Dans le livre comme dans la réalité, ce que l'on croyait réglé avec la seconde génération resurgit à la troisième, celle qui retrouve les lois ancestrales et dangereuses étouffées par la honte et le désir de normalité.
Toutefois, Marie NDiaye se garde de tirer la moindre conclusion, préférant s'attacher au personnage de Lucie, la narratrice, écartelée entre origine honteuse et avenir hostile, condamnée à ne jamais faire ce qu'il faut. Elle tente de réconcilier ses parents séparés, alors que c'est manifestement impossible ; elle se soumet aux desiderata de son père, pris dans d'obscures affaires de malversation financière, et qui lui réclame la dot qu'il lui a pourtant donnée ; enfin elle cherche à récupérer son mari, parti vivre avec une autre femme après avoir vidé le compte bancaire, précisément de la fameuse dot. Dépossession, perte, héritages problématiques ou illégaux : les choses iront de mal en pis jusqu'à l'embauche de Lucie par l'une de ses amies, Isabelle, qui a fait fortune dans le new-age avec l'ouverture d'une “ université féminine de la santé spirituelle ” : “ J’ai recruté par petites annonces, hoquetait Isabelle, tordue de rire, je disais simplement que je voulais des femmes jeunes et désorientées, dans une situation difficile, quoi. Si tu avais vu tout ce qui s'est présenté ! (...) Celles que j'ai choisies, eh bien, personne ne se soucie d'elles, à part moi. ”
Plus que désorientée, Lucie va accepter d'enseigner la sorcellerie et, pour se conformer au désir de qui la paie, pour se faire accepter maintenant qu'elle a tout perdu, jusqu'à ses filles, elle va inventer, illuminer “ artificieusement (son) regard de lueurs de magie et (s)’astreignant à une bizarrerie de manières. Ainsi, me disais-je, il m'est plus aisé d'être une sorcière professionnelle et scélérate qu'une véritable. J’en vins alors à douter d'avoir jamais possédé d'autre don que celui de l'affabulation. ” Paradoxe suprême, où l'identité devient d'autant plus introuvable qu'elle se manifeste socialement.
Il ne faudrait pas voir pour autant Marie NDiaye comme un porte-voix de l'étrangeté ou d'une marge quelconque. Tous ses livres au contraire, malgré leur caractère plus ou moins “ fantastique ”, se caractérisent par un réalisme très étudié, dont l'ironie ne bascule jamais dans la caricature. “ Ce n'est qu'une question d'observation, commente-t-elle d'un air détaché. J'invente en réalité très peu de choses, je me contente de les grossir ou de les déformer légèrement. Le fait de vivre en province aide à l'étude presque clinique des comportements. De plus, je ne me considère pas comme une observatrice extérieure, moi aussi, je suis dans l'aquarium. ” La vie de Marie NDiaye n'a, semble-t-il, rien de l'existence tourmentée des personnages de ses romans. “ Quand un livre est achevé, je peux rester un an sans rien écrire, et même lorsque j'écris, je ne fais pas ça tous les jours. J'emmène mes enfants à l'école, on se promène, je discute au square avec les autres mères de famille, j'adore ça... C'est pour ça que je dis que je suis aussi dans l'aquarium. Je suis comme elles, elles ne savent pas très bien ce que je fais, ça ne les intéresse pas beaucoup et, en tout cas, ça ne les fascine pas. ” Marie NDiaye ressemble à son écriture : retenue, sereine, claire et profondément déterminée à ne rien laisser voir des courants souterrains qui l'animent. Ce qu'il y a de déconcertant chez elle, et qui échappe à toute tentative d'interview, c'est le sentiment de se heurter à un secret d'autant mieux préservé qu'il semble en apparence calmement et parfaitement exposé. Qu'elle parle des films d'Ozu qu'elle aime pour “ leur clarté et leur rigueur ” ; qu'elle se lance immédiatement dans l'éloge d'un cinéaste tout à fait différent (“ J'aurais adoré avoir fait les films de Cassavetes. Cette façon très particulière dont les choses arrivent dans ses films, cette sorte de décalage ”), qu'elle évoque son désintérêt radical pour la chose universitaire (trois mois de fac après le bac pour toutes études supérieures : “ C'était tout simplement déprimant, crasseux et bondé, sans aucun intérêt pour moi ! ”, ou son inconscience totale des méandres éditoriaux lorsqu'à seize ans passés elle fit parvenir son premier manuscrit, Quant au riche avenir, à Gallimard (vénérable maison qui, dans sa sagesse non moins vénérable, le refusa) puis aux Éditions de Minuit – qui l'acceptèrent –, choisissant les maisons d'édition parce que “ le nom me disait vaguement quelque chose mais je n’y connaissais rien ” ; on retrouve toujours cette certitude tranquille et définitive, cette hauteur de vues plus humble qu'on ne pourrait croire, de qui se sait irréductible à ses identités. “ C'est marrant, dit-elle d'un air légèrement surpris, je n'ai jamais douté que je serais écrivain. ”
Tiphaine Samoyault (La Quinzaine littéraire, 1er septembre 1996)
Des bons usages d'un don
Le sixième roman de Marie NDiaye, La Sorcière, affirme, dans le singulier de son titre, l'identité des différentes femmes d'une même famille et la continuité entre les générations. Pourtant, toutes n'ont pas le, même pouvoir, ni le même usage de leur don de sorcière qui se présente progressivement comme métaphore de leur pouvoir affectif, ou de leur impuissance.
L’occulte est un thème récurrent dans l'univers de Marie NDiaye. La Femme changée en bûche (Éditions de Minuit, 1989) présentait une femme qui s'était elle-même livrée au diable et son précédent roman, Un temps de saison (Éditions de Minuit, 1994), faisait mystérieusement disparaître la femme et le fils du personnage principal : l'issue de la quête concluait à leur transformation en émanations.
La Sorcière commence par l'initiation de deux jumelles par leur mère : “ Je tâchais de leur transmettre l'indispensable mais parfaite puissance dont étaient dotées toutes les femmes de ma lignée ”. De larmes de sang en métamorphoses, le roman est hanté par des figures divinatoires, prises dans le réseau de la vie quotidienne et des petites aventures communes. Le don s'identifie d'abord à la féminité, l'initiation se faisant, de génération en génération, au moment de la puberté, le sang qui coule sur les joues venant exhiber les menstrues et pouvant induire un recul de l'homme, qu'ainsi, à propos de son mari, la narratrice exprime : “ Je redoutais un peu qu'il ne ressentît soudain envers Maud et Lise l'irrépressible aversion qu'il avait pour moi ”. La fiction met en place une société exclusivement matriarcale où les hommes peuvent faire peur, sont faibles ou malhonnêtes et où l'on se félicite plutôt qu'ils disparaissent ou que des enfants puissent naître sans père.
Le don devient aussi le lieu des conflits de générations. Il est ainsi ce qui rapproche les femmes de la lignée et ce qui les éloigne. Chacune fait un usage différent de ce don : à l'utilisation strictement fonctionnelle des jumelles (par exemple connaître le temps qu'il fera demain pour savoir si elles joueront au basket) répondent l'usage affectif de la mère (savoir où est son mari) et l'esprit vengeur de la grand-mère (transformer son mari en limace). Au centre des générations se situe Lucie, le personnage principal, qui se sent des pouvoirs inférieurs à ceux de sa mère et de ses filles. De façon récurrente, elle s'éprouve moins bonne sorcière qu'elles et un mélange de dépit et d'admiration se lit dans le regard qu'elle porte sur les autres : à sa mère : “ Si tu le voulais, tu serais sans doute la plus grande sorcière de notre famille ” ; à propos de ses filles : “ Elles seraient peut-être, pensai-je avec espoir, les plus grandes sorcières de tous les temps ”. Peu à peu, ce manque de génie éprouvé par la narratrice se traduit par une passivité et une impuissance dans ses rapports affectifs et familiaux. Le mauvais usage de ses dons est en fait un mauvais usage du don d'exister et le texte illustre magnifiquement le déplacement des pouvoirs. À force d'espérer augmenter ses pouvoirs de sorcière, qui s'identifient peu à peu à un désir régressif, elle n'a plus aucun pouvoir sur le réel. Elle ne fait rien contre le départ de son mari, sa tentative pour rapprocher ses parents séparés échoue ; sa peur de se voir abandonnée de ses enfants entraîne leur inéluctable fuite : “ Je me surpris à supplier muettement mes filles de ne pas m'abandonner, mais leur regard fixe, vague, morose, me montraient bien qu'elles étaient parties déjà là où, avec les maigres ressources de mon talent laborieux, je n'aurais jamais accès ”. Leur métamorphose en corneilles illustre leur envol du foyer familial en même temps qu'un rapport au monde différent, irréconciliable avec celui de leur mère.
C'est un beau roman car le surnaturel et l'occulte n'y ont pas fonction d'élément pittoresque mais metaphorisent un rapport au réel : preuve en est le personnage de l'amie Isabelle, non initiée, sans mystérieux pouvoir mais dont le comportement et les apparitions successives, le succès dans la vie, semblent s'apparenter à de la sorcellerie. Si l'issue ressemble aux minutes d'un procès en sorcellerie et à une condamnation au bûcher, c'est pour mieux illustrer la façon dont le réel s'est finalement retourné contre l'héroïne.
Outre qu'elle a su, dans ce roman, entremêler le réel le plus commun et le surnaturel le plus étrange sans produire un texte fantastique mais en tissant une fiction qui se tient au plus près d'une détresse individuelle, Marie NDiaye qui, depuis quelque temps, adopte un style plus classique que dans ses deux premiers romans, use d'une langue dont certaines expressions naissent aussi de la rencontre de l'ordinaire et de l'extraordinaire : c'est le mari “ vibrant d'émotion tendue, presque artistique ” ou marqué d'une “ étonnante expression de bonté confite ” ; ce sont les filles “ déconcertantes comme les pèlerines d'un autre siècle ” ou encore “ le petit visage timide, concentré, sérieux, de ma mère au passé si lisse et si correct ”. Le plaisir de la lecture tient aussi, peut-être surtout, à cette langue lisse et correcte traversée de notations si justes et d'inventions si déconcertantes. En écrivant cette histoire de sorcières, Marie NDiaye a donc fait très bon usage de ses dons.
Jean-Baptiste Harang (Libération, 5 septembre 1996)
On croit rêver
Même lorsqu'elle parle du quotidien le plus plat, Marie NDiaye tient de Dieu sait quel diable des recettes secrètes qui enchantent son écriture.
Au loin, le titre, La Sorcière, une enseigne équivoque qui attire comme tout ce qui effraye, on s'approche, la première phrase tentatrice : “ Quand mes filles eurent atteint l'âge de douze ans, je les initiai aux mystérieux pouvoirs. ” On va plonger, mais non, la deuxième phrase infranchissable comme un garde-fou tente de nous préserver du naufrage : “ Non pas tant, mystérieux, parce qu'elles en ignoraient l'existence, que je les leur avais dissimulés (avec elles, je ne me cachais de rien puisque nous étions du même sexe), mais plutôt que, ayant grandi dans la connaissance vague et indifférente de cette réalité, elles ne comprenaient pas plus la nécessité de s'en soucier ni d'avoir, tout d'un coup, à la maîtriser d'une quelconque façon, qu'elles ne voyaient l'intérêt pour elles d'apprendre à confectionner les plats que je leur servais et qui relevaient d'un domaine tout aussi lointain et peu palpitant. ” Voilà, trop tard, la phrase est lue, relue, comprise peut-être, le seul obstacle qui aurait pu nous sauver, la rambarde est sautée, a sauté, et le courant emporte le lecteur sans appel jusqu'au terme, là où le fleuve jette au saut du rêve ses dormeurs ahuris.
Marie NDiaye n'est pas une sorcière, mais elle tient de Dieu sait quel diable des recettes secrètes qui enchantent son écriture d'une invisible magie. On y suppose un charme déposé, hypnotique, qu'aucune analyse ne peut déceler, qui s'échappe du moindre prélèvement avant que le critique ne le porte au laboratoire, comme de l'eau entre ses doigts, un charme qui contraint celui qui n'a pas saisi sa chance de s'en détourner à s'y noyer. Il ne laisse aucune trace chimique, il ne sent pas la sueur, il n'est pourtant que du travail, du pur travail d'écrivain. Il n'y a pas de trucage. Ce philtre-là ne connaît pas de dépistage.
La sorcière s'appelle Lucie, c'est une piètre sorcière, d'une lignée de femmes sorcières, elle a le don de voir un peu de passé, un peu d'avenir, vague, et du présent d'ailleurs, flou. Lucie entretient ce don médiocre pour pouvoir le transmettre à ses jumelles délurées, Maud et Lise, afin que rien ne se perde. Les deux en feront un usage désinvolte et talentueux entre prévoir s'il y aura du Coca au goûter et se transformer en espiègles corneilles. Et disparaître. L'exercice ne coûte que quelques larmes plus ou moins rosies de sang, selon le talent et la longueur de l'effort, sang que les chipies balayeront d'un revers de manche insouciant.
Mais le livre de Marie NDiaye n'est pas un conte de fée, c'est la vie d'aujourd'hui, concrète, banale, douloureuse, incohérente, où être sorcière n'est qu'un avatar, un prétexte à l'exclusion, comme une couleur de peau, un odeur de chou, pour celle qui n'use pas de son don comme d'un pouvoir. La sorcière dit la vie des banlieues dans une ville moyenne, les pavillons à l'identique, les crédits, les fins de mois, les pizzas surgelées, les femmes trop grosses en jogging et les VRP cravatés comme des pendus. La voisine tyrannique et envahissante, la belle-sœur maquillée comme une affiche, la belle-mère et son tablier à fleurs. Des parents séparés qu'aucun amour ne pourra rapprocher. Des supermarchés, des zones artisanales déambulées comme des gares vides. Des automobiles trop chères et trop briquées. Des noms de rêves comme Châteauroux ou Poitiers. La vie des gens. L'argent mal gagné, mal gardé, mal perdu, et la tristesse acceptée de la sorcière mal aimée. Marie NDiaye exerce à ce niveau de réalité, avec une simplicité aiguë jusqu'à la drôlerie, un art de décrire sans jugement et sans caricature qui à lui seul, sous la plume d'un autre, ferait un livre remarqué et louable. Mais Lucie est une sorcière, sa lucidité et sa capacité à l'ubiquité catalysent une douleur blanche, reconnue et acceptée. Et si les choses décrites sont réelles, le mode du récit transforme ce réel en vertige tangible, et l'acuité, la lucidité de l'extra-lucide Lucie (et, partant, du lecteur) en angoisse.
Le récit avance comme l'on rêve. Au début, pour nous endormir, la réalité, même lestée d'un peu de sorcellerie admise, s'adresse à la pensée discrète de celui qui cherche le sommeil, elle est étale, acceptable comme une histoire, puis imperceptiblement, par la magie qu'on a dite, la même histoire se poursuit quand l'état de veille nous abandonne, notre frénésie à tourner les pages est une illusion d'éveil, un acte somnambule tandis que le récit progresse à un rythme que seul le rêve permet : les personnages peuvent changer de lieu, de silhouette, de métier, de famille, sauter des semaines ou des pages, se transformer en oiseaux ou en escargots, on les reconnaît entre mille, on accompagne ces glissements, ces collisions, tenus ailleurs pour des incohérences, elles sont ici admises en évidences, on sait bien qu'il suffit de bouger dans le lit ou deviner l'aboiement d'un chien à travers son sommeil pour que notre rêve change de lieu, de temps, d'espoir, sans pour autant se briser ou se défaire. Ainsi écrit Marie NDiaye, directement dans les rêves, avec un aplomb tel qu'on ne s'en aperçoit pas. On croit le rêve sur parole, on aura beau se frotter les yeux, éreinté comme celui qui dort dans le rêve d'un autre, il restera patent, flagrant, manifeste, comme le plus court chemin pour dire ce que Marie NDiaye avait à dire. Dire que la marge est étroite, la liberté bordée de néant, que le sectarisme guette, que le pouvoir des uns est le regard des autres, que les faibles et les forts courent dans la bouche de l'ogre, que les générations dérivent loin les unes des autres comme des continents ennemis, indifférents, et que la faille écartèle ceux qui se résignent trop tard. Dire que la sorcière est toujours abandonnée. Dire qu'il n'y a pas de sorcellerie, que c'est juste une façon de dire les choses.
Qu'on ne se méprenne pas, La Sorcière n'est pas un rêve, c'est un véritable roman qui ne s'oublie pas comme les rêves s'évanouissent, une vraie histoire, sinon une histoire vraie, qui force le lecteur à l'admettre, comme on admet les rêves. À la fin, Lucie est seule, son petit don de voyance inapte au bonheur de survivre, tout est perdu au point que le lecteur chagrin se demande s'il était bien nécessaire de laisser Lucie faire.
Pierre Lepape (Le Monde, 6 septembre 1996)
Éloge du charme
D’un côté, une description minutieuse de quotidiens ordinaires baignés d’ennui, de drames, d’angoisse, de solitude. De l’autre, un récit fantastique et onirique. Entre les deux, la plume ensorceleuse de Marie NDiaye confectionne un roman paré de toutes les séductions.
(…) Marie NDiaye s’impose en premier lieu par son originalité ; elle a un propos et une voix qui ne ressemblent à rien de connu. Cette originalité s’accompagne d’un métier. La Sorcière est mieux qu’un livre d’auteur comme il y en a tant, c’est un livre d’écrivain : entendez que celle qui écrit sait disparaître derrière ce qu’elle écrit pour ne laisser deviner qu’une ombre vague et secrète, une présence. Dans une société littéraire dominée par le spectacle, cette position constitue un handicap, et nul doute que la réputation de Marie NDiaye serait beaucoup plus grande et ses lecteurs plus nombreux si elle consentait à livrer un peu de sa personne à travers ses personnages. Mais ce n’est pas son travail. Le sien consiste à s’améliorer de livre en livre, à creuser plus net le sillon, à traquer les facilités de plume, à parfaire son observation du monde et à se méfier, en bon classique, de ses dons, qui sont riches et nombreux. Il est précisément question de dons dans La Sorcière ; des dons de voyance et de métamorphose qu'on se transmet de mère en fille dans la famille de Lucie. Lucie n'est pas une sorcière très douée ; ses visions sont plutôt courtes et souvent parcellaires : inefficaces, donc, dans un monde où l'efficacité est devenue la pierre de touche des valeurs. Car Lucie est une sorcière de notre temps. Elle habite un pavillon dans un lotissement de banlieue pour classes moyennes ; elle est dotée d'un mari qu'elle n'aime pas davantage qu'il ne l'aime et qui bientôt va la quitter pour aller retrouver, à Bourges – capitale de la sorcellerie -, une autre femme et un autre foyer. Elle a surtout deux filles, des jumelles, Maud et Lise, qui ayant atteint l'âge de douze ans, celui de la puberté, sont à leur tour initiés aux rites de voyance et se révèlent d'emblée infiniment mieux pourvues que leur mère et dotées de surcroît d'un solide sens pratique et d'un non moins redoutable égoïsme. (…)
Michèle Gazier (Télérama, 1996)
Avec son goût de l'insolite, son penchant pour la fantaisie, Marie NDiaye nous promène aux frontières du réel. À coups de notations simples, d'interrogations sans réponses, d'étonnements divers, elle nous fait basculer dans un monde inquiétant, incertain, qui n'est pas tant celui de la sorcellerie que celui de la solitude. Qu'importe qu'elle soit ou non sorcière, cette Lucie qui voit ses filles lui échapper, son mari fonder ailleurs un autre foyer ou ses parents vieillir d'une étrange manière ; c'est sa détresse qui nous touche, sa timidité qui nous émeut. Mais Marie NDiaye la virtuose ne veut pas jouer le jeu de l'émotion ordinaire, elle casse les pentes trop douces de la compassion, elle brouille les pistes, elle substitue le rire aux larmes. Et comme les plus grands écrivains, elle nous envoûte.
Du même auteur
- Quant au riche avenir, 1985
- La Femme changée en bûche, 1989
- En famille, 1991
- Un temps de saison, 1994
- La Sorcière, 1996
- Hilda, 1999
- Rosie Carpe, 2001
- Papa doit manger, 2003
- Les Serpents, 2004
- Tous mes amis, 2004
