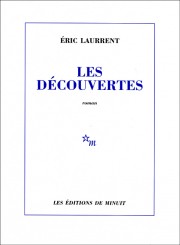
Éric Laurrent
Les Découvertes
Prix Wepler 2011
2011
176 p.
ISBN : 9782707321954
14.20 €
25 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille, 40 €
De la vue d'une reproduction des Sabines de David dans un vieux dictionnaire jusqu'à sa première nuit d’amour, ce livre évoque la croissante fascination d’un jeune garçon pour le corps féminin. L’affiche du film érotique Emmanuelle, telle scène de baignade dans Tarzan et sa compagne, la double page centrale d’un numéro de la revue de charme Penthouse, un strip-tease dans une fête foraine en marqueront quelques étapes. Mais il sera aussi question des jeux troubles de la prime enfance et de certaines expériences propres à l’adolescence.
ISBN
PDF : 9782707322098
ePub : 9782707322081
Prix : 9.49 €
En savoir plus
Emily Barnett, Les Inrockuptibles, 31 août 2011
eros machina
Après la rupture amoureuse, Eric Laurent se penche sur les premiers émois érotiques d'un jeune garçon. Une ode subtile au(x) corps féminin(s).
L'amour et la fin de l’amour, et après ? Un nouveau béguin ? Un pamphlet sur la disparition du thon rouge dans le Pacifique ? Après son diptyque consacré au miracle/désastre amoureux (Clara Ste, 2005) et à ses effets dans le temps (Renaissance italienne, 2008), Eric Laurrent réalise une habile marche arrière : un retour aux sources de l’éros. Cela implique un voyage dans le passé, enfance et adolescence, à travers lequel l’auteur va relater l’éveil puis la consolidation du désir pour le corps des filles.
Lesquels exactement ? La liste est longue, dictée par une précision du souvenir qui ne laisse pas de la rendre émouvante. Premier émoi devant Les Sabines de Jacques-Louis David, suivi de près par les apparitions télévisées de Sylvie Vartan " dans ses longues robes à paillettes décolletées et fendues ”. Viendront ensuite Angélique, marquise des anges, une cover-girl de Penthouse, une stripteaseuse croisée dans une fête foraine et, bien plus tard une camarade d’université follement punk.
Laurrent se penche ici sur la genèse du désir en tant que matière brute, bordélique, avant l’intervention de tout polissage culturel. Emergeant d’une nuit aveugle, le phallus de ces Découvertes fonce tête baissée sur les modèles les plus inattendus, des objets de fantasme soumis au désordre du hasard et de la censure – telle que celle-ci s’exerce encore dévotement dans la France du début des années 70. Il faudra une bonne dose de persévérance, et le cœur bien accroché, pour qu’à l’éveil succède l’envol sexuel.
A cet égard, les débuts amoureux du garçon, entre slows mal négociés et timidité maladive, tiennent autant du côté polisson d’Antoine Doinel que des transes sexo-extatique chères au narrateur proustien.
D’ailleurs, si Laurrent relate avec beaucoup de facétie des séances d’onanisme et d’envoûtement charnel de grande ampleur, il n’en parle pas moins d’émotion “ esthétique ”, d’“ expérience du Beau ”. Un épisode de matage de filles à la piscine municipale se transforme ainsi en ballet aquatique et abstrait, où “les baigneuses figu(ent) d’étranges divinités, au corps à demi nu, mais dénué de tête”. Et c’est le fantasme pour la mère gironde d’un camarade qui engendre la rédaction d’une nouvelle érotique, et par là-même la vocation d’écrivain.
A tout moment, Laurrent flirte avec le danger d’un éros angélisé, anobli par la langue, tant celle-ci prend chez lui un tour précieux. Il faut jouer le jeu, entrer dans la phrase qui ne finit pas, creuser les matières : là où le sens se dilue au profit d’une perte, défaillance de la mémoire. Le désir glouton aura alors achevé son ouvrage, en érigeant un panthéon sensualiste à la gloire du corps féminin et de ses pouvoirs magiques sur l’âge tendre.
Yann Moix, Le Figaro littéraire, 1er septembre 2011
Le stylite de minuit
Éric Laurrent a, depuis longtemps déjà, trouvé son style : c'est celui d'une littérature d’hier, ou fantasmée telle. Une littérature utilisant, à foison, des expressions aussi rares désormais que des espèces disparues de tigres, d’oiseaux : « malgré que j’en eusse », « fors », « déplorant à part moi », « nonobstant ». L’imparfait du subjonctif est également de mise, fût-ce pour évoquer Pink Floyd ou les casseurs de l’époque Devaquet, ainsi que les mots les plus précis « le tartan rouge, rayé de noir et de blanc, s’effrangeait sur une paire de leggings en résille »), quand ce ne sont pas les plus précieux (« l’orée de la mandorle bistre et renflée de son sexe »). Eric Laurrent n’est pas simplement un styliste : c’est un stylite. Cet anachorète est bien seul dans son désert désuet où scintille (mais pour qui ?) la mémoire de la langue. Perché sur sa colonne, décrivant (en des phrases qui parfois durent six pages) ses années 1970, puis 1980, dans un style de 1870, de 1880, l’auteur ne pourrait être qu’un ahurissant virtuose du français perdu, celui que maîtrisait Balzac, Flaubert, Chateaubriand ou Proust. Mais ce serait trahir la véritable trouvaille stylistique de Laurrent : la parodie d’une littérature qui n’a, en réalité, jamais existé. Car ni Balzac, ni Flaubert, ni Chateaubriand, ni Proust – ni même Daudet, ni même Maeterlinck, ni même Barrès pour descendre d’un cran – n’ont écrit comme cela.
Les Découvertes découvrent, finalement, un style qui aurait dû être, mais qui n’a pas été ; sa pureté même est inédite, son érudition atteint au burlesque, son intégrisme force le second degré. Et l’humour qui s’en dégage, puisqu’il ne s’agit pas seulement là du meilleur roman de la rentrée mais aussi du plus drôle, jaillit de la tenue de soirée de cette prose, de ces phrases en smoking, de ces permanentes dictées de Mérimée, de ce beau style au carré, au cube, qui eussent fait passer Jean Giraudoux pour Jamel Debbouze.
La découverte des Découvertes, c’est la description de Sylvia Kristel, icône de 1974, par un instrument littéraire, par un matériel syntaxique, par des appareils linguistiques qui ne lui étaient pas destinés : cinéaste amateur, Laurrent eût filmé la guerre du Golfe en muet noir et blanc ; peintre, il se fût fait élève de Monet pour figurer le ciel du 11 septembre 2001 ; musicien, il ouvrirait Rock en Seine par un hommage à Berlioz, s’arrêtant à Poulenc. Albert Caraco, le misanthrope suicidé, avait décidé pour écrire son œuvre folle de l’exprimer dans la langue du XVIIe siècle ; il malmenait de Gaulle avec une éloquence empruntée au cardinal de Retz, s’égarait dans des propos racistes avec l’austère élégance de Malebranche, conchiait les sixties avec l’accent de Vauvenargues. Éric Laurrent, dont le projet a quelque chose de borgésien, invente ceux qu’il imite. Et cette langue, un diamant à mille facettes, permet, loin de l’exercice frimeur et gratuit, d’entrer dans l’intimité des choses par une exactitude infinie des termes, par une perfection absolue de l’expression qui eussent fait la joie, non des vieux briscards du XIXe, mais de Francis Ponge.
Il y a une philosophie, une pensée derrière tout cela : le temps, qui se dépêche, est le seul sujet des romanciers ; choisir une prose datée, mais qui n’a pas existé, c’est se choisir une langue future – un monde à découvrir.
Richard Blin, Le Matricule des anges, septembre 2011
On ne dira jamais assez ce que la littérature doit aux heures magiques de l'enfance, à ce mélange d'attente et d’initiation qui caractérise les premiers corps à corps avec le monde. Un état d’acuité où se découvrent beaucoup plus de merveilles que de démons. Et parmi elles, le corps féminin. C’est le thème intemporel – et qui ne peut que trouver des échos chez chacun – que traite le dixième roman d’Éric Laurrent.
Un thème parfait pour quelqu’un qui a la passion des mots et qui, n’étant pas de ceux qui refusent l’héritage, a le souci de la langue. Redécouvrir par l’écriture les étapes de l’émergence d’Éros comme on redécouvrirait, peu à peu, une fresque disparue ; coïncider de nouveau avec quelques-unes des émotions les plus rayonnantes de ces découvertes, les réinventer en leur donnant forme écrite, voilà qui ne pouvait que séduire un auteur pour qui la langue est le cœur même de la littérature.
C’est donc à conjoindre ces deux ordres d’intensité – l’Éros et l’écriture – qu’il s’emploie dans ce roman – aux accents biographiques – qui se déroule à une époque (É. Laurrent est né en 1966) où une salle diffusant un film interdit aux moins de seize ans devenait « un lieu aussi secret que le saint des saints » et où l’on imaginait que devaient s’y célébrer des mystères aussi sacrés « que ceux de l’Incarnation, de la Rédemption ou de la Résurrection ».
Mêlant maniérisme et ironie, Éric Laurrent dit les effets de trouble et de fascination de la beauté, les muettes célébrations qu’elle entraîne, la grâce qui est sienne et fait parfois fléchir les genoux. Et ce, au fil de phrases saturées d’impressions, de souvenirs, de réflexions – phrases longues, lentes, imposant leur rythme et leur sinuosité et unifiant dans le même souffle le visible et le sonore, le candide et l’incandescent. Une phrase dont le déploiement syntaxique permet l’expression de toutes les nuances et donne corps aux latences érotiques qu’ouvrent toutes ces découvertes, jusqu’au « désir de faire l’amour » – moment qui viendra et reste à jamais épiphanique.
Amélie Nothomb, Le Monde, vendredi 14 octobre 2011
Du bon usage des subjonctifs
Qu'elles soient en bas de page ou en fin de volume, les notes sont les ennemies de la lecture. La peste ou le choléra. La note en bas de page est la pire : on ne peut s'empêcher de la lire, elle brise le rythme de la phrase, on perd le fil, le charme est rompu – et le plus souvent, on enrage quand on constate à quel point on pouvait se passer de l’information divulguée. La note en fin de volume frustre : on remet sa lecture à plus tard, mais on se dit qu’on rate sans doute quelque chose d’important.
J’ai lu Les Découvertes, le dixième roman d’Eric Laurrent, avec beaucoup de plaisir. Cet agréable moment fut néanmoins contrarié par la présence de trois notes en fin de volume. Fidèle à mes convictions, j’ajournai leur lecture, non sans pester intérieurement contre cette incapacité d’intégrer la totalité de l’information dans le fil de la narration. J’oubliai vite cet agacement, charmée et divertie par le récit de cette enfance modeste à Clermont-Ferrand et de cette initiation sexuelle gentiment ordinaire, pendant les années 1980.
Arrivée à la fin du roman, je tombai sur les fameuses notes dont j’avais oublié jusqu’à l’existence. Stupéfaction : il ne s’agissait pas des habituelles finasseries philologiques, mais des plus beaux et des plus longs morceaux de bravoure du livre, chacun constitué d’une phrase de dix pages, à la complexité syntaxique formidable.
Mon ahurissement passé, j’éclatai de rire. A quoi rimait ce petit jeu ? S’agissait-il d’une nouvelle méthode de mise en exergue ? Imagine-t-on La Recherche du temps perdu (toutes proportions gardées) avec la scène de la madeleine renvoyée dans les notes en fin de volume ?
Cela me parut à la fois si étrange et si bouffon que je relus le livre. Je voulais voir s’il aurait été possible d’intégrer ces notes hallucinantes à la narration. Conclusion : je n’en sais rien. Je ne sais pas pourquoi l’auteur a fait cela. Mais il a eu raison, puisque j’ai ri et puisque j’ai relu le livre.
Cuisine moléculaire
A la relecture, je me suis demandé, au-delà du comique évident, le pourquoi de cette préciosité et le pourquoi de toute préciosité. J’ai une faiblesse pour ce style qui fait grincer tant de dents. Je l’interprète de manière à la fois démocratique (ce n’est pas parce qu’on est issu d’un milieu modeste qu’on n’a pas le droit de s’exprimer comme cela) et aristocratique (il faut pouvoir s’autoriser une élégance aussi recherchée).
le préciosité d’Eric Laurrent m’a d’autant plus réjouie qu’elle est parfaite. L’auteur français écrit « septante » et non « soixante-dix », prouvant ainsi le caractère érudit de la langue belge. On comprendra que cela m’enchante.
L’emploi récurrent des subjonctifs imparfait et plus-que-parfait, ampoulés et facilement odieux sous d’autres plumes, coule de source chez Eric Laurrent. Sa manière ludique d’écrire précieux insuffle des émotions bizarres. C’est de la cuisson à l’azote liquide. Comme la cuisine moléculaire, ce n’est pas facile à manger, mais fascinant : (…) je m’abîmai de longues minutes dans sa contemplation, m’emplissant le regard de toute sa personne, comme si je me fusse trouvé devant un de ces chefs-d’œuvre, de l’art ou de la nature, qu’on sait ne jamais plus avoir le loisir de revoir, c’est-à-dire avec la volonté fiévreuse et désespérée de m’imprégner le plus profondément possible de sa beauté, dans cette plénière et à la fois douloureuse adhésion à l’instant que donne la conscience de sa fugacité, mais qui seule est le gage de sa fixation en nous (…). »
L’autre jour, je rencontrai un journaliste de France Culture et lui dis le bien que je pensais du livre d’Eric Laurrent. Il protesta : « C’est insupportable, ces subjonctifs ! » Je rétorquai : « Non, c’est rigolo. » Il fut péremptoire : « La littérature, ce n’est pas pour rigoler. » Ah. Je n’en suis pas si sûre.
Du même auteur
- Coup de foudre, 1995
- Les Atomiques, 1996
- Liquider, 1997
- Remue-ménage, 1999
- Dehors, 2000
- Ne pas toucher, 2002
- À la fin, 2004
- Clara Stern, 2005
- Renaissance italienne, 2008
- Les Découvertes, 2011
- Berceau, 2014
- Un beau début, 2016
Livres numériques
- Les Découvertes
- À la fin
- Berceau
- Clara Stern
- Coup de foudre
- Dehors
- Les Atomiques
- Liquider
- Ne pas toucher
- Remue-ménage
- Renaissance italienne
- Un beau début
