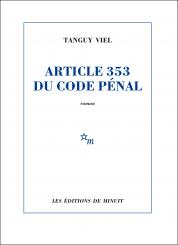
Tanguy Viel
Article 353 du code pénal
Grand prix RTL Lire 2017
2017
176 pages
ISBN : 9782707343079
17.00 €
45 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le cours des événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan, son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec.
Il faut dire que la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel appartement avec vue sur la mer. Encore faut-il qu'il soit construit.
ISBN
PDF : 9782707343295
ePub : 9782707345288
Prix : 7.99 €
En savoir plus
Nathalie Crom, Télérama, 4 janvier 2017
La confession d'un ouvrier breton floué par la vie et conduit à l'irréparable. Puissant roman d'un auteur passé maître dans l'usage de toutes les nuances de gris.
Si la Bretagne est bel et bien notre Far West, et le Finistère le bout du bout de la grand-route, il manque, semble-t-il, au tempérament des hommes qui y vivent aujourd'hui la dureté de la pierre et la méfiance inentamée qu'on suppose volontiers aux pionniers de l'Ouest américain. « Sûrement, ce genre de type, j'ai dit au juge, si on avait été dans un village de montagne ou bien dans une ville du Far West cent ans plus tôt, sûrement on l'aurait vu arriver, à pied peut-être franchir les portes de la ville, à cheval s'arrêter sur le seuil de la rue principale, en tout cas depuis le relais de poste ou le saloon, on n'aurait pas mis longtemps à comprendre à qui on avait affaire », explique Martial Kermeur au magistrat instructeur devant qui il a été conduit, dans le cadre de l'« affaire Lazenec » — du nom du promoteur immobilier Antoine Lazenec, dont on a repêché en mer le corps sans vie.
Seulement voilà, nous ne sommes pas dans un western, au temps de la conquête de l'Ouest, mais plus simplement dans une province française de la fin du xxe siècle, en proie au déclin industriel, économiquement et moralement sinistrée. Et lorsque le beau parleur Antoine Lazenec a débarqué six ans plus tôt dans la presqu'île, en face de Brest, de l'autre côté de la rade, nul n'a émis de doute face à son pharaonique projet de construction, en front de mer, d'une station balnéaire de grand luxe. Martial Kermeur pas plus que les autres, qui comme eux voulait y croire et a confié au promoteur ses économies : quelque cinq cent mille francs (c'était avant l'euro), soit les indemnités de licenciement qu'il avait perçues lors de la désaffectation de l'arsenal — tout son argent donc, mais aussi, et surtout, à travers cela, son espérance, et l'avenir de son fils.
Mais le Saint-Tropez du Finistère n'était qu'un mirage, les touristes fortunés ne viendront pas ici, à la pointe de l'Europe, goûter « la lumière si belle qui traverse la roche en fin d'après-midi, le calme des fougères qui ont l'air d'absorber toute la douleur du vent [...], la brume qui va et vient devant le soleil pâle... » Et c'est bien Martial Kermeur qui a poussé Antoine Lazenec à l'eau, à cinq milles de la côte et avec une mouette solitaire pour seul témoin — on peut le révéler sans déflorer l'intrigue du roman, dont Kermeur est l'unique narrateur, puisqu'il en fait l'aveu dès les premières pages, en préambule de sa longue confession, perforée d'interrogations et de doutes, qui constitue la chair même de ce livre d'une admirable densité. Formellement magistral — jusqu'à l'épilogue, renversant — et humainement pénétrant, Article 353 du Code pénal, septième roman de Tanguy Viel (né en 1973) (1) , est porté par la très belle voix de cet homme floué, quinquagénaire comme vieilli avant l'heure par le poids des infortunes et des échecs. Un homme las dont les mots s'emploient à construire la pensée, à tenter de comprendre l'agencement fatal des circonstances qui l'ont mené au meurtre. Des mots, des phrases par lesquels il cherche désespérément à tracer, dans l'espace sonore du bureau du juge, pour lui-même autant que pour le magistrat, « la ligne droite des faits » — qui inclut « la somme des omissions et renoncements et choses inaccomplies », sachant que, dans son cas, « la ligne droite des faits, c'était comme l'enchaînement de mauvaises réponses à un grand questionnaire ».
Le personnage défait de Martial Kermeur, le décor maritime exempt de pittoresque, mais aussi l'atmosphère ouatée à la Simenon, le goût des détails hérité d'une lecture assidue de Proust, l'attention portée aux liens familiaux et au tableau social, une palette très personnelle déclinant toute la gamme des gris pour évoquer le ciel perpétuellement changeant et la mer opaque, le crime présent au cœur de l'intrigue, le mécanisme parfaitement huilé d'un scénario menant implacablement au drame... De multiples passerelles relient Article 353 du Code pénal aux précédents opus de Tanguy Viel — on songe notamment à L'Absolue Perfection du crime (2001), à Insoupçonnable (2006), bien sûr à Paris-Brest (2009). Ce n'est pas dire que l'écrivain se répète. Au contraire, il bouge, il change, il se déploie. Dans un même mouvement, il approfondit sa méditation sur le choix moral, la responsabilité individuelle, le destin, et précise son geste romanesque en prenant ses distances avec les codes des littératures (et du cinéma) de genre dont il a naguère beaucoup usé. Délaissant quelque peu l'ironie (si ce n'est dans les patronymes, tellement... bretons) au profit d'un réalisme virtuose et d'un humanisme pleinement assumé, il s'appuie sur ses personnages pour irriguer son roman d'une réflexion toute métaphysique sur le mal en l'homme — plongeant Martial Kermeur dans une « nuit intérieure » et exhaussant son drame ordinaire en une authentique leçon de ténèbres.
Eric Loret, Le Monde, 5 janvier 2017
Confiance aveugle
Dans « Article 353 du code pénal », le romancier ausculte les « absences » d’un père de famille devenu meurtrier, sur fond de faillite des promesses socialistes. Politique et fulgurant.
C’est l’histoire d’un pauvre – ou plutôt d’un demi-pauvre, car on est toujours le riche de quelqu’un d’autre – qui révèle à un promoteur avoir touché un paquet d’indemnités. C’est à Brest, comme dans presque tous les romans de Tanguy Viel : on est à l’aube de l’an 2000. L’arsenal a fermé, le pauvre a retrouvé un emploi de gardien, dans une sorte de château dominant « la rade », et qui appartient à la commune. Il y a la mer pour se noyer et une famille à protéger. Sauf que la famille a perdu sa femme, il ne reste plus que des hommes, embarqués les uns avec les autres : le narrateur, son fils et, à défaut de mère, un maire, qui porte le même prénom que le père, Martial, ce qui nous emmène un peu au-delà du drame intime, vers le politique : « Tout ça parce que moi, le socialiste de 1981, j’avais investi tout mon fric dans un projet immobilier. » Mais on a beau s’appeler Martial, il y a des guerres perdues d’avance.
On pourrait dire aussi que c’est un polar, ça mangerait moins de pain, surtout qu’il ne va rester que des miettes, une fois que le promoteur Lazenec aura englouti l’argent de Martial Kermeur et que celui-ci l’aura assassiné, dès la première page, sans le moindre mystère. Car l’énigme, plus politique que policière donc, n’est pas constituée par la nature ou les raisons du crime ni l’identité de l’assassin, mais par le sort que la société fera à ce dernier. Comme dans Paris-Brest (Minuit, 2009), on trouve un fils Kermeur, âgé de 17 ans – il se prénomme ici Erwan –, et un affrontement entre prolétariat traditionnel et classe moyenne dévoyée : en l’occurrence des commerciaux « décidés à forcer la vente d’un 2-pièces avec vue sur la mer, essayant peut-être de cacher leur mépris pour les napperons qui recouvraient les tables dans les salles à manger parce que sûrement, ça ressemblait trop à celles de leurs parents ».
Tanguy Viel distille avec un sadisme tout musical la série des avanies de son personnage, par la bouche de celui-ci s’adressant au juge d’instruction : suspense réussi. Mais, au-delà de « l’enchaînement de mauvaises réponses à un grand questionnaire » que constitue le destin de Kermeur, ce qui intéresse davantage le lecteur, c’est la façon dont l’écrivain met au centre de son livre la question même du récit, de la façon dont on peut, comment et à qui, « confier » une histoire. Car c’est en partie l’intimidation sociale qui précipite père et fils dans le malheur, qui fait que le premier livre sa parole et son argent à un promoteur : « J’ai imaginé qu’il pensait des choses et donc j’ai imaginé qu’il fallait que j’y réponde, que là, devant lui, je devais me justifier, de comment c’était possible que moi, Martial Kermeur, ouvrier spécialisé à l’arsenal de Brest, comment moi je pouvais me payer un Merry Fisher de neuf mètres de long à l’état neuf. Alors qu’est-ce que j’ai fait ? Eh bien, j’ai tout raconté. »
On pourrait dire que la langue de Martial Kermeur est « orale ». Elle est surtout collée à l’existence, toute incorporée et peinant à la réflexivité. Le personnage confond la météo avec ses propres torpeurs (« On aurait dit que le ciel essayait de traverser le grillage pour se mettre à l’abri lui aussi ») et, ce qui est plus dommageable, ses élans avec la réalité (« Le juge a balancé la tête deux ou trois fois de haut en bas comme un automate dont j’aurais remonté la clé dans le dos »). Un des enjeux du récit de Kermeur sera donc pour lui de cerner sa bêtise, « si on appelle bêtise les heures d’absence à soi-même » : « C’est comme si le capitaine qui était censé habiter avec moi dans mon cerveau, c’est comme s’il avait déserté le navire avant même le début du naufrage », explique-t-il au juge.
Heureusement, malgré la désertion du protagoniste, il reste les neurones miroirs – variation contemporaine sur le désir triangulaire de René Girard. Chez Tanguy Viel, la spécularité des héros masculins est toujours très forte, autorisant ce décollement si caractéristique de l’univers de l’auteur : un personnage voit peu ou prou ses fictions personnelles accomplies dans le corps d’un autre, qui les réalise à sa place et, par là même, le prive de leur réalisation. D’où la comparaison souvent tentée entre son écriture et le cinéma, mais qui est peut-être plutôt à chercher du côté de « l’homme imaginaire » d’Edgar Morin. Le double est ici le fils (« Erwan, c’était comme une pile électrique que j’aurais chargée toutes ces années sans discontinuer ») dans le ventre duquel le père, au pire de sa déchéance et échangeant fantasmatiquement sa place, voudrait retourner, « comme si moi-même maintenant j’étais au fond de sa poche parce que c’est sûr que c’est là que j’aurais voulu être à cet instant, caché dans les replis de l’aine ».
Erwan est né le 10 mai 1981, au moment pile de l’arrivée de la gauche au pouvoir : « On a vu se dessiner sur l’écran de télévision la tête du président Mitterrand, ça, on n’est pas près de l’oublier, le décompte du présentateur qui avait l’air d’aider ma femme à accoucher. » Sa femme s’appelait France. Amateur de solutions faciles, on pourra donc, si l’on veut, prendre ce septième roman de Viel pour une histoire des années 1980 et 1990 – ou plus probablement de notre époque – qui culmine avec une scène où le père se retrouve accroché dans le vide aux poignets de son fils hurlant, « comme un infini qui s’ouvre entre la survie et la mort ».
Jérôme Garcin, L’Obs, 5 janvier 2017
Un homme à l’amer
A la manière du juge, à qui l’article 353 du Code de Procédure pénale permet d’en appeler moins aux preuves qu’à sa conscience, j’ai l’intime conviction que Tanguy Viel est coupable. Non seulement d’avoir beaucoup de talent, mais aussi d’appliquer à son œuvre la rigueur diabolique des grands criminels. Passons sur le meurtre, il est décrit ici en trois pages liminaires. Son auteur raconte comment il a jeté Antoine Lazenec à la mer alors que ce dernier venait de remonter le casier à homard. Lazenec appartenait lui-même à la famille des crustacés. Ce promoteur immobilier véreux avait réussi, dans les années 1990, à escroquer les habitants d’une presqu’île du Finistère et à mettre en faillite la mairie socialiste du bourg côtier. Il avait promis d’y inventer un «Saint-Tropez breton» et avait vendu à crédit les appartements fantômes de cinq immeubles baptisés les Grands Sables, qui ne furent jamais construits. Tandis que les arnaqués noyaient leur détresse dans l’alcool, voire se suicidaient, l’arnaqueur se pavanait en chaussures italiennes et berline allemande sur les ruines de son forfait et sortait, dans la rade de Brest, son Merry Fisher de 9 mètres flambant neuf acheté avec les économies de ses victimes. Parmi lesquelles, Martial Kermeur, la cinquantaine, licencié de l’arsenal, séparé de sa femme, père d’un garçon et gardien du parc d’un château où l’avantageux bonimenteur prétendait édifier son complexe balnéaire. Alors, au juge qui l’interroge et découvre en même temps l’étendue du désastre, Martial Kermeur raconte tout, sans se presser, sans rien cacher, comme s’il flottait. L’arrivée de l’investisseur qui allait sauver la presqu’île et, maquette à la main, fut accueilli en héros; les années qui passèrent et où rien ne se passa; la chape de plomb qui s’abattit sur des habitants saisis par la honte d’avoir été si crédules; la manière (géniale) dont Erwan, le fils de Martial, tenta de venger son père, qui avait été délesté de toutes ses indemnités de licenciement (400.000 francs); enfin, prologue autant qu’épilogue, la chute du grand bandit dans l’eau glacée. Ce roman noir sous couverture blanche est un polar social où le désabusement tient lieu de suspense, une tragédie humaine déguisée en thriller maritime, la confession chabrolienne d’un meurtrier qui a tout perdu, sauf sa dignité et même son honnêteté. Tout cela écrit dans une langue aussi savante que spontanée et construit – contrairement aux Grands Sables – avec la science d’un architecte spécialisé dans les trompe-l’œil, les balcons filants et les lignes de fuite. On frémit. On s’émeut. Et on entend même souffler le vent, force 10. Un grand livre. Ce jugement est sans appel.
David Carzon, Libération, 7 janvier 2017
Tanguy Viel,
Je me laisse habiter par des mondes
Un portrait d’écrivain ne devrait jamais commencer par citer l’endroit, généralement un café, où le journaliste, revêtant ses habits de narrateur, rencontre l’objet de sa convoitise. Trop classique. Déjà fait et refait. Sauf quand il s’agit de Tanguy Viel. Parce que, comme par hasard, cet habitué des faux-semblants qui vous perdent d’abord pour mieux vous retrouver après donne rendez-vous dans un café parisien qui, pour Google Maps, existe à deux endroits différents de la même rue. Et qu’il faut d’abord se tromper d’adresse avant de le trouver assis à une table, sourire malicieux, le cheveu un peu plus blanc que la dernière fois qu’on l’a vu, pas même conscient du tour involontaire qu’il vient de jouer. Nous amener là où il le souhaite, jouer avec les fausses pistes… On serait presque tenté d’en faire une métaphore de son univers littéraire.
S’attarder sur ce lieu pourrait également faire naître une autre confusion. Etre là dans ce quartier parisien des éditeurs à discuter de la rentrée littéraire de janvier avec un auteur d’une prestigieuse maison d’édition revêt en effet toutes les apparences du conciliabule germanopratin. Ce serait oublier la distance, pas seulement physique, que Tanguy Viel, retiré en terre solognote depuis des années, met avec ce monde. Ce serait nier aussi le moment particulier de cette rencontre avec un auteur qui n’a pas encore eu l’occasion de parler de son nouveau livre. «J’ai essayé de me préparer, dit-il, mais je n’ai pas encore toutes les clés. Je les aurai quand j’aurai fait des rencontres en librairies, quand j’aurai parlé avec les journalistes. Là seulement j’aurai compris tous les ressorts du livre, ses reliefs, ses points forts, ses points faibles.» Surtout que, cette fois, il n’a pas de dispositif, pas d’appareil théorique auquel se raccrocher.
Arrêtons-nous un peu sur son œuvre pour mieux saisir l’importance de cet instant. Sept romans en vingt ans avec toujours la même écriture à la fois déliée et incisive et autant de propositions littéraires différentes. Prenons-en quelques-uns. Cinéma est celui avec lequel on l’a découvert. Tanguy Viel y faisait une relecture magistrale du film le Limier de Mankiewicz. Un exercice de style, certes, mais une façon bien à lui d’user de l’écrit pour rendre le cinéma encore plus cinématographique. Dans l’Absolue Perfection du crime ou Insoupçonnable, il nous plongeait dans l’univers du roman noir et du polar sur lequel planait la figure tutélaire d’Hitchcock, dont il se plaît souvent à rappeler les secrets de fabrication. Avec Paris-Brest, dont on verra plus tard qu’il est un cousin direct du dernier en date, il livrait sa version du roman familial. Enfin, la Disparition de Jim Sullivan était à la fois récit et roman du récit puisque son narrateur, un romancier français, nous racontait comment il comptait écrire un roman américain. Une mise en abyme qui jouait avec tous les codes du genre, un atelier d’écriture ironique mais qui n’oubliait pas son véritable but : produire un vrai roman.
«Imaginaire très enfantin»
Présenté comme ça, on pourrait le croire cantonné aux purs exercices de style. Faux-semblant une nouvelle fois car, quand dispositif il y a, c’est pour se mettre au service de l’histoire. «Je n’aime pas qu’on dise que je joue avec les codes, explique-t-il. Je n’ai aucun code, je n’ai jamais lu de polar, je crois que j’ai simplement un imaginaire très enfantin, avec des revolvers, de l’argent, des bandits et des escrocs. Dans chaque livre, je travaille avec des scènes presque matricielles qui m’habitent depuis que je suis gosse. Je ne programme rien.» Et de se souvenir de cette scène avec le directeur commercial de sa maison d’édition au moment de la sortie de l’Absolue Perfection du crime : «"Je crois, me dit-il, que le mieux, c’est d’en parler comme d’un polar bien écrit." Et alors moi, je me dis : ah bon, c’est un polar ?»
De cette image, d’abord il dit : «Tant mieux si cela donne l’impression de maîtrise ou de virtuosité, mais ce n’est pas si vrai. Au fond, on ne sait jamais comment faire un roman, on observe après coup que la méthode est toujours la même. Et il s’agit plutôt d’une absence de méthode. Je me laisse habiter par des mondes, et entre chaque roman, cela prend du temps avant que ces mondes me repeuplent, s’agrègent et cristallisent quelque chose.» Et il précise, pour être sûr qu’il n’y ait pas de malentendu possible : «Jouer avec les codes ? Derrière le mot "jeu", il y a l’idée que mes personnages ne seraient que des marionnettes et que je serais plus intelligent qu’eux. Ce n’est jamais le cas.» Tanguy Viel dit souvent «au fond» avant de commencer ses phrases, dont il pèse les mots. Il cherche le meilleur, l’image la plus juste, il hésite, se reprend. Question de sincérité surtout. On imagine que c’est ainsi qu’il écrit tous les jours.
Si l’on cherche à dégager des lignes de force de ses livres, on trouve un style à la musicalité hypnotique, une narration toujours à la première personne, une unité resserrée de lieu et de personnages, des voix… C’est d’ailleurs une voix mélancolique qui nous attrape dans Article 353 du code pénal, celle de Martial Kermeur, père largué, victime facile d’un escroc qu’il finit par balancer à la mer. «C’est la première fois qu’un personnage n’a pas plus ou moins mon âge, confie-t-il. D’habitude, quand j’écris, j’ai besoin d’une voix qui ne doit pas être si loin de celle de mon grain intérieur. Pour Martial, j’ai entendu naître le grain d’une espèce de fatigue, de quelqu’un qui n’a pas pris le pouvoir sur lui-même - ça encore, ça pourrait être moi - et qui se sent coupable de ne pas avoir mené sa vie comme il l’entendait. Jusqu’alors, je faisais plutôt parler des enfants, des fils surtout. Là, je me suis intéressé à la notion de paternité, de transmission… Une certaine idée de ce qu’était être père, mais un père qui n’a pas plus de prise sur sa vie qu’un enfant.» Un loser ? «Ça me ferait mal au cœur qu’on puisse dire ça. C’est un être normal, médiocre dans tous les sens du terme. La scène sur laquelle je le dispose est un peu superlative, ça pousse les curseurs des ratages, mais ce sont des ratages banals. Tout ça n’en fait pas un loser. D’ailleurs, je n’aime pas ce mot.»
Avec Article 353 du code pénal, Tanguy Viel signe son roman le plus réaliste et assume une forme de premier degré. Voire d’empathie. Même avec Paris-Brest, prequel revendiqué qui pouvait effleurer l’autobiographie, il n’avait pu s’empêcher de faire littéralement un roman dans le roman, manière de garder une certaine distance avec la matière. Là, il nous laisse l’histoire, rien que l’histoire. «Pour moi, il s’agit d’une victoire dans l’écriture, cette envie de recroire dans la fiction au point de raconter une histoire, de jouer uniquement sur les registres de la construction interne, de fabriquer des personnages, des décors, une intrigue, des émotions, des paysages… C’est ça qui m’a fait rêver quand j’ai commencé à écrire. C’est une joie, mais aussi un dénuement.» Le dénuement dans lequel il se trouve ce jour, à devoir mettre des mots sur ce qui était jusqu’alors uniquement un voyage intérieur.
Il touche aussi un peu plus à l’épure avec un décor encore plus resserré (le bureau d’un juge d’instruction) : «Cette épure est ma façon de dompter le chaos de la matière. J’ai besoin de tout théâtraliser, la ville est une maquette, les personnages sont des figurines que je déplace sur cette maquette, et si je n’arrive pas à ce degré d’épure, je suis perdu, ça déborde dans tous les sens. Quand ce que j’ai en tête arrive à l’état de langage, c’est forcément court. J’aime l’idée qu’on puisse le lire d’une traite et qu’il faille se souvenir de la première page quand on arrive à la dernière.» Un traducteur de pavés américains confiait récemment que les romans français devraient être au moins coupés de moitié. Avec Tanguy Viel, il est servi. Mais court veut aussi dire dense et visuel. Chaque phrase, chaque scène est une séquence quasi cinématographique à part entière : «J’ai le sentiment qu’une scène est aboutie quand elle est absolument visuelle. Mon cerveau est un agrégat désordonné d’images et de langage, et le seul moyen d’arrêter ce fleuve mental, c’est quand je fabrique une image, quand je la fixe. J’aimante toute ma pensée, mon énergie pour un instant, je lui donne un cadre, une forme. Je suis obsédé par la fabrication d’une image dans un mouvement.» Ses romans donnent l’illusion d’un film déjà fait mais tout cela ne donne pas du cinéma pour autant, et Tanguy Viel a pu s’en rendre compte avec l’adaptation d’Insoupçonnable. «Une image, c’est une petite boucle syntaxique. C’est la musicalité de cette syntaxe qui produit une image.»
«Poulets et maïs»
A chaque livre, Tanguy Viel fonctionne par collages. Avant même l’intrigue d’Article 353 du code pénal, les premières bribes du livre ont été des fragments d’atmosphères, de paysages, d’engluement dans la vase de la rade de Brest. Cette toile de fond finistérienne vient heureusement contredire la théorie avancée dans la Disparition de Jim Sullivan, qui voudrait que n’importe quel décor américain, même le plus pourri d’entre eux, vaudrait mieux que son équivalent français pour raconter une histoire. «Les Américains ont un avantage troublant sur nous : même quand ils placent l’action dans le Kentucky, au milieu des élevages de poulets et des champs de maïs, ils parviennent à faire un roman international», pouvait-on y lire. Brest, dont Tanguy Viel est originaire, se prête au contraire très bien à l’intrigue de son dernier roman. «Ce territoire très romanesque, je l’ai quitté à l’âge de 12 ans, et ce n’était pas un moment très agréable pour moi. Mon enfance, je l’ai laissée là-bas et cette terre revient souvent dans mes rêves de fiction. La lande, le vent, les maisons en pierre, ce côté Hitchcock et Brontë réunis. A aucun moment, je ne me suis posé la question de mettre mon histoire ailleurs.» Cette région qui devient une sorte de timbre-poste fictionnel à la manière du comté qu’avait inventé Faulkner de toutes pièces pour ses romans. Et voilà comment faire le lien littéraire entre deux continents a priori irréconciliables.
Puisqu’on parle de paternité dans Article 353 du code pénal, il est question forcément d’héritage. Celui que laisse par défaut Martial Kermeur à son fils dans le roman. Celui que Tanguy Viel assume pleinement en tant qu’écrivain. Il sait ce qu’il doit à Jean Echenoz ou François Bon. «Cette génération qui me précède a su faire ce travail de reconquête de la possibilité même de fiction. Echenoz est peut-être celui qui a pris le plus de risques romanesques, y compris en insufflant des éléments de la subculture, avec ce besoin de recharger les batteries de la fiction, de réinjecter de la chair par le roman. Il y a eu la littérature du silence, de la ruine, de la table rase, et eux ont eu envie de refabriquer du vivant. On continue ce travail-là, et quand je dis on, je pense aussi bien à des prosateurs comme Laurent Mauvignier ou Eric Vuillard qu’à des poètes comme Stéphane Bouquet.»
Arrivé au terme de cette rencontre, Tanguy Viel n’a pas eu de souci à mettre de l’image verbale sur son livre, à formuler en tête à tête sa proposition romanesque, mais il ne sait toujours pas trop quoi en penser. Au fond. Au plus il s’attend déjà à ce que sa réception ne le laisse pas indemne : «Ce qui va rester dans ma mémoire sera dépendant de la manière dont le livre sera reçu. Les mois qui vont venir vont transformer et graver l’image que je vais avoir de lui. Son écriture aura été un moment plutôt gracieux. Mais ce que j’en pense ne changera rien à son destin. Si tout le monde le déteste, je le détesterai. La vraie vie d’un livre, c’est sa vie sociale. Souvenons-nous d’Hitchcock, les films qu’il aimait le moins sont ceux qui avaient le moins marché, et dedans il y avait Vertigo.»
Et après ? Sait-il déjà où il veut aller ? Non, pas tant qu’il n’aura pas digéré celui-là. «Le livre suivant naît souvent en réaction du précédent, parce que j’ai épuisé quelque chose et ça me donne envie d’aller ailleurs, explique-t-il. Ou par insatisfaction contre moi-même.» Le temps qu’il cristallise un nouveau décor et une nouvelle intrigue dans sa tête, il écrit des essais, des réflexions sur l’écriture, la littérature. «Ça m’occupe beaucoup quand le territoire romanesque est vierge, et ça m’évite de me retrouver dans le vide.» Et où peut-on les trouver, ces essais ? «J’ai le temps, on les publiera plus tard.» De l’art, une nouvelle fois, de mettre son lecteur sur une nouvelle piste tout aussi captivante.
David Carzon, Libération, 7 janvier 2017
Père bancal et code pénal
Nouveau roman en « cinémascope »
Ne cherchez pas à comprendre trop vite l’origine du titre du dernier roman de Tanguy Viel. Sachez juste que cet article du code pénal existe vraiment, qu’il y est question d’intime conviction, et qu’il viendra clore de manière inattendue le tête-à-tête entre un juge d’instruction et un homme accusé de meurtre. Cet homme, c’est Martial Kermeur. Ce chômeur vivant seul avec son fils dans l’annexe d’un château presque abandonné vient de passer par-dessus bord un promoteur véreux qui a profité de sa faiblesse. Martial retrace ainsi au juge le cours des événements qui l’ont amené à ce geste ultime : son licenciement de l’arsenal de Brest, la difficulté à élever son fils seul après son divorce, la tentation d’investir sa prime de départ dans un projet immobilier foireux, la honte de s’être fait arnaquer…
Une seule scène condense à elle seule tous les enjeux du livre : Martial se retrouve accroché à la nacelle d’une grande roue dans laquelle se trouve son fils et il parvient à lui faire faire demi-tour après avoir risqué sa vie. Comme s’il était accroché aux aiguilles d’une horloge et qu’il réussissait à remonter ce temps qui lui échappe. Comme s’il parvenait à revenir en arrière pour gommer ses erreurs. La seule et unique fois où il aura une prise sur son destin et le devenir de son fils. Car pour le reste, c’est l’engrenage infernal pour ce père un peu bancal, qui ne comprend pas grand-chose du monde qui l’entoure et qui essaye de faire comme il peut. En toile de fond, il y a les années 80-90, prélude à tous les délitements d’aujourd’hui, ce moment où ont commencé de s’effondrer nos croyances. Et Martial est typique de cette gauche molle qui a choisi de ne plus s’accrocher à ses idéaux.
Ce livre a un lien de parenté direct avec Paris-Brest. On y retrouve le fils Kermeur qui gagne là un prénom, Erwan, et un passé. Celui d’un enfant qui voit son père rater tout ce qu’il peut entreprendre, partir à la dérive, et qui va finir par réagir à sa place. «Un fils n’est pas programmé pour avoir pitié de vous», constate, plus désabusé qu’amer, Martial Kermeur. On y retrouve surtout la narration «cinémascope» de Tanguy Viel, son style à la fois parlé et écrit, la construction implacable de son intrigue jusqu’à son dénouement… La figure du juge, elle, est là pour ponctuer les humeurs du lecteur : elle remet du sens, pose les bonnes questions, on s’agace et s’émeut avec lui de ce père incapable de réagir. Moins référencé que les romans précédents, plus intimiste, Article 353 du code pénal laisse en tête de belles séquences, comme cette scène où Kermeur, ivre de mauvais whisky, hurle des insultes dans le vent. Et il subsiste un sentiment un peu jouissif de ce que seule permet la fiction : la mort du salaud. Jouissif quand il s’agit de mettre à l’eau un escroc sans en faire une question de morale. Jouissif comme la scène où Tarantino fait buter Hitler dans Inglourious Basterds. A la fois envoûtante et percutante, l’écriture de Tanguy Viel ne nous lâche jamais, un peu comme ce juge bien décidé à ce que Martial Kermeur finisse par dire tout ce qu’il avait sur le cœur. Et qu’il retenait depuis tant d’années.
Du même auteur
- Le Black-Note, 1998
- Cinéma, 1999
- L'Absolue perfection du crime, 2001
- Insoupçonnable, 2006
- Paris-Brest, 2009
- La Disparition de Jim Sullivan, 2013
- Article 353 du code pénal, 2017
- Icebergs, 2019
- La Fille qu'on appelle, 2021
- Vivarium, 2024
Poche « Double »
- L'Absolue perfection du crime , 2006
- Insoupçonnable , 2009
- Paris-Brest, 2013
- La Disparition de Jim Sullivan, 2017
- Cinéma, 2018
- Article 353 du code pénal, 2019
- La Fille qu'on appelle, 2023
- Cet homme-là, 2024
- Ni Rose ni poème, 2025
Livres numériques
- Insoupçonnable
- L'Absolue perfection du crime
- Le Black-Note
- Paris-Brest
- La Disparition de Jim Sullivan
- Cinéma
- Article 353 du code pénal
- Icebergs
- La Fille qu'on appelle
- Vivarium
