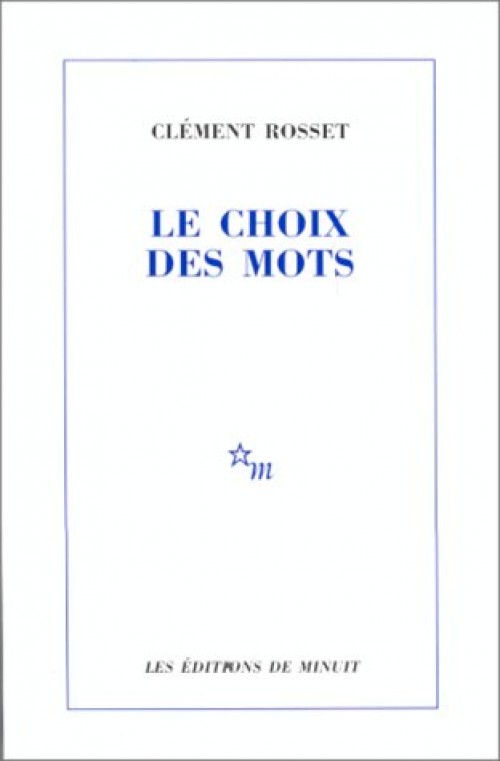
Clément Rosset
Le Choix des mots
suivi de La Joie et son paradoxe
1995
160 pages
ISBN : 9782707315397
14.80 €
Du plaisir d’écrire à la joie de vivre, et inversement. Du plaisir des mots au plaisir tout court, et vice-versa.
Le choix des mots est affaire sérieuse. Il signale toujours une certaine forme d’adoption – ou de refus – des choses, d’intelligence ou de mésintelligence de la réalité.
‑‑‑‑‑ Table des matières ‑‑‑‑‑
Le choix des mots – La joie et son paradoxe – La force comique – L’Espagne des apparences
ISBN
PDF : 9782707331878
ePub : 9782707331861
Prix : 10.99 €
En savoir plus
Michel Onfray (L’Événement du jeudi, 21 décembre 1995)
Voyage au pays du réel
Comment un auteur averti de la vanité de toute chose comme Clément Rosset peut-il continuer à écrire et à publier ? Réponses – brillante et drôle – dans son nouveau livre, Le Choix des mots.
« Lire Clément Rosset, c’est un peu entendre sa voix raconter une pensée qui se fait et se déplie comme lors d’une conversation où l’intelligence brillante est servie par une clarté redoutable. Depuis plus d’une dizaine de livres, cette musique dure et produit des variations sur le thème du réel et de son usage. Sans avoir l’air d’y toucher, et avec une détermination inentamée, Clément Rosset a tout simplement proposé une éthique à l’usage de ceux qui, sachant la nature tragique du réel, n’ont toutefois pas envie de se mettre une balle dans la tête. La prouesse mérite considération.
Rosset ne pense pas à partir des livres et n’a pas souci des entregloses. Et s’il cite, c’est plus volontiers un fait divers ou un morceau de bravoure extrait de la vie quotidienne qu’une référence à Kant. Par exemple, dans Le Choix des mots, la lettre d’un fonctionnaire du ministère des Affaires sociales et de l’intégration nommé Nicolas Dufourcq qui, avec un courrier adressé à l’auteur, a perdu une occasion de se taire.
La question de l’apprenti penseur : pour quelles raisons un philosophe averti de la vanité de toute chose comme Clément Rosset peut-il écrire et publier des livres malgré tout ? Réponse en forme de fusées, de pointes, d’ironie et de drôlerie, sinon de sarcasmes à peine contenus : pour lui-même, et personne d’autre, dans le seul but d’éclairer et d’éclaircir des pensées qui occupent son esprit. En fait, toutes les questions que se pose Rosset semblent se réduire à une seule : “ Comment concilier l’amour de l’existence avec l’ensemble des arguments plausibles ou raisonnables qui tous contribuent à tailler celui-ci en pièces ? ” Redoutable...
Aussi, de livre en livre, un peu Voltaire pour la conscience du pire, un peu Leibniz pour la rhétorique du meilleur des mondes, Clément Rosset propose une théodicée à lui tout seul en présentant une option qui suppose le savoir d’un réel tragique et l’adhésion au monde tel qu’il est. On reconnaîtra ici une double problématique issue de Schopenhauer et de Nietzsche, dont Rosset est d’ailleurs l’un des exégètes les plus fins à l’heure actuelle.
Pour démontrer avec une infaillibilité quasi socratique, Clément Rosset convie des contes arabes ou des opéras kitsch qu’il est le seul à connaître. Ainsi, à l’aide d’un homme au nez duquel est pendu un morceau de boudin, d’une femme transformée en porc, d’un roi qui parade tout nu, d’un convive qui se renverse le contenu d’un saladier sur la tête ou d’un sacristain caché dans une huche – la liste est ouverte –, on assistera à l’émergence de vérités qui méritent plus qu’un coup d’œil distrait. Par exemple : que vivre est déjà en soi une joie ; que la joie de vivre est la somme des joies dans la vie ; que vouloir échapper au réel, c’est risquer de le retrouver en pire ; que le désir ne tient jamais ses promesses ; que l’ignorance de ce qu’ils peuvent est la cause de la misère des hommes ; que le désir est pénible, sa réalisation plus pénible encore ; que la désillusion engendre la sérénité ; que, pour l’essentiel, le réel ne se modifie pas en profondeur. D’où la sagesse qui en découle et qu’en une phrase on peut ainsi formuler : réjouissons-nous, car le pire est toujours certain.
Si le cœur de cette morale tragique est dans le savoir inévitable du pire, on peut tout de même s’arrêter sur ce qui, ailleurs, mais pas autrement, fait le réel. Ici la musique de Rossini, là quelques feuillets de Nietzsche adolescent, ailleurs les raisons pour lesquelles le comique est une force, ou enfin de belles et pénétrantes pages dans lesquelles il est montré que le peuple espagnol est le plus philosophe et le moins métaphysicien des peuples.
Sortant de la lecture de ce petit livre d’une densité qui a la politesse de ne pas apparaître au premier regard, on aura envie de passer de la dernière page à la première, à nouveau, comme pour montrer la pertinence de la thèse qui veut que l’on n’échappe pas au réel et à son éternel retour quand il est ainsi quintessencié et sublimé. »
Jérôme Garcin (L’Express, 23 novembre 1995)
Rosset : la ligne claire
Clément Rosset le prouve : un désespéré peut, et doit, écrire dans la joie.
« II préfère Montaigne à Sartre, Schopenhauer à Heidegger, la cruauté à l’optimisme, et surtout le réel, sa grande affaire, aux concepts, qui le font rire. Il écrit dans une prose joyeuse des livres insolents, purgés de tout jargon. Il ajoute au gai savoir la politesse de l’intelligence. On voit par là que Clément Rosset n’est pas du tout un philosophe à la mode.
Cela fait trente-cinq ans que l’auteur de Logique du pire parle en effet du tragique avec allégresse et du désespoir sans tristesse. Son hédonisme est désabusé et son matérialisme, lucide. Tenant avec les présocratiques et Raymond Devos que la métaphysique est une tautologie, il dit ce qui est dans la langue de tous les jours, il adhère au réel en évitant de faire du bruit. Ne se berçant jamais d’illusions, ne feignant pas de croire à un monde meilleur, doutant des vérités absolues, se moquant des utopies politiques, écologistes ou religieuses, cet homme sans idéal est heureux ici-bas. Il n’est pas loin de plaider pour l’idiotie dont, naguère, il rédigea le traité. Son pessimisme euphorique est contagieux.
Pour comprendre comment cet esprit flaubertien qui déteste séduire nous plaît tant, il faut lire Le Choix des mots. Tout ce qu’il écrit depuis La Logique du pire est dans cette brève et ironique digression. Clément Rosset y répond à un certain M. Dufourq, employé au ministère des Affaires sociales, qui lui reproche d’avoir cédé à la complaisance de l’écriture alors même que sa philosophie du désespoir eût dû le mettre à l’abri de cette folie, de cette vanité. Piqué, Rosset réplique en expliquant comment le plaisir d’écrire est une dépendance de l’amour de vivre, et pourquoi seul ce plaisir-là lui permet d’établir une pensée, d’accéder à une “ conscience morale ”. À cet éloge très simple du Choix des mots fait suite une étude, qui en est le corollaire, sur La Joie et son paradoxe. Où l’on constate que, dans la famille des pessimistes, Clément Rosset est non seulement fréquentable mais aussi bienfaisant. »
Pierre Lepape (Le Monde, 29 décembre 1995)
La raison paresseuse
« Clément Rosset est un philosophe qui aime les choses simples. Voilà trente-cinq ans maintenant – c’était alors un tout jeune homme, juste sorti de la rue d’Ulm et du concours d’agrégation – qu’il nous répète, avec talent, que le compliqué est une illusion. Son premier livre s’intitulait La Philosophie tragique (Presses universitaires de France, 1971). Le brillant étudiant y épelait encore la pensée de ses maîtres, Spinoza, Schopenhauer et Nietzsche, mais le ton était déjà bien à lui. L’expérience immédiate, disait-il, que nous avons du réel est celle de l’irrémédiable, de l’unique : le réel n’est que ce qu’il est ; il n’a pas de sens. Et comme nous ne supportons pas le tragique de cette cruelle absence, nous nous racontons des histoires, nous nous fabriquons des illusions. À ce réel insupportablement simple et muet nous inventons des doublures, et qui parlent. Nous nous faisons croire que ce qui est est aussi autre chose.
Sur ces bases, et en bon philosophe, Rosset s’attelle donc à la démolition de toutes les philosophies qui ont précédé la sienne, toutes accusées, à des degrés divers, de participer à la grande entreprise d’illusionnisme et de consolation. Dans Le Réel et son double (Éditions Gallimard, 1976), il démonte minutieusement les artifices de la pensée qui tendent à envelopper de brumes “ l’idiotie du réel ”, son caractère unique, particulier, sa simplicité : les mythologies, les métaphysiques, les religions, les arts, la littérature, mais aussi l’action. Comment croire en effet sans duperie qu’on puisse changer le réel puisqu’il ne peut pas être autre chose ?
Rares sont, par chance, ceux que la logique d’une telle pensée mène au suicide ou à la folie. Clément Rosset, d’ailleurs, n’y pousse pas du tout. Il a le nihilisme joyeux. Dans Le Choix des mots, il souligne que toutes les questions qu’il se pose peuvent se ramener à une seule : “ Comment concilier l’amour de l’existence avec l’ensemble des arguments plausibles et raisonnables qui tous contribuent à tailler celui-ci en pièces ? ” Rosset pense qu’on peut, malgré tout, aimer vivre sans se mentir à soi-même. Quand on s’est débarrassé de toutes les illusions, de tous les “ chichis ”, de toutes les doublures trompeuses, alors on peut goûter au bonheur pur, sans prix, sans spéculation : celui de vivre, tout simplement. Voilà au moins qui nous change de tous ces écrivains qui passent – littérairement – leur existence le pistolet sur la tempe et le dégoût du monde à la bouche, jusqu’au tréfonds de leur vieillesse. Chaque ligne d’eux semble écrite comme si elle devait être la dernière – l’ultime goutte de lie au fond du calice ; mais c’est un élixir de longue vie.
Traqueur impitoyable, donc, de toutes nos commodes illusions, Clément Rosset n’est pas parvenu à se débarrasser de l’une d’entre elles, bien fragile pourtant et bien malmenée : celle d’écrire des livres. Un lecteur de notre nihiliste lui en a fait le reproche. Avec une certaine logique, ce lecteur, M. Dufourcq, lui a fait remarquer qu’il y avait quelque inconséquence à montrer l’absurdité de toute chose et à édifier des monuments de papier. Il y a de la folie à écrire sur la sagesse de vivre ; les bouddhistes savent cela depuis longtemps. Rosset lui répond, et il en fait, évidemment, un livre, de petite taille il est vrai, et davantage composé de départs, d’incidentes, de parenthèses, d’apologues et de virevoltes que de développements raisonnés. Pour l’amateur de littérature, c’est un aimable plaisir, agréablement cultivé ; mais il n’est pas sûr que la pensée y trouve toujours son compte.
Nettoyée de ses arabesques, de ses citations et de ses souriants collages, la réponse de Clément Rosset à l’interpellation de son correspondant – pourquoi vous donnez-vous la peine d’écrire et de publier des livres ? – tient en quelques mots : “ L’écriture et elle seule (...) me permet, à moi comme à tout le monde, d’établir une pensée. ” L’écriture est la pensée elle-même : “ Il n’y a de pensée qu’à partir du moment où celle-ci se formule, c’est-à-dire se constitue par la réalité des mots. ” On voit rejoindre ici l’idée de simplicité chère à l’esprit du philosophe. Il s’agit toujours de ramener le double – la pensée puis les mots qui l’expriment – à l’unité : l’idée dans le mot. C’est un peu comme si, contemplant un litre d’eau minérale sur une table, Rosset refusait de distinguer la source et la mise en bouteille. Il constate que si l’on enlève le récipient, l’eau a tendance à se répandre et qu’il est plus difficile de boire. Donc...
Il rejoint ainsi, en les radicalisant à peine, les plus académiques principes de notre classicisme. Sur le célèbre vers de Boileau – “ Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement ” –, il surenchérit d’un “ Ce qui se conçoit est ce qui s’énonce. ” Boileau se cantonnait à un précepte stylistique, à un proverbe de maître d’école ; Rosset édicte un dogme de la connaissance. Peut-être a-t-il raison, peut-être pas ; peut-être son affirmation est-elle juste, peut-être est-elle fausse. Peut-être encore est-elle juste dans certaines limites et fausse en deçà et au-delà. On aimerait en discuter, plutôt que de collectionner de précieux paradoxes. Sans doute Clément Rosset possède-t-il dans sa trousse mentale les outils nécessaires à nous convaincre ; c’est un bon professionnel de la discussion philosophique. Mais c’est comme s’il répugnait à les employer, comme si cette lourde et banale mécanique d’arguments, de raisonnements, d’objections et de démonstrations lui gâchait le plaisir d’écrire. À la discussion, il préfère le jeu des citations et les exemples – qui ne sont jamais des preuves. Ainsi va-t-il chercher à l’appui de ses dires quant à l’antériorité du mot sur l’idée, “ le fait que Debussy ait-écrit le titre de ses Préludes à la fin et non au début de chacun d’entre eux ”. Pierre Desproges et M. Cyclopède n’auraient pas dit mieux.
Aux exemples que Clément Rosset invoque pour sa thèse, il est toujours possible d’opposer autant de contre-exemples. Celui de Paul Valéry, pour en prendre un célèbre et qui ne passe pas pour un penseur balbutiant et inexact. Valéry regrettait d’être obligé d’écrire et “ d’épeler aux gens ce que l’on voit en un clin d’œil. On en arrive à ne plus réfléchir à ce qui est inécrivable ”. Et l’auteur de l’Introduction à la méthode de Léonard de Vinci et d’Eupalinos pestait de gaspiller tant d’énergie pour penser à écrire alors qu’il la souhaitait mobilisée tout entière pour penser à penser. On sait pourquoi, en fin de compte, il s’est résigné à faire des livres : pour nourrir sa famille. Il appelait ça joliment : “ Le souci de Mammon. ”
Clément Rosset n’avoue pas ce genre de préoccupation. II écrit pour lui-même, pas pour les sous, pas pour la gloire, pas pour la postérité. Pas davantage pour le public. En matière d’écriture, ce penseur radical opte finalement pour un régime constitutionnel très mitigé, pour une entente cordiale de la vie et du papier. Les pommiers, dit-il, donnent des pommes, lui tout aussi innocemment donne des livres. Qui veut en goûter les ramasse, quitte à les recracher. On voit, à cette image, comment le philosophe rend simple le réel : il le réduit, jusqu’à l’abstraction. Dans les faits, dans les processus d’élaboration, de création, de diffusion et de réception d’une œuvre – philosophie ou poésie, roman ou chansonnette, opéra ou tableau –, il entre beaucoup plus de complexité que ne voudrait nous le faire croire cette naïve métaphore de l’arbre, de ses fruits et des ramasseurs de hasard. À commencer par ceci : qu’une œuvre, quand elle vit, est une expérience collective dont le sens n’est pas donné une fois pour toutes par l’auteur, mais aussi par ceux qui l’accueillent, en jouissent, la jugent, la refusent, la choisissent ou l’oublient.
Les nihilistes, il est vrai, n’ont que faire de l’histoire. Des formes du temps, ils ne connaissent que l’instant de la joie et l’éternité de la tragédie. L’extase de l’inutile et le ressassement du pire. C’est peut-être aussi pourquoi, dans l’exercice de la pensée, ils préfèrent souvent le mot qui fixe et qui ferme à la syntaxe qui orchestre les différences. Leur Rien qui a réponse à tout leur offre une pensée qui arrête la pensée. Cela permet à quelques-uns d’entre eux de paraître profonds à peu de frais, sous prétexte qu’ils ruminent à longueur de vie les mêmes vocables, cueillis au bord du gouffre. Rosset vaut mieux que cela. Il aime encore penser et son esprit est trop riche pour n’avoir déjà plus qu’une seule opinion sur chaque question. Il subsiste dans Le Choix des mots des traces de lutte, au-delà des affirmations péremptoires ; et des questions qui ne sont pas complètement étouffées par les réponses. Mais le risque existe que cette belle machine tourne un jour à vide, par esthétisme, par goût doctrinaire de la passivité et de l’inaction.
C’est ce que reprochait autrefois Leibniz à Fénelon et aux quiétistes, ces précurseurs mystiques de Schopenhauer : “ Quant à l’avenir, il ne faut pas être quiétiste et attendre les bras croisés ce que Dieu fera, selon ce sophisme que les anciens appelaient logon aergon, la raison paresseuse. ” »
Du même auteur
- Le Réel. Traité de l'idiotie, 1978
- L’Objet singulier, 1979
- La Force majeure, 1983
- Le Philosophe et les sortilèges, 1985
- Le Principe de cruauté, 1988
- En ce temps-là, 1992
- Principes de sagesse et de folie, 1992
- Le Choix des mots, 1995
- Le Démon de la tautologie, 1997
- Loin de moi, 1999
- Le Régime des passions et autres textes, 2001
- Impressions fugitives, 2004
- Fantasmagories, 2006
- L'École du réel, 2008
- La Nuit de mai, 2008
- Tropiques. Cinq conférences mexicaines, 2010
- L'Invisible, 2012
- Récit d'un noyé, 2012
- Ecrits intimes. Quatre esquisses biographiques suivi de Voir Minorque, 2019
Poche « Reprise »
Livres numériques
- L'Invisible
- Le Réel. Traité de l'idiotie
- Principes de sagesse et de folie
- Récit d'un noyé
- En ce temps-là
- Fantasmagories
- Impressions fugitives
- L’Objet singulier
- La Force majeure
- La Nuit de mai
- Le Choix des mots
- Le Démon de la tautologie
- Le Philosophe et les sortilèges
- Le Principe de cruauté
- Le Régime des passions et autres textes
- Loin de moi
- Tropiques. Cinq conférences mexicaines
- Ecrits intimes. Quatre esquisses biographiques suivi de Voir Minorque
