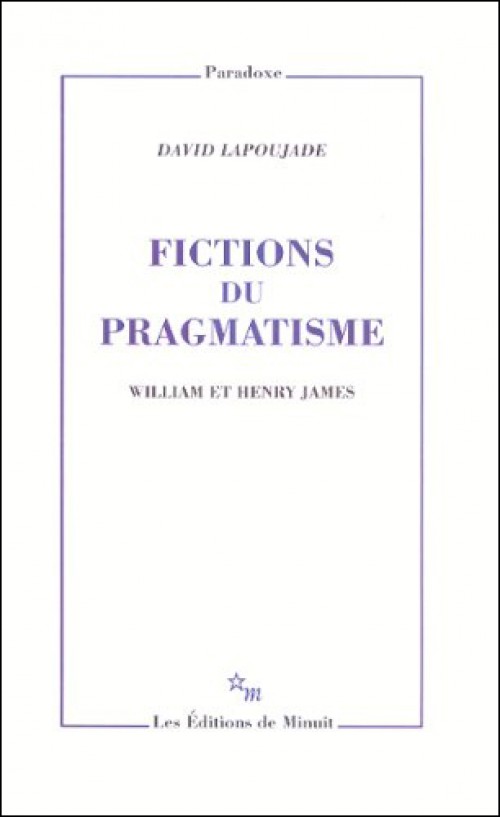
David Lapoujade
Fictions du pragmatisme
William et Henry James
2008
Collection Paradoxe , 304 p.
ISBN : 9782707320391
29.40 €
Tout oppose les œuvres de William et Henry James, le philosophe américain fondateur du pragmatisme (1842-1910) et le romancier, auteur de Portrait de femme et des Ailes de la colombe (1843-1916). L'un se présente comme le philosophe des vérités concrètes, l'inventeur d’un empirisme « radical », résolument tourné vers une pensée pratique sans cesse reconduite vers l’expérience directe des réalités sensibles ; l’autre se présente au contraire comme le romancier de l’indirect et dresse le portrait de consciences qui ne cessent de s’interpréter les unes les autres en s’éloignant toujours davantage du socle des certitudes sensibles. Mais s’agit-il d’une opposition ? N’a-t-on pas en réalité affaire à une sorte d’échange ou de vol mutuel ? L’un fait de la philosophie une sorte de roman d’aventures tandis que l’autre fait du roman la forme réfléchie par excellence, le récit du mental et de ses modes de raisonnements. L’un fait de l’action le nouveau centre de gravité de la philosophie ; l’autre fait de la pensée le nouveau sujet du roman, comme si chacun volait à l’autre ce qui jusqu’alors lui revenait de droit. C’est ce vol ou cet échange dont il s’agit ici de faire le récit conceptuel.
ISBN
PDF : 9782707331113
ePub : 9782707331106
Prix : 20.99 €
En savoir plus
Daniel Binswanger, Les Inrockuptibles, 13 mai 2008
Alors que tout semble opposer Henry James, l'écrivain psychologue éthéré, et son frère William, le philosophe chantre de l"action, David Lapoujade démontre que les frères James étaient engagés dans une même et unique aventure.
D’un côté, le philosophe William James, fondateur du pragmatisme américain, inventeur du « flux de la conscience », théoricien de l’inconstance qui caractérise l’esprit humain. De l’autre, son frère Henry, esthète délicat comme les personnages qu’il dessine dans ses nouvelles et ses romans, Bostonien passionné par la culture européenne, maître du récit piégé par des points de vue subjectifs, des flottements subtils, des intrigues confondantes. Tout semble opposer le philosophe chantre de l’action et l’écrivain psychologue éthéré. Or dans son nouveau livre Fictions du pragmatisme, David Lapoujade, spécialiste de Deleuze, démontre que les deux frères étaient engagés dans une même et unique aventure.
Leurs œuvres explorent chacune à sa manière les méandres de « l’expérience pure ». Quelle est la nature de l’expérience saisie dans son immédiateté brute, dans sa force vitale, dans sa richesse complexe et d’emblée immaîtrisable ? Quel est le fondement de la psychologie humaine ? La question est aussi vieille que la philosophie occidentale. Dès l’Antiquité, elle impose la distinction entre la forme, essentielle, et la matière, futile et contingente.
C’est exactement ce dualisme que les deux frères de Boston s’appliquèrent à réfuter. Les deux auteurs, selon David Lapoujade, ne sont pas les tenants de ce subjectivisme exsangue dont on a souvent voulu les accuser. Ils élaborent une véritable métaphysique de l’empirisme. Ils dégagent le fondement de la totalité de l’expérience, « une texture fibreuse, un fouillis de motifs informes », selon la formule d’Henry dans Le Regard aux aguets. « La seule étoffe primitive », comme l’écrit William dans son Essai d’empirisme radical. Quelque chose précède la scission entre la conscience et le monde ; un tissu épaissit le clair-obscur des données immédiates de la conscience ; une matière visqueuse alimente le flux chaotique de notre vie intérieure dont toutes les représentations et tous les concepts ne semblent être que des dérivés.
Ce n’est pas pour autant que les frères James deviennent les apologistes de l’innocence spontanée. Les données psychologiques ont beau être brutes, elles ne sont jamais simples. La totalité s’actualise dans le présent, mais elle n’est jamais saisissable. Le tissu de l’expérience n’a de cesse de se tramer, mais il n’est ordonné par aucun principe. Dans l’univers romanesque d’Henry James, les personnages sont toujours aux prises avec la représentation incertaine et incomplète du monde. Toute perception n’y est que reflet, ombre, fantôme. Dans la psychologie de William James, l’expérience n’est pas régie par les concepts, elle fait seulement émerger des « lignes d’ordre ». Les deux frères sont d’authentiques représentants d’un ethos profondément américain : l’art de s’aventurer dans l’incertain, de se projeter dans l’inconnu, de se perdre dans l’espace des possibles.
David Lapoujade ne se cache pas de la profonde inspiration deleuzienne de son travail. Il s’intéresse depuis longtemps à l’œuvre de William James, mais il est également l’éditeur d’un recueil posthume de Deleuze, L’Ile déserte et autres textes. De manière virtuose, l’auteur inscrit la philosophie du pragmatisme dans la pensée de l’immanence telle qu’elle a été élaborée par Deleuze et Guattari. De façon non moins limpide, il assimile Henry James, le plus européen des auteurs d’outre-Atlantique, au mouvement de la déterritorialisation, à l’héroïsme de la fuite et de la rupture qui fait, selon Deleuze, la puissance visionnaire de la littérature américaine.
Qu’est-ce qu’une fratrie ? demande Lapoujade. C’est quand l’intimité entre les êtres est si grande qu’un petit écart peut engendrer les différenciations les plus étonnantes. En portant la pensée de l’immanence sur le terrain du pragmatisme américain, l’auteur réussit un exploit surprenant. La fratrie deleuzienne a de beaux jours devant elle.
Christian Descamps, La Quinzaine littéraire, 1er juin 2008
Exigeant, cet ouvrage écrit avec la rigueur de l’université des grands siècles, a l’ambition de réconcilier les frères James, William le philosophe – hérault du pragmatisme – et Henry le subtil écrivain du Tour d’écrou, tant aimé des cinéastes. Il s’agit, ici, de saisir des observations, des expériences, des logiques de signes qui sont des règles d’action. Pourtant l’auteur – fin connaisseur de Gilles Deleuze dont il a préparé l’édition – ne fait pas des frères un bloc. Tout au contraire, il les éclaire l’un par l’autre, les met en perspective ; il nous fait entendre, en stéréophonie, une recherche ou littérature, philosophie et vie, ne font qu’un.
William James valorise l’action, l’immédiateté du « flux de conscience » ; Henry, la pensée, l’ébullition cérébrale, l’intelligence extrême. De fait, dans les deux cas, nous voilà renvoyés à une forme d’expérience refusant toute scission entre le percevant et le perçu. Ce que l’on éprouve est toujours perception et réalité perçue ; nous sommes plongés au sein d’une matière première, d’une étoffe (stuff) fondamentale ; au reste, ce milieu de « relations concrètes » refuse le vieux dualisme de la matière et de la pensée.
Henry ne s’intéresse qu’à des personnages « intensément conscients », révélés, dévoilés, par un problème auquel ils s’affrontent. Soit les esthètes, si nombreux dans l’œuvre de l’auteur des Ailes de la colombe. Leur quotidien entend échapper à la vulgarité du monde, au nom d’une conduite « supérieure ». Par le fait, leur vie s’organise autour d’idées tellement abstraites qu’elles conduisent, fréquemment, à des catastrophes. Pensons à la fameuse Isabelle Archer – cette chasseresse, comme l’indique son nom – de Portrait de femme. Cette belle et jeune Américaine « émancipée », ne cesse de proclamer son désir de faire des choix d’existence. Elle avance fièrement : « Oui, je me crois assez indépendante, en effet. Mais cela ne m’empêche pas de désirer savoir ce qui ne se fait pas. – Pour le faire ? demande sa tante. – Pour choisir, répond-t-elle. »
Néanmoins, cette soif de liberté associée à sa vanité – « sa plus grande terreur était de paraître étroite d’esprit ; la seconde qui ne lui cédait que peu, de l’être réellement » – et à son orgueil la jettera dans les rets des cyniques. Bref, une conception dogmatique de la liberté contrarie – dans les faits – (pragmatiquement, dirait le philosophe) toute liberté effective, authentique. Au fond, le grand tort d’Isabelle c’est « d’imaginer un monde de choses sans substance, que son imagination ne sait pas bien saisir (she had not read him right) ».
Très souvent la vérité, comme la liberté, tournent mal dès qu’on réduit ces notions à de pures questions de principes, dès qu’on fait du monde un spectacle (« Isabelle regardait l’Angleterre comme un enfant Guignol) ». En vérité, de manière différente chez les deux frères, il s’agit toujours de fuir les valeurs hypostasiées ; il convient de savoir s’ouvrir au perspectivisme, cette incarnation des points de vue, cette souplesse qui n’a rien à voir avec la mollesse veule du relativisme. A bien des égards, les actes de la pensée, ces actes de langage ne cessent de renvoyer les deux frères du littéraire au philosophique. Lapoujade brassant l’ensemble des deux œuvres nous donne envie de les relire ; car chacun sait qu’on ne lit jamais les chefs-d’œuvre mais qu’on les relit toujours, comme le notait Calvino.
Ainsi, dans le tapis de « l’expérience pure », nous rencontrons tantôt des oppositions, Europe/Amérique, jeune fille/vieille fille, résolution/incertitude, tantôt des lignes de fuite, brouillant les repères. Dans cette veine, les individus incarnent des personnages sociaux, en relation, adéquate – ou non – aux situations. Au demeurant, si l’école de sociologie de Chicago se réclame explicitement de William James, c’est parce qu’elle étudie, avec soin, des zones sociales mitoyennes où se frottent des groupes. Dans ces espaces interstitiels, on va voir se déployer – chez les gangs de Chicago comme dans l’aristocratie d’Henry James – des « hommes frontières ».
Chez les James – leur père était l’ami d’Emerson – chaque univers est traversé de mondes variés. Du reste, les mondes des affaires, comme ceux des arts ou de la politique sont subdivisés, à leur tour, en cercles. Nous voilà devant des kaléidoscopes que seule une conception pluraliste se révèlera capable de saisir. Au demeurant, le champ social est construit à partir de distances établissant – ou non – des continuités entre les expériences… En l’espèce, chez les deux frères, la vérité est prise au sérieux, pragmatiquement ; car chaque vérité nous modifie, pratiquement ; c’est d’ailleurs pourquoi nous la refusons plus souvent qu’à son tour. Certains personnages pâtissent d’être vraiment trop bêtes, mais d’autres – beaucoup plus nombreux – souffrent d’un excès d’intelligence, de raffinement, d’une irrésolution rendant incapable d’habiter le monde…
A la réflexion, le philosophe fait de ses écrits une sorte de roman d’aventure alors que le romancier incarne la pensée dans des personnages de roman. Toutefois, à leur façon, les deux frères décrivent des manières de « posséder ». Le « je vous veux à moi » va prendre dans les romans des formes multiples. Tout sera bon ; le vampirisme, l’hypnotisme, la séduction se révéleront des moyens d’appropriation. Plus, chez le philosophe, c’est le « moi » lui-même qui est affaire de possession. On peut lire dans les Principes de la psychologie : « Il est clair qu’entre ce qu’un homme appelle moi et ce qu’il appelle simplement mien, il est difficile de tracer une ligne… Dans son sens le plus large, cependant, le moi d’un homme est la somme totale de tout ce qu’il peut dire sien. »
Très concrètement, il s’agit de préserver un espace de vie privée, opposé à l’obscénité de la publicité croissante, à l’exposition permanente du misérable tas de petits secrets. Toutefois, ma possession est aussi pleine de risques car elle n’est jamais très loin de la prédation. Tout bien pesé, la littérature américaine est hantée par la chasse, la traque ; celle des baleines chez Melville, des Indiens chez Fenimore Cooper, pensons aussi au Cormac MacCarthy de No country for old men… Du reste, philosophiquement, William James compare, à plusieurs reprises, la « visée » du sujet connaissant à un tir sur cible ; pour l’heure, comment ne pas se souvenir de William Burroughs visant (comme Guillaume Tell) des objets posés sur des cibles vivantes ? Sous ce rapport, les chasses à l’homme ne sont sans doute pas tellement éloignées des quêtes – plus raffinées ? – aux maris dans le « marriage market ».
Bien sûr, on ne trouvera pas chez les James de châteaux hantés, de crimes, d’enlèvements ou de duels. Par contre, on croisera – et c’est tout aussi palpitant – les aventures du « faire croire ». Quand un personnage dit d’une jeune fille : « Je la connais extrêmement bien » et qu’un autre lui réplique « Qu’entendez-vous par là ? », il ne lui demande, bien évidemment pas, le sens des termes employés. Il pointe une difficulté, une incertitude des jeux de langage. A cet égard, Pierre Bourdieu faisait remarquer que le fameux « What do you mean exactly by that ? », (Qu’entendez-vous exactement par là ?) des philosophes analytiques pouvait, selon les contextes, se traduire soit par « Vous en êtes encore là ? » ou « Pauvre idiot » !
Avec minutie, cet essai montre comment, en se volant des concepts, des sensations, en se lisant de près, en se chamaillant, en se surinterprétant, les deux frères enrichirent leurs œuvres. A partir de leurs voix, de leurs visions, Fictions du pragmatisme invente un nouveau « personnage conceptuel à deux têtes » : les frères James. En croisant avec précision, philosophie et littérature – comme le font aux Etats-Unis des gens comme Martha Nussbaum ou Stanley Cavell ou, ici, Jacques Bouveresse – notre auteur relance l’intérêt pour une philosophie anglo-saxonne si mal connue de ce côté de l’Atlantique. Et puis il sait se souvenir avec, William James, que : « Berkeley, le premier, a mis à l’honneur “qu’être c’est être perçu ”. En effet, nos sensations ne sont pas de petits duplicata intérieurs des choses ; elles sont les choses elles-mêmes, en tant que les choses nous sont présentes ».
Lire l'article de Stéphane Madelrieux, "Pragmatisme des frères James" (laviedesidees.fr, 27 juin 2008).
Du même auteur
- Fictions du pragmatisme, 2008
- Puissances du temps, 2010
- Deleuze, les mouvements aberrants, 2014
- Les Existences moindres, 2017
- L'Altération des mondes. Versions de Philip K. Dick, 2021
Livres numériques
- Deleuze, les mouvements aberrants
- Fictions du pragmatisme
- Puissances du temps
- Les Existences moindres
- L'Altération des mondes. Versions de Philip K. Dick
