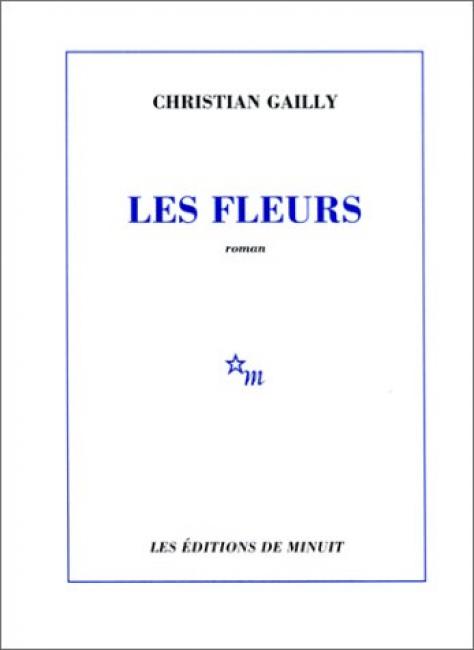
Christian Gailly
Les Fleurs
1993
96 pages
ISBN : 9782707314680
14.20 €
30 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
* Réédition dans la collection de poche double n° 77
Une femme et un homme. C’est tout simple.
La femme doit remplacer la cartouche de son stylo. L’homme, lui, doit se rendre chez un vieil ami. Donc tout les sépare. Ils ont pourtant quelque chose en commun. Le métro.
ISBN
PDF : 9782707324238
ePub : 9782707324221
Prix : 6.49 €
En savoir plus
Jean-Claude Lebrun (L’Humanité, 24 novembre 1993)
Gailly et ses transports en commun
Richesse visionnaire d’une écriture
Ça commence quelque part dans la banlieue sud. On prend ensuite le RER, ligne B, vers la capitale. À Denfert-Rochereau, on emprunte la correspondance avec le métro, direction Étoile. Arrêt à Trocadéro. On s'avance alors jusqu'à un immeuble de la rue Greuze, au numéro 18. Un professeur Lachowsky, psychiatre ou psychanalyste, y tient son cabinet ; un certain Boyer y habite. On entre. On commence d'y monter l’escalier... Ce petit récit, sous ses allures de chronique ordinaire de la vie de banlieusards, se profile à n’en pas douter comme l'un des tout meilleurs romans de cette fin d'automne. Parce que l’écriture, tantôt drôle et tantôt nouante, y capte de façon remarquable, avec acuité et fantaisie, le flot mouvant des impressions et des pensées de deux personnages, une femme et un homme, pour qui le plan du réseau RATP se lit comme une véritable carte du tendre. Si l'on ajoute qu'un narrateur facétieux, lui-même romancier, n’hésite pas à mettre son grain de sel dans l'aventure en train de se dessiner, on peut avancer que Les Fleurs, cinquième roman de Christian Gailly, retrouve et même amplifie cette verve et cette puissance suggestive, qui avaient fait de K. 622 (Éditions de Minuit, 1989) et de L’Air (Éditions de Minuit, 1991) de vrais bonheurs de lecture.
Une citation de Joyce, façon de situer l’ambition d'écriture, a été placée en épigraphe à une éblouissante cascade de monologues intérieurs. Quelqu'un, une femme puisqu'elle remarque la jupe dépassant de sous son imperméable, est entré dans une librairie-papeterie pour acheter une cartouche de stylo-bille. Tandis qu'elle attend son tour, le cerveau enchaîne mécaniquement une suite rapide de notations et de réflexions. Puis quelque chose soudain se grippe. Une phrase essaie de venir, mais se disloque : “ ... il parait que dans mon cas, je dis mon cas, quand on a ce que j'ai, à partir d'un certain moment, la mémoire, s'il s'agit de la mémoire, oui je crois bien qu'il s'agit de la mémoire, je m'en souviens, il a parlé de la mémoire, qui à partir d'un certain moment se met à, quel mot il a utilisé déjà ? ” Avec la parole, c'est la personne qui apparaît en train de se défaire. Mais déjà l'on est entré dans le monologue intérieur de la papetière, par quoi l'on prend note que la femme enseignait auparavant dans un établissement de la commune. L'histoire va ainsi se construire, sans paroles échangées, à peine des regards, en une sorte de mixage de ces propos muets, véhiculant eux-mêmes tout un mélange d'informations, d'impressions désordonnées et d'associations d'idées. Avec des retours en arrière pour reprendre des scènes, et tout un jeu de champs et de contrechamps, une succession d'aller et retour entre deux courants de conscience : celui de la femme professeur, manifestement en congé thérapeutique, qui se rend chez le professeur Lachowsky, et celui d'un homme, Paul Bast, apparu au deuxième chapitre, alors qu'il s'apprête à partir en visite chez son ami... Boyer. C'est donc sans étonnement excessif que le lecteur, accoutumé au “ hasard ” romanesque, les retrouve tous deux dans le même sens du RER, puis dans le métro, avant de les suivre vers la même sortie, à Trocadéro, puis dans le même escalier du même immeuble.
En temps réel, l’affaire dure à peine plus d'une heure. Quant à l'action, Christian Gailly la réduit à sa plus simple expression : l’important ici n’est pas ce qui se passe, mais ce qui passe par la tête des deux êtres qui se retrouvent assis face à face dans le wagon. Cela pourrait être d'une terrible platitude. C'est tout le contraire qui se produit : le cheminement en parallèle des protagonistes, jusqu'à la rencontre finale dans l’escalier de l'immeuble du Trocadéro, prend les allures d'une palpitante aventure, elle-même nimbée d'un réalisme poétique qui restitue les rites du quotidien et les transfigure. C'est ainsi qu'on peut admirer, dans un tabac près de la gare du RER, une “ jeune buraliste, d'une accidentelle beauté Renaissance ”, tandis que juste à côté “ un personnage en noir et blanc (…) apporte un café ”. Ou bien, quand les portes des wagons s'ouvrent, il y a ce mouvement de ballet, sur tout le quai, des voyageurs s'écartant pour ménager un chenal de sortie à ceux qui descendent. Ou encore cette impression de respirer, dans les gares souterraines, ce que Christian Gailly qualifie si justement d'“ odeur électrique ”. Le récit fourmille de telles notations poétisées, qui rejoignent les sensations de l'expérience journalière. Comme encore cette incidente sur les regards évitant de se croiser : “ Regarder à droite, mais attention, en prenant le soin de bien fermer les yeux quand tu passeras devant elle. ” Le RER et le métro apparaissent ici comme des lieux d'autant plus propices à l'aventure intérieure et à l'imaginaire qu'ils exaspèrent secrètement les sens.
Enfin, il y a ce qui se passe, là encore silencieusement, longtemps sous les apparences de la plus pure indifférence, entre cette femme et cet homme. L'esprit qui enregistre à toute vitesse, jauge et juge, quand l'œil paraît mort. Cette jupe remontée sur le genou de la femme assise, avec son motif floral, et lui, en face, soudain emporté par une bourrasque intérieure, avec la même émotion sensuelle que devant un certain tableau plein de fleurs rouges : “ sous les grands coups de zeph tout le champ se vangoghisait ”. À Cité-Universitaire, ils s'ignorent encore, à Denfert-Rochereau, chacun note que l'autre descend, à Trocadéro leurs pas se suivent et le trouble grandit.
Dans la cage d'escalier, la rencontre sera d'abord violente, puis intensément belle, dans une dernière scène muette, comme seul le grand cinéma, avec ses ellipses fulgurantes, peut nous en offrir. Là encore la poésie affleure, âpre et prenante, sans aucune mièvrerie. Car l'écriture de Christian Gailly est à l'unisson de ce coup d'œil tout de vivacité et d'inventivité, qui élève à l'ordre de l'esthétique des réalités communément perçues comme prosaïques sans que l'auteur dissimule la part de jeu qui s'y mêle : “ C'est toujours quand j'ai fini d'écrire que me viennent des idées intéressantes, ce qui fait que je suis réduit à écrire des histoires comme celle-ci, pas intéressantes, enfin on verra, revenons à Bast. ” Bref, tout concourt à ce que ce cinquième roman dégage un charme puissant.
Sans aucun doute Christian Gailly nous offre là son livre le plus plein et le plus continûment maîtrisé. Prouvant, s'il en était encore besoin, que le romanesque surgit moins des situations que de la richesse visionnaire d'une écriture. Et que du plus moderne peut naître le plus haut plaisir.
Richard Robert (Les Inrockuptibles, décembre 1993)
Les livres de Christian Gailly s'apparentent à une musique de chambre, procédant par avancées et replis, palpitation chaleureuse et angoissée d'un auteur insatisfait sans cesse travaillé, nourri par le doute. Un doute quasiment organique, qui colle à la peau et aux mots, et reste aux aguets depuis “ ces années d'effort, de tâtonnement et de solitude ” passées aux portes de la littérature – cette antichambre où se tient la douloureuse comptabilité des refus encaissés, où l'on s'escrime à ramasser les dernières miettes de son orgueil. Et où l'on apprend, finalement, à ne plus s'escrimer du tout. En 87, Gailly – il a quarante-quatre ans – est enfin publié. Ce sera Dit-il, premier frémissement d'une “ écriture en désespoir de cause ”, qui n'a de conviction que sa propre incertitude. “ Une impression me poursuit : je n'ai rien à dire. Mais la pression de l'écriture – cette vocifération intérieure – est telle qu'il me faut chercher un cadre pour l'exprimer. Lorsque je l'ai trouvé, je me rends compte que j'ai trop de choses à dire... ” Après K.622, où le narrateur court après une émotion perdue, viendront L'Air et Dring, romans en mode clos où Gailly se bâtit un chez-soi en même temps qu'une réputation de croqueur de saynètes, de metteur en scène du dérisoire et des péripéties intimes, sur un ton blessé et ironique. Pour autant, L’écrivain n'y a gagné aucune tranquillité d'esprit. “ Après chaque livre, je reste longtemps dans le vide. C’est Ie temps qu'il me faut pour accepter la banalité de mon écriture, me rendre à l'évidence que je n'ai rien d'autre pour vivre. C'est un reste de vanité, comme crever de faim à côte d'une poubelle au fond de laquelle il y a quelque chose à bouffer. Au début, on résiste, on crie Non, vous ne m'aurez pas, je ne mangerai pas ces ordures ! Et puis les mois passent, et on se résout à y plonger la main. ” Avec Les Fleurs, Gailly s'est fait un peu violence, a pointé le nez hors de son monde. Partition en quatre temps pour un homme et une femme qui, au gré de leurs micro-aventures et d'un trajet en métro, croisent et décroisent leurs monologues intérieurs, leurs petits malaises, le roman apporte une nouvelle variation, plus preste et resserrée, de la petite musique en mode mineur qu'affectionne Gailly. Jusque dans son dénouement, d'un optimisme violent et inattendu. “ Les Fleurs devait se terminer un peu comme mes autres romans, d'une manière triste, grise et étouffante. Et là, j'ai eu un coup de barre. J'ai vu ces deux abrutis, j'ai eu pitié d’eux et, à travers eux, de moi Je me suis dit Laisse-les donc respirer. J'ai réécrit le dernier paragraphe : je me suis fait un grand plaisir. Mais je ne sais pas si c’est bon signe. ” Voilà une forme de sérénité qui lui ressemble : au bord du gouffre.
Du même auteur
- Dit-il, 1987
- K. 622, 1989
- L’Air, 1991
- Dring, 1992
- Les Fleurs, 1993
- Be-Bop, 1995
- L'Incident, 1996
- Les Évadés, 1997
- La Passion de Martin Fissel-Brandt, 1998
- Nuage rouge, 2000
- Un soir au club, 2002
- Dernier amour, 2004
- Les Oubliés, 2007
- Lily et Braine, 2010
- La Roue et autres nouvelles, 2012
Poche « Double »
- Be-Bop , 2002
- Un soir au club , 2004
- Nuage rouge , 2007
- L'Incident , 2009
- Les Évadés , 2010
- K.622 , 2011
- Les Fleurs, 2012
- Dernier amour, 2013
- Lily et Braine, 2023
Livres numériques
- Be-Bop
- Dernier amour
- La Roue et autres nouvelles
- Les Fleurs
- Be-Bop
- Dernier amour
- K. 622
- K.622
- L'Incident
- L’Air
- La Passion de Martin Fissel-Brandt
- Les Évadés
- Les Oubliés
- Nuage rouge
- Un soir au club
- Dit-il
- Lily et Braine
