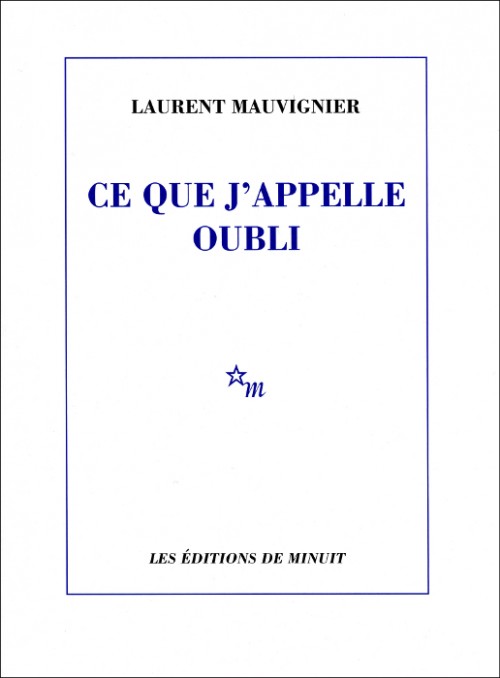
Laurent Mauvignier
Ce que j'appelle oubli
2011
64 pages
ISBN : 9782707321534
11.00 €
55 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Quand il est entré dans le supermarché, il s'est dirigé vers les bières. Il a ouvert une canette et l'a bue. À quoi a-t-il pensé en étanchant sa soif, à qui, je ne le sais pas.
Ce dont je suis certain, en revanche, c'est qu'entre le moment de son arrivée et celui où les vigiles l’ont arrêté, personne n’aurait imaginé qu’il n’en sortirait pas.
Cette fiction est librement inspirée d’un fait divers, survenu à Lyon, en décembre 2009.
ISBN
PDF : 9782707324474
ePub : 9782707324467
Prix : 7.99 €
En savoir plus
Sabine Audrerie, La Croix, jeudi 3 mars 2011
Les poings et les mots
Librement inspiré d'un fait divers, le percutant récit de Laurent Mauvignier évoque la mort violente d'un jeune homme dans un supermarché, pour le vol d'une canette de bière
Il fut une époque, antique, où l'on nommait «barbares» les hommes issus d'un peuple dont on ne comprenait pas la langue. Un glissement sémantique s'opéra en même temps que les mœurs évoluaient, et les barbares devinrent ces étrangers habitant hors des frontières. Les siècles s'écoulèrent sans changer la nature profondément brutale d'une partie de l'humanité, et de Grèce on passa en Rome, les jeux du cirque laissèrent place aux guerres modernes sans que l'ennui des hommes et leur besoin de divertissement gratuit soient jamais rassasiés. Alors on qualifia de barbares ceux dont les valeurs différaient tant des valeurs locales qu'elles menaçaient l'ordre établi. Puis vint un temps, plus récent, où le terme s'appliqua à des individus sans pitié, voire assoiffés de sang. Étonnant de se remémorer cette évolution à la lecture du très bref et saisissant livre de Laurent Mauvignier, où l'on trouve réunies au XXIe siècle toutes les acceptions successives du mot.
L'écrivain s'est librement inspiré d'un fait divers survenu à Lyon en 2009, au supermarché Carrefour du centre commercial de la Part-Dieu. Michaël Blaise, un jeune homme de 25 ans, y était mort par asphyxie, tué par quatre vigiles « pour une canette de bière » qu'il avait bue sans la payer. Les bandes de vidéosurveillance témoignaient de l'innommable: la mort en direct. Le récit fictif que dresse Laurent Mauvignier s'éloigne volontairement de cette réalité factuelle. Ce n'est plus Michaël mais un jeune homme qui aurait pu être lui qui devient le centre de son texte, son narrateur s'adressant au frère de cette victime emblématique d'une certaine bêtise et d'une certaine violence. Après des fictions beaucoup plus amples (dont on a dit tout le bien ici même), l'écrivain a choisi de concentrer ce livre sur une soixantaine de pages. Une seule phrase coule sans début ni fin, comme la vie même qui continue malgré les morts, une phrase violente ou parfois douce, jouant de ressacs et d'accélérations, avec toujours ce sens aigu de la ponctuation chez Mauvignier. Ce jeune homme mort injustement et son frère, sont-ils blancs? sont-ils noirs? arabes? sont-ils d'origine étrangère? d'extraction modeste? victimes du racisme? des préjugés? On ne le saura pas, sinon que leur père tient une boucherie et que le fils vaquait de petits boulots en périodes de chômage, qu'il venait peut-être de tomber amoureux, qu'il allait peut-être revoir une jeune femme, celle qui peut-être le ferait sortir de cet oubli que Mauvignier pointe en titre de son livre. Beaucoup de peut-être qui se sont éteints avec lui. Les thèmes de l'isolement, du rejet, de l'incompréhension ou des interactions fratricides reviennent sous la plume de l'auteur. « Quels sont les hommes qui peuvent faire ça. Pas des hommes qui font ça. Et pourtant. Des hommes », écrivait-il dans son livre précédent au sujet de la torture pendant la guerre d'Algérie.
Sa phrase ondule au fil des pages, interpellant avec empathie ce frère en deuil avec une vigueur mue par la colère et par la sagesse. L'écrivain imagine une vie, les promesses qu'elle recelait, les espoirs qu'elle n'osait pas nourrir ; et il évoque les faits eux-mêmes, la stupeur de la victime et les poings de quatre vigiles, des garçons du même âge que lui, dans cette réserve de supermarché. Qu'a-t-il pu ressentir, pendant que les coups pleuvaient, qu'a-t-il pu penser ou voir - le parfum d'un déodorant? un éclat de voix moqueuse? –, ou de quoi même a-t-il pu se souvenir – les recommandations de sa mère? un rendez-vous pris pour la soirée? – A-t-il eu le temps de se poser la question : pourquoi?
Il y a eu la folie, la gratuité du geste barbare des quatre vigiles, il y a eu le silence et puis il y a eu les discours: ceux des policiers, du procureur, des journalistes et bientôt des clients gênés à la boucherie du père. Plus de mots qu'il n'y en avait jamais eu à l'endroit du jeune homme de son vivant. Laurent Mauvignier lui offre les siens, il invente une personne semblable à tant d'autres au destin moins tragique. Et, le temps d'une phrase suspendue, comme aurait pu le faire un mariage, une paternité, une amitié ou même une carrière, le romancier extirpe son personnage de l'oubli et de l'indifférence quotidienne, de « ce monde avec des vigiles et des gens qui s'ignorent dans des vies mortes comme cette pâleur, cette mort tout le temps, tous les jours, que ça s'arrête enfin, je t'assure, ce n'est pas triste comme de perdre le goût du vin et de la bière, le goût d'embrasser, d'inventer des destins à des gens dans le métro et le goût de marcher des heures et des heures et des tas de choses que je ne ferai jamais, que je n'aurais jamais faites de toute façon mais que j'aimais tellement savoir présentes, là, à côté, au cas où ».
Jean-Claude Lebrun, L'Humanité, jeudi 3 mars 2011
Une vie en une phrase
Cinquante-cinq pages. Il faut à l'unique phrase de ce récit cinquante-cinq pages pour se dévider. Une ponctuation discrète lui assure sa respiration. Quelques répétitions lui donnent son allure de lamento. Laurent Mauvignier, après les textes de grand souffle Dans la foule (2006) et Des hommes (2009), s’est en effet lancé dans une manière d’entreprise inverse : l’écriture, à partir d’un fait divers survenu en décembre 2009, des derniers instants d’un homme battu à mort par des vigiles d’une grande surface. Il fait pour cela parler une figure proche de la victime, sorte de narrateur omniscient, qui en même temps restitue le vécu ultime de celle-ci et porte son regard au-delà de la scène du crime. Puisque le déchaînement de cette sauvagerie s’inscrit dans un certain ordre des choses.
Du temps a passé. Un procès a eu lieu. La personne qui raconte fait retour sur celui-ci. On prend son récit au vol, au beau milieu de son avancée, alors qu’elle en est arrivée au réquisitoire du procureur. Elle s’adresse au frère cadet du mort, dans un tutoiement qui dénote la familiarité. C’est aussi ce qui explique sa connaissance de l’itinéraire du disparu, depuis le cercle familial des origines et les années d’errance jusqu’à cet après-midi de soif, où il avait vidé une canette de bière dans un rayon du supermarché. Car l’épaisseur d’une vie peu à peu surgit de cette longue phrase, en laquelle simultanément se déroule le film de l’interpellation par les vigiles, de la conduite dans une resserre du magasin, de la pluie de coups portés en silence puis de l’affaissement sur « le froid de la dalle de ciment ». Des détails se fixent dans la conscience vacillante de celui qui ne peut pas encore croire à l’imminence de sa propre mort. Le gel qui brille sur le crâne de l’un des types, « l’odeur poivrée » du déodorant d’un autre. On vient ici de la misère et l’on jouit d’autant du dérisoire pouvoir accordé par le supermarché.
Des images de plus loin arrivent. Les parents bouchers sur les marchés en province, puis l’exclusion, la fuite dans la marge, les dérives sexuelles. Les bords de Loire, Paris, la banlieue. Séquences d’une mort « à petit feu tous les jours » pour le garçon ignoré et méprisé, « ombre d’un homme ». Et ces quatre autres, acharnés au-dessus de son corps, qui se débarrassent maintenant sur lui des avanies endurées par eux-mêmes. La phrase dévoile les moments d’une existence et suggère un monde cabossé alentour, qui s’incarne dans les vigiles. On ne distingue personne d’autre dans le magasin ni dans l’annexe, comme si les bourreaux et leur proie, à eux seuls, tenaient lieu d’allégories des désordres ambiants. Laurent Mauvignier produit dans ces cinquante-cinq pages un effet de densité extrême. Le texte avance sous la pression d’une énorme poussée de sens, faisant sauter les barrières de la ponctuation, rendant inutiles paragraphes et chapitres. Et se charge aussi de tout un non-dit qui par furtives échappées se signale. On se situe ici, par-delà le dehors de spontanéité, dans une élaboration savante.
La voix qui raconte restitue ce parcours humain jusqu’au dernier souffle de vie sur le ciment. Cela tient ensemble du rythme de l’information en continu et du déversement d’un flux de conscience. Un étonnant mariage de non-littéraire et de sophistication de l’écriture. Un simple tiret à la fin laisse le flot langagier reprendre son écoulement souterrain. Après ce saisissant jaillissement.
Norbert Czarny, La Quinzaine littéraire, 16 mars 2011
Grandeur des humbles
Depuis son premier roman, Loin d'eux, Laurent Mauvignier fait entendre sa voix. Elle s'est faite singulière et plurielle dans Des hommes ou Dans la foule. DansCe que j’appelle oubli, cette voix semble sortir du cadre romanesque pour s’élever dans la cité, au sens antique du terme.
On ne sait au juste quelle voix parle pour s’adresser au jeune frère d’un homme assassiné pour rien ou presque : une canette de bière. Les soixante pages qu’on lit d’un seul tenant sont une seule phrase commençant par un « et » qui suppose un autre début. Ces soixante pages denses, bouleversantes, sont le résultat d’un choc que Mauvignier rapporte dans la revue Décapage. Il y dispose de quarante pages pour présenter son travail, évoquer son univers. Un jour, donc, il a lu ce fait divers qu’on se rappelle peut-être : quatre vigiles d’une grande surface lyonnaise avaient battu à mort un homme qui avait bu, sans payer, une canette de bière.
De ce fait divers, Mauvignier tire une fiction politique et poétique. Politique : l’adjectif peut surprendre si l’on songe en termes réducteurs au spectacle pitoyable que des élus nous offrent ou à l’énonciation si commune de bons sentiments respectueux des droits de l’homme. Ce texte est politique en ce qu’il montre ce que devient un homme dans « un monde avec des vigiles et des gens qui s’ignorent ». Le pauvre qu’on a roué de coups revient à la vie grâce aux mots du narrateur. Celui-ci, écrivant, imaginant, s’étant peut-être documenté (on en doute : les romanciers se contentent d’être des visionnaires), lui a rendu une place dans le monde et dans la cité en particulier. Il n’a pas de nom et ce que l’on sait de son visage, de son corps est hélas ce que les assassins en ont fait : chair tuméfiée, corps rétracté par la douleur. Mais cet homme existe et on l’a tous vu. Il faisait la manche près de la gare Montparnasse ou errait dans quelque supermarché, regardant les chariots remplis de victuailles. Et surtout, il aimait, était aimé. De sa famille sans doute, mais aussi de femmes ou d’hommes avec qui il avait fait l’amour. Enfin, et cela donne toute sa dimension à ce texte, il rêvait. Il aurait voulu voyager, et même si ce n’était pas possible, l’envie suffisait à le faire exister, continuer de marcher. Il avait donc tout pour être heureux.
Politique aussi, la violence (et la lâcheté) des agresseurs. Ils se servent des mots « refus d’obtempérer » pour masquer le meurtre en acte de légitime défense. Ils intimident, harcèlent et frappent, persuadés que nul ne s’offusquera de leur violence envers un petit voleur, errant, peut-être gibier de garde à vue. Ce sont à l’évidence des assassins mais le narrateur montre bien tout ce qui aurait pu les unir à leur victime : une même salle de classe, un voisinage sur le palier des Bleuets, une équipe de foot qu’on supporte ensemble. Pourquoi sombrent-ils dans la haine ? Il est à craindre que nous connaissions la réponse depuis trop longtemps ; un autre est de trop, son visage vous reste étranger.
Texte politique, Ce que j’appelle oubli est aussi un texte poétique, comme tout ce qu’écrit Mauvignier. La notion de genre est pour lui éditoriale. Cela aide les libraires et bibliothécaires à ranger ses livres. Mais on entend ce texte, on le conçoit proféré, jeté dans un espace, face au public. Le premier choc littéraire de Mauvignier, apprend-on encore dans Décapage, c’est Artaud. Et dans ce texte d’une seule coulée, qui se termine avec le verbe « murmurer », on retrouve quelque chose du poète. Ceci étant, ce n’est pas seulement du côté d’Artaud que ce texte penche. Le ressassement, les variations de langue brassant le parlé et l’écrit, le mot jeté comme un cri et l’image qui illumine donnent son relief et sa spécificité à ce texte. On se rappelle Apprendre à finir entre malheur ordinaire et tragédie racinienne.
Enfin, et là est peut-être l’essentiel, ce texte prend toute sa dimension, devient comme une forme vivante quand on l’envisage du point de vue des temps. Il y a le présent du crime, les quelques passés ouvrant des fenêtres sur les moments de bonheur, des joies simples, l’évocation si émouvante de la mère faisant des recommandations à ses fils. Il y a le futur de la honte et de l’humiliation pour ceux qui se croyaient invulnérables, et l’absence de futur pour la victime, tout ce qui ne sera pas. Il y a, enfin et surtout, le conditionnel passé, mode de ce qui aurait pu et dû être pour ce pauvre garçon : un rendez-vous galant, des voyages, des espoirs pour plus tard. On n’oubliera pas cette humble silhouette qui nous rappelle celles qu’on trouve parfois chez Victor Hugo, celles d’enfants assassinés et de pauvres filles humiliées.
Marine Landrot, Télérama, 23 mars 2011
Après celles du Heysel (Dans la foule) et de la guerre d'Algérie (Des hommes), Laurent Mauvignier explore une nouvelle tragédie, survenue à Lyon en 2009 : la sauvage mise à mort d'un voleur de bière par quatre vigiles, dans l’arrière-boutique d’un supermarché. Son style désormais consacré, hagard, submergeant, inextinguible, fait une nouvelle fois mouche. Après les raz de marée des précédents romans, dans lesquels des êtres blessés tentaient de résister au flot de l’Histoire, une extermination individuelle en catimini, sans cris ni témoins. Pour passer de l’infiniment grand à l’infiniment petit, de la page d’histoire collective au brouillon de vie jeté au caniveau, Laurent Mauvignier s’est glissé dans un tout petit livret de survie. Son nouveau roman est composé d’une seule phrase de soixante pages, expectorée comme un dernier souffle, où la panique le dispute à l’espoir (« ils vont arrêter de frapper, je vais retrouver mon souffle, ça ne peut pas finir ici, pas maintenant et pourtant il ne pouvait plus respirer ni sentir son corps ni rien entendre, ni voir non plus et il espérait malgré tout, quelque chose en lui répétant, la vie va tenir, encore, elle tient, elle tient toujours, ça va aller, encore, ils vont cesser parce qu’ils vont comprendre que ma vie est trop petite dans mon corps et qu’elle s’amenuise trop maintenant pour durer plus qu’une bulle de savon qui monte et éclate »).
Ce cri de révolte contre l’effervescence des existences que la misère a rendues transparentes est d’une insoutenable stridence. Mais l’écriture est là, attentive, suspendue, pour offrir des parenthèses de réconfort. En signe de résistance, ce que Mauvignier appelle l’oubli, c’est le souvenir, ce droit à continuer de vivre dans le havre des têtes accueillantes.
Rencontre
Du même auteur
- Loin d'eux, 1999
- Apprendre à finir, 2000
- Ceux d'à côté, 2002
- Seuls, 2004
- Le Lien, 2005
- Dans la foule, 2006
- Des hommes, 2009
- Ce que j'appelle oubli, 2011
- Tout mon amour, 2012
- Autour du monde, 2014
- Retour à Berratham, 2015
- Continuer, 2016
- Une légère blessure, 2016
- Histoires de la nuit, 2020
- Proches, 2023
- La Maison vide, 2025
Poche « Double »
- Loin d'eux, 2002
- Apprendre à finir, 2004
- Dans la foule , 2009
- Des hommes , 2011
- Autour du monde, 2016
- Continuer, 2018
- Voyage à New Delhi, 2018
- Histoires de la nuit, 2022
- Quelque chose d'absent qui me tourmente, 2025
Livres numériques
- Apprendre à finir
- Ce que j'appelle oubli
- Ceux d'à côté
- Dans la foule
- Des hommes
- Le Lien
- Loin d'eux
- Seuls
- Tout mon amour
- Autour du monde
- Retour à Berratham
- Autour du monde
- Une légère blessure
- Continuer
- Histoires de la nuit
- Proches
- La Maison vide
- Quelque chose d'absent qui me tourmente
