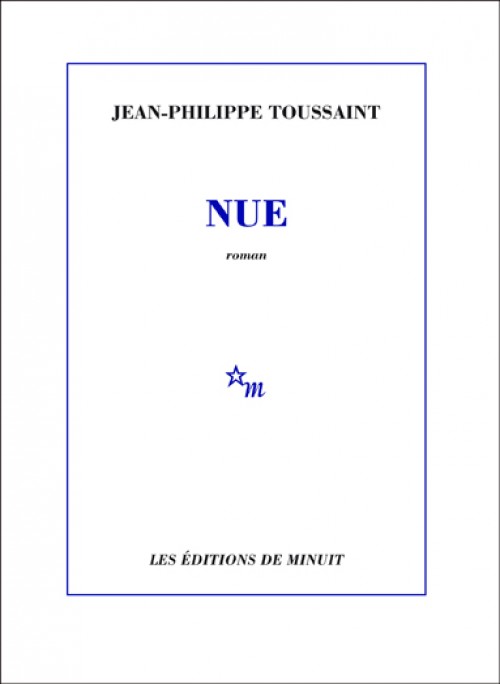
Jean-Philippe Toussaint
Nue
2013
176 p.
ISBN : 9782707323057
14.50 €
79 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille.
Version audio lue par l'auteur (extrait)
La robe en miel était le point d’orgue de la collection automne-hiver de Marie. À la fin du défilé, l’ultime mannequin surgissait des coulisses vêtue de cette robe d’ambre et de lumière, comme si son corps avait été plongé intégralement dans un pot de miel démesuré avant d’entrer en scène. Nue et en miel, ruisselante, elle s’avançait ainsi sur le podium en se déhanchant au rythme d’une musique cadencée, les talons hauts, souriante, suivie d'un essaim d’abeilles qui lui faisait cortège en bourdonnant en suspension dans l’air, aimanté par le miel, tel un nuage allongé et abstrait d’insectes vrombissants qui accompagnaient sa parade.
Nue est le quatrième et dernier volet de l'ensemble romanesque MARIE MADELEINE MARGUERITE DE MONTALTE, qui retrace quatre saisons de la vie de Marie, créatrice de haute couture et compagne du narrateur : Faire l’amour, hiver (2002) ; Fuir, été (2005) ; La Vérité sur Marie, printemps-été (2009) ; Nue, automne-hiver (2013).
ISBN
PDF : 9782707343864
ePub : 9782707343857
Prix : 6.99 €
En savoir plus
Jérôme Garcin, Le Nouvel Observateur, 29 août 2013
Avec « Nue », Jean-Philippe Toussaint, 55 ans, au sommet de son art, clôt son cycle amoureux commencé il y a plus de dix ans. Il en explique la genèse à Jérôme Garcin
Bénie soit Marie, qui aura inspiré à Jean-Philippe Toussaint une tétralogie romanesque aussi passionnelle que passionnante. Voici en effet que paraît, avec «Nue», le dernier volume d’un cycle commencé il y a onze ans avec «Faire l’amour», prolongé avec «Fuir» et «la Vérité sur Marie». On y aura vu, saison après saison, un couple s’aimer, se séparer, se regretter, se retrouver – le narrateur toujours dans l’ombre, et Marie, la créatrice de mode, l’artiste performeuse, la femme d’affaires, souvent dans la lumière. Lui, tellement grave et comme empêché. Elle, légère, liquide, insoucieuse, et si heureuse quand elle peut se promener nue. L’un néo-proustien, l’autre nouvelle tendance. Avec eux, on aura beaucoup voyagé, de la Chine au Japon et de l’île d’Elbe à Paris, entre la rue de la Vrillière et la rue des Filles-Saint-Thomas. Évidemment, on ne dévoilera pas l’épilogue de cette grande histoire d’amour sans cesse exaltée et contrariée, mais la réussite de «Nue» est telle qu’on peut lire ce roman sans connaître les trois précédents. Il s’ouvre par une scène inaugurale époustouflante : le défilé, intitulé «Maquis d’automne», dans un grand hôtel de Tokyo, d’une top-modèle nue, recouverte de miel corse, et suivie d’un vrombissant essaim d’abeilles. Et il se termine sur l’île d’Elbe, où, après l’incendie d’une chocolaterie, d’écœurantes vapeurs de cacao montent de la pierre mouillée d’un cimetière. Autant de scènes inoubliables dont cet écrivain-cinéaste a le secret (qu’on se souvienne notamment du pur-sang emballé sur un tarmac japonais). Entre les deux îles, le roman fait escale à Paris, dans des lieux qui nous sont désormais familiers. Marie et le narrateur, qui étaient séparés, se donnent rendez-vous place Saint-Sulpice et décident, à l’occasion d’un enterrement (pas de sexe sans mort), de retourner sur l’île d’Elbe. A la fois lumineux et crépusculaire, trépidant et assagi, ironique et poignant, horizontal et vertigineux, superposant plus que jamais le passé, le présent et le futur, et coulé dans une langue d’une éclatante sobriété, «Nue» est vraiment le point d’orgue de la collection printemps-été-automne-hiver de Jean-Philippe Toussaint. Écrire, prétendait-il dans «l’Urgence et la Patience», c’est «fermer les yeux en les gardant ouverts». Le lire, aussi.
J. G.
Le Nouvel Observateur. Saviez-vous, en écrivant «Faire l’amour», que ce roman inaugurerait un cycle de quatre volumes, quatre saisons de la vie de Marie 4xM, Marie Madeleine Marguerite de Montalte? Jean-Philippe Toussaint.Je ne le savais pas consciemment, mais peut-être de façon subliminale. J’ai toujours rêvé d’écrire un livre de 700 pages, une «somme», j’en plaisantais il y a plus de vingt ans avec Jérôme Lindon. Eh bien, voilà, c’est fait. C’est très stimulant d’écrire des livres qui sont à la fois autonomes, mais qui s’inscrivent dans un ensemble romanesque plus large, avec les mêmes personnages, et des lieux qui reviennent à chaque fois et créent un véritable espace littéraire et mental, à la fois réel et imaginaire : l’appartement de la rue de la Vrillière, le petit deux-pièces de la rue des Filles-Saint-Thomas, le Contemporary Art Space de Shinagawa ou la Rivercina, la maison du père de Marie à l’île d’Elbe. Les quatre romans se complètent, s’enrichissent mutuellement. Chaque livre fait partie d’un ensemble, mais on peut très bien les lire séparément, et dans l’ordre qu’on souhaite. Je pourrais même, pour chacun d’eux, trouver une bonne raison de dire que c’est par celui-là qu’il faut commencer : «Faire l’amour», parce que c’est le premier que j’ai écrit, «Fuir», parce que c’est le premier dans la chronologie de l’histoire du narrateur et de Marie, «la Vérité sur Marie», parce qu’il offre la structure romanesque la plus complexe et qu’il ravira les amateurs de chevaux, et «Nue», parce que c’est le dernier et que j’apporte un élément narratif déterminant qui s’apparente à un dénouement au regard de l’ensemble du cycle.
La fin de «Nue», qu’on ne racontera pas, n’empêcherait d’ailleurs pas l’hypothèse d’un cinquième volume. Y avez-vous pensé?
Oui. Lorsque j’ai envoyé le manuscrit à Irène Lindon, je lui ai écrit : «Mais j’espère que “Nue”, s’il se confirme qu’il est bien le dernier livre du cycle de Marie, a quand même d’autres vertus que le simple mérite d’avoir su m’arrêter à temps.»
Désormais on sait presque tout de Marie, et pourtant on peine à se la représenter physiquement. Pourquoi ce choix de ne pas la décrire, est-ce pour laisser le lecteur libre de l’imaginer et, peut-être, de l’aimer à son tour?
Oui, c’est la force de la littérature de laisser une grande place à l’imagination. Je ne décris pas Marie physiquement pour que chacun puisse se l’approprier, mais cela ne m’empêche pas de donner des détails très précis sur ses gestes, ses attitudes ou sa démarche – son échevellement, ses flamboyances et ses extravagances –, qui en disent bien plus long sur elle que la couleur de ses yeux ou de ses cheveux.
Êtes-vous étonné si je vous dis que je vous imagine davantage dans la tête de Marie, capable d’«agir sur ce qui échappe», que dans celle du narrateur? C’est elle, d’ailleurs, la créatrice qui est dans la lumière, c’est elle qui a le pouvoir, qui est dominante dans le couple...
Marie, comme moi, est une artiste un peu secrète, qui n’aime pas trop les mondanités ni apparaître à la télévision. J’avais même envisagé un moment de lui prêter une phrase que j’avais imaginée pour moi : «Je suis très connu, mais personne ne le sait.» Ce qui est la pure vérité, d’ailleurs, c’est exactement mon cas. Mais, curieusement, cette formule, pourtant assez drôle et fondée, j’ai essayé plusieurs fois de la placer dans la bouche de Marie, mais je l’ai à chaque fois supprimée en me relisant. En réalité, les influences sont toujours multiples quand on construit un personnage. Marie est très proche de moi par bien des aspects, mais elle est également très proche de ma femme, proche d’autres femmes aussi, proche de personnages de fiction, proche du rêve et de l’imagination. Je le dis explicitement dans «l’Urgence et la Patience» : « Ce réseau d’influences multiples, de sources autobiographiques variées, qui se mêlent, se superposent, se tressent et s’agglomèrent jusqu’à ce qu’on ne puisse plus distinguer le vrai du faux, le fictionnel de l’autobiographique, se nourrit autant de rêve que de mémoire, de désir que de réalité.»
Comment définiriez-vous la «disposition océanique» dont vous écrivez deux fois qu’elle caractérise Marie?
J’ai forgé cette notion de «disposition océanique» à partir du concept de sentiment océanique, que Romain Rolland définit, dans une lettre à Freud, comme la volonté de faire un avec le monde hors de toute croyance religieuse. Marie possède ce don, cette capacité singulière de trouver intuitivement un accord spontané avec les éléments naturels, avec la mer, dans laquelle elle se fond avec délices, avec l’air, avec la terre.
C’est un étrange amour que celui du narrateur et de Marie. Commencé de manière fulgurante dans un hôtel de Tokyo, il est fait ensuite de séparations et de retrouvailles, d’éloignements et de fusion, il jongle avec les fuseaux horaires et tous les moyens de communication, et pourtant c’est un grand amour. On dirait que vous vous ingéniez à sans cesse le mettre à l’épreuve...
C’est un amour d’aujourd’hui, du début du xxie siècle, ce qui explique la multiplicité des voyages et des fuseaux horaires, mais c’est aussi un amour intemporel, que bercent les saisons et que mettent à l’épreuve les déchaînements immémoriaux de la nature (tremblement de terre, incendie de forêt, pluies, orages). Une autre façon pour moi de mettre cet amour à l’épreuve est d’intégrer des éléments qui s’apparentent au roman policier, comme tout ce qui concerne l’épisode de l’incendie criminel de la chocolaterie dans «Nue». Il y a là un énorme pan secret du livre, enfoui, non divulgué, qui est comme la partie invisible de sa structure. C’est la même chose avec l’épisode du trafic de drogue dans «Fuir», qui n’est jamais explicitement abordé, mais qui renforce la dramatisation du récit. J’attache en général une grande importance aux détails romanesques, qui peuvent s’apparenter à ce qu’au cinéma on appelle les accessoires. Les frères Dardenne expliquent que c’est toujours de l’accessoire qu’il faut partir, que c’est l’accessoire qui va amener l’arrière-plan psychologique, historique ou philosophique. Il ne faut pas commencer par chercher une signification symbolique à une scène pour ensuite trouver l’accessoire qui conviendrait le mieux à la situation, il faut au contraire partir d’un élément concret, ponctuel, qui sera porteur de significations qui le dépassent. Il y a toujours, dans mes livres, la présence d’éléments inquiétants, parfois très simples, très anodins, des bidons d’essence dans le coffre d’une voiture dans le cas de «Nue», une enveloppe d’argent liquide dans «Fuir». Ces éléments ont une double fonction. D’abord, et simplement, ils participent au plaisir de la lecture, au suspense, à la volonté de tourner les pages pour voir comment cela se termine. Mais aussi, ils créent un contexte d’insécurité, d’inquiétude, autour des personnages, qui exacerbe leurs sentiments et les «dénude» face au danger ou aux déchaînements de la nature.
Rien, dans «Nue» comme dans les trois romans précédents, ne permet d’identifier précisément l’époque à laquelle cette chronique amoureuse se déroule. Pourquoi le choix de se placer en dehors de l’Histoire?
Il est vrai que mes livres semblent se dérouler en dehors de tout contexte politique et social, mais ils sont clairement situés au début des années 2000. Pour moi, c’est une nécessité que les écrivains parlent du monde contemporain, l’observent et le restituent. Le choix de situer «Fuir» en Chine, par exemple, révèle une volonté d’aller vers le monde contemporain tel qu’il est en train de se construire aujourd’hui, le monde qui bouge, qui vit et se transforme. La Chine, pour moi, c’est le contemporain.
Je reviens à «la Vérité sur Marie». A propos de chevaux, auxquels j’ai compris qu’il convenait de «parler en français», vous faites délibérément vomir Zahir dans l’avion en plein vol. Or vous rappelez à juste titre que les chevaux ne peuvent pas vomir. Ce détail très révélateur n’exprime-t-il pas la primauté de la littérature sur la réalité? N’est-ce pas là pour rappeler que le cycle de Marie est, finalement, de pure imagination?
Oui. Dans la postface à l’édition de poche de «la Vérité sur Marie», qui paraît en même temps que «Nue», Pierre Bayard signe avec moi une enquête littéraire appelée «l’Auteur, le narrateur et le pur-sang», où nous abordons précisément ces questions. Pierre Bayard fait par exemple remarquer que, dans «la Vérité sur Marie», deux scènes importantes sont racontées avec force détails par un narrateur qui n’est pas présent. Il y est beaucoup question de Borges, de Daniel Arasse et même de Woody Allen. Mais permettez-moi de ne pas dévoiler les conclusions de notre enquête...
Vous vivez à Bruxelles, mais semblez toujours être ailleurs, de Tokyo à Paris en passant par Shanghai et la Corse. Pouvez-vous imaginer écrire sans «fuir»? Et l’île d’Elbe est-elle seulement une métaphore de la Corse ou la connaissez-vous bien?
L’île d’Elbe que je décris est en effet largement inspirée de la Corse, vous avez raison. Cette Méditerranée brumeuse, automnale et humide que je décris dans «Nue», je la connais très bien. Mais, naturellement, à cette Corse intime, dont je me suis inspiré pour les détails du paysage – les sentiers, les criques, la végétation – s’ajoute un véritable travail de documentation sur l’île d’Elbe (j’ai consulté beaucoup de livres, des guides touristiques et de nombreuses cartes). En novembre 2010, j’ai même fait un voyage de repérage à l’île d’Elbe spécialement pour «Nue». J’ai pris une chambre à l’hôtel Ape Elbana et je me suis promené sous la pluie dans Portoferraio désert.
Vous aviez vous-même porté à l’écran deux de vos livres, «Monsieur» et «l’Appareil-photo». Pourriez-vous envisager d’adapter le cycle de Marie?
Oui, pourquoi pas. Mais ce n’est pas d’actualité. Depuis quelque temps, comme ma priorité allait à ce cycle de Marie qui occupait toute mon énergie, je me suis contenté de réaliser quelques films courts, plutôt expérimentaux, destinés à des centres d’art ou des musées, comme l’Espace culturel Louis Vuitton, ou le Musée du Louvre, où j’ai présenté «Trois Fragments de Fuir», pendant la durée de mon exposition. En novembre dernier, en Chine, j’ai adapté une scène de «la Vérité sur Marie», la scène de l’embarquement du pur-sang dans un aéroport. Le film s’appelle «Zahir», il dure six minutes, avec une musique envoûtante du groupe Delano Orchestra, et sera présenté en avant-première au MAC/VAL le 15 septembre, dans le cadre de l’exposition d’Ange Leccia.
Où et comment passez-vous votre été?
En Corse et en bermuda, je le crains, et une semaine à Venise, pour un projet dans le cadre de la Biennale off.
Attendez-vous la sortie de «Nue» avec émotion, curiosité ou indifférence?
Avec sérénité... A l’exception de «la Main et le Regard», vous avez toujours été fidèle aux Éditions de Minuit et aux Lindon, de père en fille. Peut-on comparer cette fidélité littéraire à une histoire d’amour?
Euh... Disons que j’attache beaucoup d’importance à la loyauté. C’est une valeur précieuse, souvent bafouée, avec laquelle je ne transige pas. Jérôme Lindon a découvert «la Salle de bain», que personne ne voulait publier, et il en a fait un succès. Irène Lindon poursuit son œuvre, avec courage, avec rigueur, avec ténacité. Je me sens très bien aux Éditions de Minuit, et je me réjouis de voir de nouveaux auteurs y publier leur premier roman : Julia Deck ou Vincent Almendros.
Dans la notice du «Dictionnaire des écrivains par eux-mêmes», que j’avais dirigé en 1989, vous écriviez de vous : «Il fut champion du monde junior de Scrabble (Cannes, 1973). Un massacre.» Je n’ai jamais su si c’était la vérité... Pouvez-vous me la dire, aujourd’hui?
La vérité, toute la vérité, rien que la vérité!
Propos recueillis par Jérôme Garcin
Raphaëlle Leyris, Le Monde, vendredi 30 août 2013
Jean-Philippe Toussaint clôt en beauté sa tétralogie sur Marie Ni tout sucre ni tout miel
Une bouteille d’acide chlorhydrique. C’est sur cette image que s’ouvrait Faire l’amour (Minuit, 2002) et, avec lui, l’ensemble romanesque dit «Marie Madeleine Marguerite de Montalte», consacré à la rupture toujours recommencée entre cette dernière, créatrice de mode, artiste, femme d’affaires, et le narrateur. Avec le dangereux flacon, que celui-ci gardait à portée de main, Jean-Philippe Toussaint annonçait que son cycle sur l’amour, qui nous emmènerait de Tokyo (Faire l’amour) à l’île d’Elbe (La Vérité sur Marie, 2009), en passant par la Chine (Fuir, 2005) et Paris, se plaçait sous l’égide du corrosif et de la menace. Et voici que Nue, le dernier tome de sa tétralogie superbe – dont chacun peut se lire isolément –, débute sur du miel. Dans la scène inaugurale, sans lien direct avec les aventures amoureuses en cours depuis onze ans, Marie s’est mis en tête de créer une robe composée de cette matière («Une robe en lévitation, légère, fluide, fondante, lentement liquide et sirupeuse») et de faire défiler un mannequin ainsi enduit, suivi par un essaim d’abeilles.
Est-ce à dire que ce roman de clôture est tissé de sucre, doublé de guimauve? Que nenni. Prends garde à la douceur, semble avertir Jean-Philippe Toussaint : il suffit d’un pas légèrement hésitant, d’un temps de retard, pour que les abeilles fondent ensemble sur la jeune femme tout emmiellée. Dans ce basculement, dans la magie qui se rompt, Jean-Philippe Toussaint dit quelque. chose du pacte de lecture passé avec nous, qui l’autorise à inventer cette robe impossible et sublime, et nous à y croire, même si le danger de voir s’effondrer l’édifice fictionnel est là, tout près. En quoi ce moment rappelle une scène frappante de La Vérité sur Marie, où un pur-sang vomissait dans un avion, alors que le narrateur affirmait qu’une telle réaction était physiologiquement impossible à un cheval (l’auteur revient sur ce coup de force narratif dans un entretien avec Pierre Bayard, ajouté à la réédition en poche de La Vérité...).
Mais reprenons : nous avions laissé les deux personnages sur l’île d’Elbe, où se trouve la maison familiale de Marie, occupés à faire l’amour après avoir échappé à un incendie. Fallait-il en déduire que leur histoire avait repris ? Pas du tout : à peine rentré à Paris, le narrateur se retrouve à attendre un coup de fil qui ne viendra pas avant deux mois. Le temps de se remémorer des événements advenus à Tokyo, et qui avaient été tenus hors champ de La Vérité sur Marie, en une cascade temporelle et un jeu avec les perspectives épatants.
Effluves écœurants Après être revenu en pensée sur les lieux tokyoïtes de leur (dés)amour, le narrateur va retourner avec Marie sur l’île d’Elbe, quand elle lui aura demandé de l’y accompagner pour assister à des obsèques. Ils y seront accueillis par un nouvel incendie, celui d’une chocolaterie, dont les effluves écœurants viennent définitivement annihiler l’idée que Nue pourrait être un roman sucré.
Arpenter les mêmes lieux, refaire les mêmes gestes... «Tout véritable amour (...) n’est-il pas toujours, nécessairement un ressassement?», demande le narrateur. Un ressassement ou une «continuelle reprise» qui est le cœur de la démarche de Jean-Philippe Toussaint dans ce cycle, et l’une des caractéristiques du personnage de Marie, avec sa «disposition océanique», qui saute soudain aux yeux de son (ex- ou pas) amant, disposition qui tient à sa «forme d’exaltation particulière», mais aussi au ressac de ses sentiments pour lui.
La dimension miraculeuse de l’amour tient, elle, peut-être, à ce que cette alternance de marées sentimentales hautes et basses ne repousse pas plus le narrateur qu’ils ne lassent le lecteur.
Car l’océan change sans cesse. Et Marie aussi, qui reste certes «tuante», mais qui, dans la scène liminaire du miel, révèle un nouvel aspect de sa personnalité. A la fin du défilé, en pleine catastrophe, la créatrice vient saluer, «comme si c’était elle qui était à l’origine de ce tableau vivant». L’obsessionnelle de «la perfection, l’excellence, l’harmonie» a «apposé sa signature sur la vie même, ses accidents, ses hasards, ses imperfections». Connu pour faire naître l’apparente simplicité de ses textes d’un long travail, comme il le détaillait dans L’Urgence et la Patience (Minuit, 2012), Jean-Philippe Toussaint, au moment de clore ce cycle extraordinairement travaillé, intriqué, dit la part de hasard dans la création. C’est comme si cet aveu le libérait, l’autorisait à tenter de nouvelles expériences avec sa phrase – plus libre, plus rythmée. Et à glisser quelques gouttes de miel dans son flacon d’acide.
Norbert Czarny, La Quinzaine littéraire, 1er-15 septembre 2013
"L'imprévu vivifie"
A la fin de Nue, qui clôt le cycle de Marie, une question faussement naïve (à moins qu'elle le soit vraiment) est posée par l'héroïne au narrateur. Entretemps, des surprises et rebondissements auront confirmé que cette femme a quelque chose de bien singulier, voire d'exceptionnel
Nous connaissons Marie depuis Faire l’amour, paru en 2002. Alors, c’était l’hiver, elle se séparait du narrateur à Tokyo auterme d’une dernière nuit amoureuse. L’été était la deuxième saison de Marie, mais on la voyait peu dans Fuir, qui se déroulait en Chine, entre Shanghai et Pékin, dans une atmosphère étrange, tissée d’événements énigmatiques. Puis dans La Vérité sur Marie, printemps-été, les ex-amants se retrouvaient pour l’enterrement du père de Marie sur l’île d’Elbe, après un épisode à Tokyo, raconté mais pas vécu par le narrateur. Il relatait la mort soudaine de Jean-Christophe de G., amant de Marie. Nueramène le lecteur à Tokyo et à Elbe, mais en des moments différents, l’un situé juste après la rupture racontée dans Faire l’amour, l’autre deux mois après la mort du père de Marie. Ces rappels ne sont pas inutiles. Non qu’il faille avoir lu le cycle pour apprécier Nue. Mais cette construction montre comment le narrateur remplit le “programme” annoncé par la citation de Dante en ouverture : “Dire d’elle ce qui jamais ne fut dit d’aucune.” L’une des beautés de ce roman tient à la vision kaléidoscopique que nous avons de l’héroïne. Vue par le narrateur – et l’on verra que le verbe voir est important –, Marie s’offre sous toutes ses dimensions, en diverses strates temporelles. Elle s’imagine aussi bien. Dans une intéressante postface àLa Vérité sur Marie, Toussaint explique à son interlocuteur, Pierre Bayard, comment les épisodes mettant en scène Marie et Jean-Christophe de G. sont conçus, le narrateur n’étant plus témoin ou acteur : “La réalité extérieure est entièrement reconstruite dans l’esprit du narrateur, à partir de souvenirs réels, de témoignages, de rêves et de fantasmes.” Et c’est ainsi, par le jeu entre laproximité et la distance, par la relation entre ce qui est vu, senti, entendu, et ce qui est construit par l’imagination, que s’élabore Nue, et, partant, tout le cycle.
Tout commence icipar une scène incroyable. Marie organise un défilé dont le clou est la présentation d’une robe en miel. Les préparatifs de l’événement sont minutieux, précis. Pour confectionner cet objet qui ne déparerait pas dans la collection de Peau d’Âne. Marie convoque des apiculteurs, un dermatologue, un allergologue, des assureurs et avocats, met au point une chorégraphie qui ne souffre pas le moindre écart. Bref, elle travaille sur les “détails de détail”, comme elle l’a toujoursfait. Une nuée d’abeilles suit sareine, entoure le jeune mannequin qui défile. Une erreur de sortie provoquela catastrophe et l’hallali. Marie sauve son œuvre en transformant l’accident imprévu envolonté : “La conclusion inattendue du défilé du Spiralluifit alors prendre conscience que, dans cette dualité inhérente à la création – ce qu’on contrôle, ce qui échappe –, il est également possible d’agir sur ce qui échappe, et qu’il y a place, dans la création artistique, pour accueillir le hasard, l’involontaire, l’inconscient, le fatal et le fortuit.” Les lecteurs de L’Urgence et la Patience, de Jean-Philippe Toussaint, auront retrouvé là l’une des dualités qui lui sont chères. Mais cet événement qui ouvre le roman trouvera des échos dans la suite aussi bien à Tokyo qu’à l’île d’Elbe.
Deux mois s’écoulent entre le retour de l’île, après la mort du père, une nouvelle étreinte entre des amants qu’on croyait séparés, et ce feu ravageur qui a failli détruire la propriété familiale. On est en septembre et chacun a rejoint son appartement parisien. Le narrateur est à sa fenêtre et il contemple l’immeuble nu qui lui fait face, ressassant les moments passés, attendant que Marie le rappelle, souffrant autant de son absence qu’il se sent agacé par la jeune femme. Il se rappelle alors la fin du séjour Tokyo, l’exposition “Maquis” que proposait Marie au musée de Shinagawa. Il n’était pas entré dans la salle où les invités allaient et venaient, mais observait de haut la scène. La comédie sociale qui se jouait prenait des airs de vaudeville, avec un quiproquo qui donne à connaître Jean-Christophe de G. et son ami Pierre Signorelli. Le premier se vante de sortir de l’exposition au bras de Marie sans la connaître. Il rencontre une Marie qui commente les œuvres avec le ton snob propre à ces circonstances et le lecteur découvre ainsi un homme qu’il a vu mort dans le tome précédent. Voir à distance mais ne jamais perdre de vue, épier, chercher du regard, voilà ce qui reste au narrateur après la rupture. Marie se prête au jeu puisqu’elle se distingue des autres par sa distance, se tenant à l’écart, comme si elle n’était qu’une spectatrice parmi d’autres : “Marie était là, je l’avais sous les yeux maintenant, je l’apercevais dans la foule, et il émanait d’elle quelque chose de lumineux, une grâce, une élégance, une évidence.” Marie se dégage du “réel ankylosé”, de la “réalité ouatée” que percevait jusque-là le narrateur, et dans toutes les circonstances, il en ira de même. Les retrouvailles place Saint-Sulpice, un soir d’octobre, dans une atmosphère de bord de mer où il la contemple “elle, dehors, en figure de proue, devant l’océan invisible” annonce le voyage à Elbe, pour les obsèques de Maurizio, le gardien de la propriété paternelle. Les imprévus se multiplient, liés entre autres au comportement étrange de Giuseppe, le très antipathique fils du défunt. L’automne à Elbe est sinistre, froid et pluvieux. Marie et le narrateur arrivent après qu’un incendie a détruit la chocolaterie. D’abord “immatérielle, onctueuse, laiteuse et vanillée, une envoûtante odeur de chocolat” imprègne les lieux. Elle devient bientôt écœurante, envahissante. La pluie ou la brume enveloppe les êtres, les choses. L’incendie était d’origine criminelle et le roman prend des allures d’énigme policière, la véritable énigme tenant au comportement de Marie qui retarde depuis le début un aveu. Nous le tairons.
Roman d’amour, roman à rebondissements, Nuetient pour partie son titre de l’habitude qu’aMarie d’aller et venir sans aucun vêtement sur elle. C’est aussi une allusion à sa “dispositionocéanique”, “cette faculté miraculeuse, de parvenir dans l’instant à ne faire qu’un avec le monde, de connaître l’harmonie entre soi et l’univers, dans une dissolution absolue de sa propre conscience”. Nue, elle l’est alors par son indifférence totale aux codes sociaux, aux hiérarchies et aux conventions, pour devenir pure sensation.
Nue est aussi le roman de révélations retardées. Les parenthèses qui émaillent le texte mettent la distance ironique dont le romancier Jean-Philippe Toussaint est familier. On s’amuse pas mal à noter ce que le narrateur dit de lui-même ou des autres. Parfois, une simple virgule suffit. Ainsi, quand le narrateur dresse le portrait de son rival : “Son charme était irrésistible, c’était exactement le genre d’hommes dont Marie disait : “Je déteste ce genre de mecs”. ” Mais plus souvent on sera émerveillé par l’écriture de Toussaint, par ses cascades d’adjectifs aux sonorités accordées qui retardent, comme les sujets inversés et les incises, digressions ou subordonnées, le moment de la révélation. La forme s’accorde pleinement à ce qui est dit, de même que, dans telle Annonciation, l’attente se lit entre l’esprit qui vient et la Vierge qui l’accueille.
Comme dans les meilleurs romans d’amour et dans les contes de fées, le cycle de Marie se termine bien (si l’on se place en lecteur naïf et heureux de l’être). Quant à savoir si avec Marie quelque chose peut se conclure, nous en laisserons le lecteur juge.
Philippe Lançon, Libération, jeudi 5 septembre 2013
Le dernier volet de la tétralogie amoureuse de Jean-Philippe Toussaint
En 1708, Roger de Piles publie des Cours de peinture par principes qui vont marquer leur siècle. «Entre les choses qui donnent de l’âme au paysage, écrit-il, il y en a cinq qui sont essentielles : les figures, les animaux, les eaux, les arbres agités du vent, et la légèreté du pinceau. On pourrait y ajouter les fumées, quand le Peintre a l’occasion d’en faire paraître.» C’est une bonne critique des derniers livres de Jean-Philippe Toussaint : le cycle «Marie Madeleine Marguerite de Montalte» – quatre romans dont le dernier, Nue, clôt la tétralogie –, c’est de la peinture, cette peinture-là, mais à l’encre. Il y a les figures, les animaux (le désormais célèbre cheval en avion à la Géricault peut-être empoisonné dans la Vérité sur Marie, dans Nue un furieux essaim d’abeilles), les eaux, les arbres agités du vent, la légèreté du pinceau et, en guise de «fumées», deux formidables incendies sur l’île d’Elbe, l’un naturel, l’autre criminel, tous deux inspirés par des feux vus en Corse, où Toussaint réside volontiers : «La documentation, c’est l’île d’Elbe. L’expérience, c’est la Corse.»
Chocolaterie. Le premier incendie, dans la Vérité sur Marie, on l’a lu tandis qu’il se répandait : l’histoire de l’héroïne et du narrateur prenait alors feu, elle aussi. Quand on découvre le second, à la fin de Nue, il a eu lieu. Une vieille chocolaterie a été détruite, peut-être par des mafieux. On lit les vestiges fumant dans l’histoire qui s’achève. S’exprime dans les deux cas par le récit des odeurs et de l’atmosphère, tout part du peintre écrivain, qui profite de ce qu’il décrit pour préciser sa manière de décrire : «Mais cette odeur de brûlé, au départ indifférenciée, que j’avais simplement constatée sans pouvoir vraiment la définir, commença à se préciser dans mon esprit depuis que j’avais appris que c’était une usine à chocolat qui avait brûlé, et mon cerveau, aidé par cet indice, parvint à en prendre la mesure et à la reconstituer, à l’affiner, à la cerner complètement, je commençai moi-même à lui trouver des nuances plus douces, presque sucrées, pour faire naître dans mon imagination une vraie odeur de chocolat subjective et veloutée.» C’est l’odeur de Nue, «un livre qui commence dans le miel et qui finit dans le chocolat». De ce qui a brûlé remonte le temps amoureux perdu, puis revécu.
Les quatre «saisons» de Marie, c’est l’histoire d’un homme qui court assez lentement derrière une femme – ou qui l’attend, ou qui ne fait pas grand-chose pour la retrouver. Marie apparaît, disparaît. Elle est styliste, classe internationale. On ne saura ni la couleur de ses yeux, ni celle de ses cheveux : «“Elle avait le nez aquilin”, etc., c’est le roman du xixe siècle, je ne peux pas écrire comme ça, dit Toussaint. Ma vision de Marie est mentale, c’est comme une esquisse de Matisse en trois traits. Je cherche à la saisir, à l’incarner, c’est toujours mieux que de la décrire.» La voici, telle que le narrateur la vit : «La dernière inconstance de Marie de m’inviter ainsi à passer deux semaines avec elle à l’île d’Elbe pour me négliger ensuite et ne plus me faire aucun signe, n’était que l’ultime manifestation de sa radicale désinvolture.» La désinvolture : une trace d’amour, lorsqu’il vous menace. Le narrateur porte là-dessus un regard d’une bienveillance chic et anémiée.
Dans Nue, Marie crée une robe de miel. Elle donne à Toussaint l’occasion de se «fantasmer en créateur de haute couture», à travers une scène tout en virtuosité – l’une des rares du livre à se hausser du col, et dont la grammaire correspond à l’esprit de performance du défilé. La mannequin est enduite de miel comme une James Bond girl est peinte à l’or dans Goldfinger. La James Bond girl en mourait. La mannequin est ravagée par l’essaim qui la suit – comme l’est un cœur par l’excès de sentiments qui l’assaillent, ou un artiste par les conséquences inattendues de sa création. Toussaint n’est jamais allé à un défilé : «C’est ma collection, mais c’est une robe de mots, avec un effet de réel. Ma mode est la littérature.»
Biche. Comme dans les trois précédents livres, on est à Tokyo, Shanghai, Paris, sur l’île d’Elbe – trois des quatre livres s’achèvent dans ce lieu d’où Napoléon s’enfuit. Ni sans Marie ni avec, le narrateur continue d’aller d’hôtels asiatiques en bords de mer méditerranéens, de cadre d’exception en cadre d’exception, avec son long manteau gris noir, «qui est un autoportrait et qui vient de la Salle de bain», premier roman de l’auteur. C’est son côté lonesome cow-boy sans exploit et tout le charme discret de sa bourgeoisie. Une scène rappelle Mission impossible. Votre mission, si vous l’acceptez, est de surveiller Marie et de la convaincre de l’amour qu’elle vous inspire. Ce qui compte, c’est l’approche initiatique et non chronologique de cette femme fantôme, ébauchée par couleurs et par mouvements, de cette biche au fond du bois. De cette œuvre à «facettes», elle est la ligne de fuite.
La maison de couture de Marie s’appelle Allons-y, Allons-o. C’est ce que répète Belmondo à Anna Karina dans Pierrot le fou, lorsqu’elle le secoue pour qu’ils bougent. Marie, la ligne de fuite, a une grande ligne de chance, et le narrateur aime son imperceptible ligne de hanche. Les parents de Toussaint disaient souvent la phrase de Belmondo : «Dans mon univers, elle a toujours existé, j’aime son allant et son énergie. Mais le réalisateur qui m’a influencé, c’est Antonioni : cette Méditerranée brumeuse, ces énigmes elliptiques, ces petites choses dont j’essaie d’obtenir, avec très peu de matière, le maximum d’effet.» L’autre œuvre qui l’a «accompagné» pendant ces douze ans de vie imaginaire avec Marie, c’est le Quatuor d’Alexandrie, de Lawrence Durrell, deux fois lu. Il l’a ouvert à 40 ans; parce qu’il était invité au festival de cinéma d’Alexandrie, où il n’est pas allé.
Nue évolue, comme les trois autres volets, dans des espaces vidés par l’élégance. Marie est parfaite dans ses moindres gestes, ses absences, ses caprices. Le narrateur est le chevalier un peu mou qui lui sert d’écrin. Dans le monde de Toussaint, on tient la porte aux femmes qui regardent ailleurs, on attend qu’elles vous rappellent et on caresse leur parfum quand elles ont disparu. Il ne faut attendre de personne la moindre trivialité. Et, quand Marie demande des olives noires à un serveur du café de la place Saint-Sulpice, c’est si beau que la prose semble les avoir dénoyautées.
Tombeau. Toussaint a un art efficace et discret de la composition : des scènes pâles, d’une texture presque transparente, partant des «petites choses» ou d’observations communes, forment le fond d’où se détachent deux ou trois morceaux de bravoure qui, d’un tableau, seraient les centres nerveux. Ici, l’essaim d’abeilles fondant sur le top-model, la recherche d’un enterrement qu’on ne trouve pas, la chocolaterie incendiée, qui donne au sucre amoureux l’ombre d’une destruction et cette odeur de brûlé. Lues de près, comme en gros plan, les descriptions semblent banales, presque mièvres. A légère distance, elles ne le sont plus. L’ordinaire se fond dans le tableau qu’il tisse – dans le motif et la matière.
Le livre s’achève à la Toussaint – comme si l’écrivain, en quelque sorte, fleurissait son propre tombeau. Le mot, Toussaint, apparaît deux fois. Puis vient la dernière phrase, dite par Marie, ce fantôme muet. C’est un cri éperdu, enfantin : «Mais tu m’aimes, alors?» Quatre livres et tout ça pour ça? Bien sûr. Les obstacles à l’amour font partie des rares haies qui méritent, sans fin, d’être sautées.
Rencontre
- À l'occasion de la parution de Le Verdict et de L'Instant visible (EXB)
Du même auteur
- La Salle de bain, 1985
- Monsieur, 1986
- L'Appareil-photo, 1989
- La Réticence, 1991
- La Télévision, 1997
- Autoportrait (À l'étranger), 2000
- Faire l'amour, 2002
- Fuir, 2005
- La Mélancolie de Zidane, 2006
- La Vérité sur Marie, 2009
- L'Urgence et la patience, 2012
- Nue, 2013
- Football, 2015
- M.M.M.M., 2017
- Made in China, 2017
- La Clé USB, 2019
- Les Emotions, 2020
- La Disparition du paysage, 2021
- L'Instant précis où Monet entre dans l'atelier, 2022
- L'Échiquier, 2023
Poche « Double »
- La Télévision , 2002
- La Salle de bain, 2005
- L'Appareil-photo, 2007
- Faire l'amour , 2009
- Fuir, 2009
- Autoportrait (à l'étranger), 2012
- La Vérité sur Marie, 2013
- L'Urgence et la patience, 2015
- Nue, 2017
- L'Échiquier, 2025
Livres numériques
- Autoportrait (à l'étranger)
- Faire l'amour
- Fuir
- L'Appareil-photo
- La Mélancolie de Zidane
- La Réticence
- La Salle de bain
- La Télévision
- La Vérité sur Marie
- Monsieur
- Football
- L'Urgence et la patience
- M.M.M.M.
- Made in China
- Nue
- La Clé USB
- Les Emotions
- La Disparition du paysage
- L'Instant précis où Monet entre dans l'atelier
- L'Échiquier
