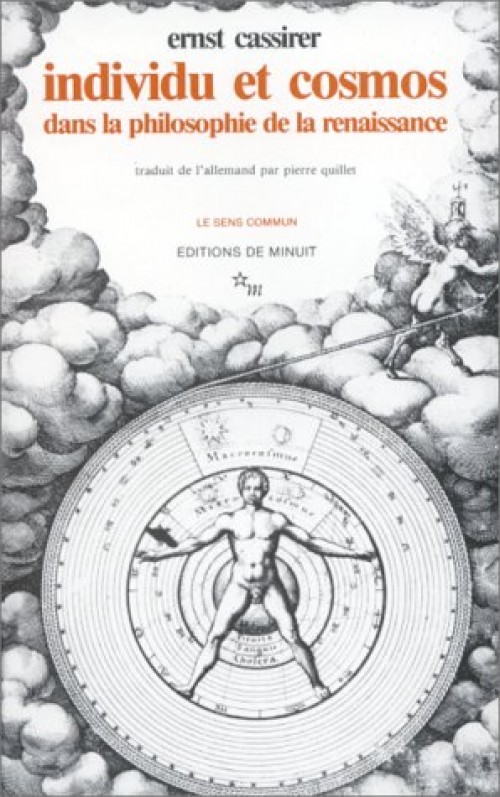
Ernst Cassirer
Individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance
Traduit de l’allemand et présenté par Pierre Quillet.
Suivi de La pensée par Nicolas de Cues, traduction nouvelle de
Maurice de Gandillac, et Le sage par Charles de Bovelle.
1983
Collection Le sens commun , 448 pages
ISBN : 9782707306487
43.00 €
Cassirer a mis un terme à l’aveuglement qui déniait toute activité philosophique à la vaste période de renaissance des lettres et des arts qui s’ouvre au XVe siècle avec Nicolas de Cues, premier théoricien du monde infini et s’achève en 1600 avec le supplice de son disciple Giordano Bruno. Cette philosophie était à déceler et à restituer dans sa vraie nature et son ampleur au prix d’un déchiffrage du riche tissu d’allégories poétiques et plastiques où se détache le ferme dessin du Microcosme, l’Homme de l’Humanisme, prenant possession du monde, ancêtre du Cosmotheoros des derniers textes de Kant.
L’humanisme est questionnement universel, foisonnement littéraire, éclat de l’érudition, élargissement de l’horizon... Mais il ne le serait point sans la puissante armature intellectuelle de sa philosophie. Au-delà des riches et pittoresques figures de ces temps d’éclosion apparaît l’unité systématique de la pensée qui a produit le monde moderne.
Les deux textes donnés en complément, De la pensée de Nicolas de Cues et Le Sage de Charles de Bovelles, sont, plus que des documents, les pièces à conviction de ce procès en réhabilitation de la philosophie de la Renaissance.
‑‑‑‑‑ Table des matières ‑‑‑‑‑
Introduction – Chapitre I : Nicolas de Cues – Chapitre II : Nicolas de Cues et l’Italie – Chapitre III : Liberté et nécessité dans la philosophie de la Renaissance – Chapitre IV : La problématique sujet-objet dans la philosophie de la Renaissance – De la pensée (Idiota III), de Nicolas de Cues, traduction de Maurice de Gandillac – Le Sage, de Charles de Bovelles, de Saint-Quentin, traduction de Pierre Quillet, d’après l’édition de Raymond Klibansky – Index
Gilles Lapouge (Le Monde, 20 avril 1984)
Ernst Cassirer et la philosophie de la Renaissance
L’extraordinaire aventure de Nicolas de Cues, qui eut son « illumination » en revenant de Grèce sur un navire, transforma l’idée qu’on se faisait de l’univers. Le philosophe allemand Ernst Cassirer a débusqué dans la profondeur des siècles le visage de ce précurseur.
« La Renaissance est une nouvelle vie. Elle fait la fête et la guerre. Elle dessine. Elle explore la Terre, les corps, la matière. Des images inconnues s’illuminent. On fréquente des royaumes interdits. On se penche sur des abîmes. On ajoute la contemplation des choses profanes à celle des vérités divines. La Terre devient grimoire à déchiffrer. Mais, de cette navigation fascinée, nous cherchons en vain le pilote, ou du moins ceux qui calculent les caps et les erres, ceux qui pensent la pensée de ce temps. Certes, les ouvriers grouillent sur le chantier : peintres et poètes, reîtres et humanistes, papes et banquiers, calculateurs, mécaniciens, courtisanes et aventuriers, tous les corps de métier sont à la peine ou à la joie, tous sauf un, celui des philosophes, ce qui pose une énigme : par quel prodige la Renaissance, au moment où elle invente une nouvelle Europe, n’emporte-t-elle dans ses cales que le vieil arsenal de la scolastique médiévale, même redorée des grâces du néoplatonisme ?
C’est peut-être cette devinette qui a lancé Cassirer dans les épaisseurs du Quattrocento. Son périple est subtil, car les sentiers de ce jardin bifurquent beaucoup. Mais Cassirer a l’œil rapide, et il a su débusquer quelques-uns de ses congénères, des philosophes, tapis dans les caves et les greniers des siècles renaissants. Ainsi nous dit-il que l’incroyable dérive n’obéissait pas seulement à une énergie aveugle, mais qu’elle était accompagnée en secret par les philosophes : Nicolas de Cues (1401-1464), surtout, dont le travail trouvera écho, un siècle et demi plus tard, chez Giordano Bruno. Sans doute connaissions-nous déjà le Cusain, grâce aux belles études de Gandillac, de Koyré ou de Tuzet, mais le livre de Cassirer a été écrit en 1927, et la France a dû attendre plus d’un demi-siècle pour en posséder la traduction.
Une illumination lance le Cusain sur les nouveaux chemins de la connaissance. “ En mer, revenant de Grèce (par un don d’en haut du Père des Lumières, je le crois, d’où provient tout don excellent), j’ai été conduit à comprendre incompréhensiblement des choses incompréhensibles, dans la docte ignorance, par un dépassement des vérités incorruptibles humainement connaissables. ” Diable ! Voilà qui n’est pas très encourageant.
La navigation sera tumultueuse, car, enfin, “ comprendre incompréhensiblement des choses incompréhensibles ” froisse un peu le bon sens. Or c’est de là, précisément, dans la contradiction radicale, que partent les fusées du Cusain. C’est là qu’éclate la foudre qui va ébranler tout l’édifice de la tradition.
Tradition dont le Cusain s’est nourri au début. Sa vie annonce les trois strates de sa pensée : né entre Trèves et Coblence, il est imprégné de mystique allemande (Maître Eckhart). Plus tard, à Heidelberg, il étudie la scolastique. Enfin, très jeune, il débarque en Italie où la grande fête de la vie a commencé. À Padoue, il apprend le grec, il débarrasse de leurs embaumements scolastiques Aristote et Platon.
Ces trois moments, nous les repérons dans la pensée du Cusain. La mystique est au départ. Nicolas entend que Dieu, l’Être, réside au-delà de toute possibilité de détermination positive. Dieu ne peut être désigné que par négations, il décourage toute mesure. Aucun passage de l’inférieur au supérieur, du sensible à l’intelligible. Le Cusain reprend cette idée : entre l’être de l’absolu et l’être des choses, les passerelles sont levées à jamais. Cependant, notre penseur remanie légèrement le discours mystique. En effet, une fois confirmée l’opposition du fini et de l’infini, Nicolas questionne cette opposition, mais à partir de la connaissance humaine. Il s’interroge moins sur Dieu que sur les possibilités de connaître Dieu, comme on dirait aujourd’hui. Et ces possibilités sont nulles. Le savoir est une mesure. On ne peut connaître que si l’on dispose d’une unité commune à deux objets. Or, “ du fini à l’infini, il n’y a nulle proportion ”. On ne mesure pas l’incommensurable.
Jusqu’ici, le voyage est ordinaire. Les mystiques nous avaient dit tout ça, mais les choses vont se gâter. C’est à ce moment-là, en effet, faut être un alpiniste aussi solide que Cassirer pour se promener sur ces bords du vide. Quant aux paysages que la foudre du Cusain va dévoiler, à peine en esquisserons-nous de loin quelques-uns.
En réhabilitant l’expérience, le Cusain rend le monde à l’esprit humain. Mais c’est un monde transformé, dans lequel les barrières du fini sont crevées et l’infini frissonne – l’indéfini, vaudrait-il mieux dire. Tout être naturel est également loin et proche de son origine divine. Le haut et le bas n’ont plus de lieu. L’homme habite un cosmos homogène dans lequel le sublunaire et le céleste ne se contrarient plus, un cosmos réunifié qui s’oppose en revanche, en tant qu’être empirique, à l’être absolu, tout en participant à l’absolu. “ Tout est tout ”, disait Anaxagore.
Une cosmogonie inédite se forme. De même que le cercle parfait n’existe pas (car le cercle sensible ne peut correspondre à son concept), il ne se trouve pas de sphère parfaite dans le cosmos. La Terre n’est alors qu’un objet parmi les autres, elle n’est ni basse ni condamnable. Fin du géocentrisme. La relativité du lieu, celle du mouvement sont proclamées. Le monde, à l’infini étendu, n’a plus de centre. Le centre devient notion métaphysique : Dieu est le centre, en même temps qu’il est la circonférence. (Cassirer ne note pas, et c’est étrange, que Dieu, centre et cercle, est une notion hermétique bien plus ancienne.)
D’autres effets suivent : réhabilitation de l’individu, celui-ci n’étant plus le contraire de l’universel mais son accomplissement. L’absolu en qu’éclate un tremblement de ciel, si l’on peut dire : dans le temps même où Nicolas avance que l’Être ne peut pas être connu, il ajoute que nul ne peut aimer s’il ne connaît pas. Voilà un inconvénient ! Comment aimer Dieu si Dieu est inconnaissable ? Eh bien, en connaissant l’inconnaissable. Nous voici emportés bien loin de ces mystiques qui ne veulent aimer Dieu que par le sentiment et la fusion, par l’extase et les ténèbres.
La tâche du Cusain commence à peine. Il doit découvrir un autre mode de connaissance, une méthode pour “ comprendre incompréhensiblement l’incompréhensible ”, et c’est la “ docte ignorance ”. L’organe qui permet de connaître l’absolu est la visio intellectualis dans laquelle les oppositions de genres s’abolissent. Il s’agit de se transporter jusqu’à l’origine, jusqu’au point qui se situe en deçà de toute division. Et le Cusain forge un nouvel instrument de savoir : renoncement à la logique des genres, celle d’Aristote, qui ne peut s’appliquer qu’au “ fini ”, et son remplacement par une logique mathématique qui n’exclut pas la coïncidence des opposés. Mieux : la logique nouvelle va utiliser cette coïncidence, celle du maximum absolu et du minimum absolu, pour frayer la voie de la connaissance.
Aristote se trouve congédié deux fois – d’abord parce que de Cues rétablit l’abîme entre l’Être et les étants, ensuite parce que la logique du tiers exclu est déchue au profit d’une logique des opposés. Platon, au contraire, relu par le Cusain, devient phare en ces obscurités, à la fois d’avoir creusé déjà le gouffre entre le sensible et l’intelligible et de fournir la notion de “ participation ”. Grâce à cette participation, en effet, la brisure entre le fini et l’infini, bien loin de ruiner l’expérience, la restaure, la confirme dans ses droits. Par la participation, tout être conditionné vise l’inconditionné, même sans l’atteindre. À coup sûr, tout savoir empirique est infirme, réduit à la conjecture, mais justement, à proportion de son imperfection, il est voué à se dépasser incessamment. À ce point, le renversement du Cusain est accompli : de la théologie négative jaillit une théorie positive de l’expérience. La séparation trace la voie royale de la connaissance.
Un peu compliqué ? C’est de l’eau de roche, pourtant, si l’on songe aux liqueurs que distille Nicolas. Cette tête y allait par quatre chemins, et l’on a dû simplifier honteusement, sauter des nœuds et perdre des mailles. La pensée du Cusain est un tournoiement, elle se renverse et rebondit, elle organise la clarté par les moyens de la nuit, et il […] soi n’est concevable qu’à condition d’être déterminé dans une perspective individuelle. Le particulier ne doit plus avoir honte. La position de l’homme est renouvelée : comme le Christ est l’expression de toute l’humanité, l’homme porte en soi la totalité des choses. Il est le microcosme dans lequel s’entrelacent les fils du macrocosme. La nature aussi est exhaussée. Le monde est le symbole de Dieu. L’invisible tremble derrière le visible. La nature est le livre que Dieu a écrit, qu’il n’est plus question de s’approprier par la fusion mystique, mais qu’on déchiffrera lettre à lettre : la voie de la science objective est tracée.
Le Cusain va très loin. Il oppose le livre de la nature au discours ; il suggère que la nature l’emporte sur tout discours, même sacré. Un savoir profane se cherche en même temps que l’homme et la nature non seulement sont réconciliés mais découvrent leur noblesse. Les noirceurs du péché originel pâlissent. L’homme saisit les moyens de sa liberté : dans sa sphère, il est libre, créateur, ce qui change l’histoire de lieu et de sens. Le monde du Cusain est baigné d’optimisme. Le devoir de retraite et de mépris des choses est forclos. Le Cusain restitue à l’homme la nature, avec ses sons, ses parfums, ses couleurs, avec son inlassable beauté.
Bien peu connu de ses contemporains, Nicolas a cependant modelé l’esprit du temps : quand Galilée proclame que le monde n’est pas une forme, mais l’universalité des lois auxquelles nul être singulier ne peut échapper, quand Léonard de Vinci avance que la nature est mathématique, le Cusain est passé par là. Wepler, Descartes suivront. Et l’étrange Giordano Bruno.
On peut parier que le Cusain, un siècle et demi après sa mort, du haut (ou du bas) du ciel où il loge alors, tend une oreille attentive vers la Terre, le jour où Giordano Bruno fait exploser les sphères du fini avec une vraie jubilation. Il est vrai que Bruno utilise d’autres outils. Moins mathématicien que poète, il décrit l’intuition de l’infini comme un acte du moi, l’homme ne trouvant son moi qu’en attirant en soi l’infinité de l’Être tout en élargissant son être jusqu’à l’infini.
Cette trouvaille va causer au pauvre, pathétique, Giordano Bruno quelques tribulations. Rome le brûlera – et sur ce bûcher, au terme d’un destin enthousiaste, rocambolesque et tragique, s’achèvera aussi l’extraordinaire périple que le Cusain avait inauguré sur un navire grec, et qui a fait surgir, du fond des gouffres, les terres sur lesquelles les sciences modernes vont monter leurs ateliers. »
Roger Chartier (Libération, 5 janvier 1984)
Cassirer ou Pic de la Mirandole au XXe siècle
Dans Individu et cosmos à l’époque de la Renaissance Cassirer explore la préhistoire de la modernité.
« Lorsqu’il publie en 1927 Individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance, Ernst Cassirer a déjà une œuvre immense sur laquelle il appuie ce nouveau texte. Le socle en est déjà constitué par les trois tomes, publiés en 1906, 1907 et 1920 du Problème de la connaissance dans la philosophie et la science de l’âge moderne et par les deux premiers volumes, datés de 1923 et 1925, de la Philosophie des formes symboliques.
De cette œuvre immense, à l’influence décisive sur toute la pensée allemande du XXe siècle (et par exemple sur Norbert Elias, natif comme Cassirer de Breslau / Wroclaw), la réception française a été tardive. Il faut donc saluer ceux, éditeurs, directeurs de collections, traducteurs, qui ont travaillé à rendre accessible en français une partie au moins de ce corpus considérable. L’impulsion n’est pas si ancienne puisque c’est en 1966 seulement que Fayard publiait en traduction La Philosophie des Lumières. Grâce au travail patient et exemplaire des Éditions de Minuit le mouvement a pris ampleur puisque, en une dizaine d’années, cinq œuvres maîtresses, dont les trois tomes de La Philosophie des formes symboliques, ont été proposées au lecteur français.
La dernière venue est donc Individu et cosmos à l’époque de la Renaissance dans une traduction de Pierre Quillet. Livre difficile, livre magnifique, tout entier construit à partir d’une question centrale : quelles ont été les conditions de possibilité et d’émergence d’une définition radicalement neuve des concepts de liberté et de nature. Le propos de Cassirer est donc d’étudier la préhistoire, dans une Renaissance largement découpée, de la double révolution des années 1620/1630 : celle de la nature écrite en langage mathématique des textes galiléens, Il saggiatore et les Discorsi, celle du cogito cartésien. Pour lui, l’œuvre où tout prend origine est celle de Nicolas de Cues, qualifié de “ premier penseur moderne ”. Dans une langue qui est encore celle de la scolastique et tout en acceptant des catégories et des distinctions de la tradition, le Cusain opère en fait un déplacement essentiel.
Il propose une cosmologie neuve, qui rompt avec la conception d’un univers géocentré et hiérarchisé, et formule une doctrine de la liberté de l’homme puisque sa nature intellectuelle, s’il en use correctement, “ est capable de comprendre Dieu puisqu’elle est infinie en puissance ”. L’œuvre du Cusain, connue en Italie, révérée par Kepler, portait donc en elle les germes d’une définition nouvelle des concepts de nature et de liberté. Pourtant, ce n’est que lentement et difficilement que celle-ci s’énonce et devient dominante. Le plus passionnant du livre de Cassirer réside sans doute dans son effort pour comprendre le pourquoi de ce retard et caractériser les obstacles rencontrés par les pensées nouvelles. Pour lui, en effet, l’histoire des idées n’obéit aucunement à un modèle linéaire et évolutionniste, où un progrès continu et cumulé frayerait la voie à la modernité. Tout au contraire, l’histoire des pensées est faite d’inventions et de reculs, jalonnée de systèmes où presque toujours s’entremêlent formulations novatrices et représentations traditionnelles.
À la Renaissance, elles sont trois qui croisent, retardent ou contaminent l’élaboration de la nouvelle conception du monde. D’abord, la théologie scolastique qui impose ses dogmes, ses références, ses outillages intellectuels même aux pensées les plus hardies, par exemple celle d’un Pomponazzi qualifié par Cassirer de “ philosophie des Lumières en vêture scolastique ”. Ensuite, la prégnance d’une conception astrologique de la causalité qui voit dans la logique du mouvement des astres la condition d’intelligibilité des phénomènes naturels et des actions humaines qu’elle détermine. De là, l’impossibilité à donner un statut à la liberté de l’homme ; de là l’obstacle mis à une pensée de la séparation radicale entre science et magie par une astrologie “ rationnelle ” qui vise. ni la divination ni la manipulation mais la compréhension logique, “ scientifique ” des lois de la nature. Dernier obstacle épistémologique dressé devant une refonte du concept de nature : les progrès mêmes des observations empiriques, des expérimentations sensibles. Celles-ci, en effet, demeurent traversées par le magique et le merveilleux qu’en retour elles accréditent, et surtout postulent que la connaissance est toujours fusion, voire effusion entre le sujet connaissant et l’objet à connaître. Les observation, accumulées, loin de fonder la science moderne, peuvent se convertir cri ses contraires : une théorie de la connaissance sensualiste et “ panpsychique ”, pour reprendre le titre d’un livre de l’humaniste Patrizzi, et une philosophie de la nature mystique et occultiste. Sans la mathématisation, aucun lien n’existe entre l’expérience sensible et le concept moderne de nature.
Ce dernier, tout comme celui de liberté, s’enracine dans d’autres origines, à savoir la logique mathématique et la théorie de l’art situées par Cassirer dans un parallélisme absolu. L’une et l’autre à la Renaissance visent en effet à établir les lois éternelles qui régissent les phénomènes naturels et à découvrir les raisons mathématiques qui fondent les réalités empiriques. Et l’on trouve chez Vinci des accents galiléens pour affirmer ce primat de l’entendement mathématique qui seul donne accès au vrai et au beau. Il importe plus que la perception immédiate : “ il n’est point d’effet sans raison dans la nature : prends garde à la raison et tu n’auras pas besoin de l’expérience ” ; il est fondateur du savoir authentique : “ nulle recherche ne peut se prétendre science véritable si elle ne passe pas par les démonstrations mathématiques ”. Le philosophe comme l’artiste ont donc pour mission de saisir, par la pensée ou l’image, les relations nécessaires et mathématiques qui idéalement construisent le réel. La démonstration de Cassirer joue donc à fronts renversés, renvoyant du côté de la magie la connaissance sensible ou l’observation empirique, et situant aux fondements de la pensée scientifique moderne les théories esthétiques de la mesure et de la perception.
Pour lui, la rupture majeure tient à la constitution d’un nouveau rapport entre le sujet et l’objet, un rapport qui substitue à la fusion sensualiste une distance qui seule permet de penser, ensemble, la nécessité des lois de la nature, observables désormais dans un espace unique, homogène, linéaire, dépouillé de toute propriété “ substantielle ”, et la liberté de l’homme qui, installé en un lieu identique à tous les autres, en produit la connaissance. Par là, retour peut être opéré à la question initiale du livre : en quoi le travail philosophique de la Renaissance donne-t-il une “ expression systématique ” des aspirations intellectuelles du temps ? À n’en pas douter, soutient Cassirer dans la dernière page du livre, en exaltant la liberté créatrice de l’homme confronté aux lois nécessaires de l’univers : “ le moi est à la hauteur du cosmos infini puisqu’il trouve en soi des principes pour le connaître dans son infinité ”.
Il va de soi que plus de cinquante ans après la publication du livre de Cassirer, tel ou tel point de sa démonstration peut être discuté : ainsi la modernité de la pensée cosmologique de Nicolas de Cues, fortement contestée par Alexandre Koyré dans Du monde clos à l’univers infini paru en 1962 ; ainsi la lecture toute “ scientifique ” des spéculations esthétiques sur les mesures et les nombres qui, elles aussi, peuvent appartenir au registre de la pensée magique et occultiste ; ainsi l’identification sans doute trop univoque de la pensée de la Renaissance avec une affirmation conquérante et optimiste de la liberté de l’homme.
Mais l’essentiel, bien sûr, n’est pas là. Il est dans l’exemple donné par une œuvre qui jamais n’a séparé l’analyse des pensées anciennes et l’invention théorique, le commentaire philosophique et l’entreprise philosophique. Et c’est sans doute justement parce qu’il était philosophe, au sens le plus pleinement créateur du terme, que Cassirer pouvait penser l’histoire des problèmes philosophiques dans son rapport avec toutes les autres histoires culturelles, attentif aux savoirs scientifiques, aux textes littéraires, aux formes artistiques, aux sensibilités religieuses. Belle leçon. Leçon perdue en un temps où la critique des textes philosophiques s’est réenclavée dans un isolement érudit, et où sur le marché des idées se donnent pour “ philosophiques ” des marchandises qui ne le sont en rien. Raison de plus pour relire Cassirer chez qui le savoir philosophique, dans sa plus rude exigence, était une porte ouverte pour la compréhension des évolutions culturelles, pensées en leur entier. »
Jean Lacoste (La Quinzaine littéraire, 1er mars 1984)
De Nicolas de Cues à Cassirer
« Il est caractéristique de la démarche véritablement européenne d’Ernst Cassirer qu’il ouvre à la fois sa monumentale étude du problème de la connaissance à l’époque moderne (Das Erkenntnisproble, t. 1) (1) et son analyse de la philosophie de la Renaissance en présentant l’œuvre peu connue du cardinal Nicolas de Cues (1401-1464). Cet Allemand né à Kues, sur les rives de la Moselle, et devenu prince de l’Église romaine après avoir subi l’influence de la devotio moderna de Ruysbroek chez les “ Frères de la vie commune ” à Deventer, celle de Guillaume d’Occam à Heidelberg et celle de l’humanisme italien à Padoue, est le premier, selon lui, à avoir posé dans toute son ampleur le problème des limites de la connaissance humaine et la question éventuelle de l’idéalisme européen, la méthode.
Dans la Docte ignorance, en effet, en 1440, Nicolas de Cues présente une critique des voies traditionnelles de la scolastique en affirmant qu’il ne peut y avoir une connaissance de l’infini et de l’absolu : “ Du fini à l’infini, il n’y a nulle proportion. ” Mais, s’il renonce à la “ théologie rationnelle ” trois cents ans avant Kant, le Cusain ne se réfugie pas dans théologie mystique du sentiment. Dieu reste accessible à une “ vision intellectuelle ” qui s’appuie, non plus sur la logique aristotélicienne, mais sur Ies mathématiques : “ Nous n’avons rien de certain dans notre science que notre mathématique et c’est elle qui est notre symbole pour aller à la chasse des œuvres de Dieu. ” La “ docte ignorance ” ouvre donc la voie à une théorie positive de l’expérience, qui permet à Nicolas de Cues, selon Cassirer (p. 34), d’exposer “ le principe de la relativité du mouvement et la théorie du mouvement propre à la Terre ”. À la place du cosmos clos, géocentrique et hiérarchisé décrit par Aristote, qui opposait le monde “ sublunaire ” aux sphères célestes parfaites, on voit apparaître un espace infini, homogène, qui ignore l’idée de centre.
Le mérite de Cassirer est de montrer comment cette intuition, qui prépare la révolution physique de Copernic et de Kepler, se traduirait également, chez le cardinal qui fut, lors du concile de Bâle (1431-1437), l’artisan d’un rapprochement avec l’Église d’Orient et le défenseur de l’unité de l’Église, par une théorie de la diversité des religions. Cassirer écrit, à propos de De la paix de la foi (1454), que “ la multiplicité, la différence et l’hétérogénéité des formes religieuses, loin de contredire l’unité et l’universalité de la religion, sont justement l’expression nécessaire de cette même universalité ”. Mais nous comprenons mieux ainsi pourquoi l’auteur de la Philosophie des formes symboliques, qui explora dans toute sa diversité la culture humaine (le langage, les mythes et les sciences) pour y trouver la marque de l’activité créatrice de l’esprit, accorde tant d’importance à celui qui, dès le Quattrocento, semble affirmer que “ pour atteindre à l’intuition du vrai l’esprit n’a pas à copier un être intérieur mais à s’expliciter lui-même ” (p. 55). Cassirer présente Nicolas de Cues comme l’homme de la “ coïncidence des opposés ”, et donc comme l’homme qui cherche à trouver un équilibre entre les enseignements de la foi chrétienne et la vérité philosophique. Mais il fut lui-même un homme d’équilibre dans la mesure où il tenta inlassablement de réconcilier l’enseignement de l’idéalisme classique, dont ses travaux sur Leibniz et Kant lui avaient donné une connaissance excellente, avec la diversité de nos connaissances anthropologiques (2).
Le titre du présent ouvrage, Individu et cosmos, s’éclaire alors. Il peut sembler se rapporter au thème classique à la Renaissance du microcosme et du macrocosme, des rapports d’ordre magique qui se nouent entre l’homme individuel et les forces de la nature et l’organisation du monde. Ce thème est présent, en particulier, dans le texte de Charles de Bovelles, Le Sage, qui est publie en appendice, mais Cassirer veut surtout montrer comment l’homme parvient à acquérir une connaissance réelle, empirique, scientifique, de l’univers au moment même où il prend conscience de son pouvoir et des ses possibilités de création intellectuelle. Chez Nicolas de Cues, la découverte de cette corrélation entre science et idéalisme prend une forme religieuse : l’humanité est l’intermédiaire entre Dieu et le cosmos, l’homme apparaît comme la “ copule ” du monde “ parce qu’il unit en lui tous les éléments du cosmos, mais surtout parce qu’il décide du destin religieux du cosmos ”. Cassirer s’attache à montrer que cette double découverte anime en fait toute l’histoire de la philosophie de la Renaissance : c’est ce qu’il appelle le “ problème de la forme ”.
On a souvent souligné depuis Jacob Burckhardt l’importance de l’individualisme héroïque, de l’élan enthousiaste du moi vers l’infini qui caractérise la Renaissance. À la fable d’Adam pécheur, les poètes de la Renaissance. opposent le mythe de Prométhée, et Pic de La Mirandole écrit un fameux Discours sur la dignité de l’homme. Mais, dit Cassirer, “ le moi ne se trouve lui-même que dans la mesure où il se donne au monde ”. Les dialogues de Nicolas de Cues, rassemblés sous le titre Le Profane (ldiota) : la Sagesse, la Pensée (publie en appendice dans la traduction de Maurice de Gandillac) et Les Expériences statériques (c’est-à-dire avec une balance), nous donnent par avance une certaine idée de ce qui permettra à l’homme cartésien de découvrir le monde. Toute connaissance est mesure, dit le Cusain, toute pensée pesée : mens vient de mensurare (p. 247). Mais avant que la pensée humaine puisse déchiffrer la nature comme un livre que Dieu aurait écrit en langage mathématique, selon l’expression de Galilée, il fallait surmonter ce que Cassirer décrit longuement et qu’on pourrait présenter comme un véritable obstacle épistémologique, l’astrologie.
Cassirer suggère que le recul du christianisme donna une influence accrue aux conceptions astrologiques. L’homme, délivré de l’obsession du péché et de la grâce, se trouvait livré à l’influence des étoiles, à l’emprise de la Fortune, à la domination du destin. Marsile Ficin s’afflige d’être soumis à Saturne, la planète de la mélancolie. Pomponazzi, le philosophe aristotélicien de Padoue, rédige un livre sur les Causes des Effets miraculeux ou les Enchantements (1520), et Pic de La Mirandole un pamphlet contre l’astrologie. Giordano Bruno écrira, plus tardivement, L’Expulsion de la bête triomphante, contre les spéculations sur le zodiaque. L’astrologie représente en effet une tentation naturaliste qui s’oppose directement au sentiment de liberté et de vie que l’homme de la Renaissance peut éprouver en lui-même. Telle serait, selon Cassirer, la contradiction propre à la Renaissance.
Toutefois, la Renaissance sut briser ce cercle enchanté, et surmonter cette contradiction, par la science et l’art ; unis dans une même exigence, celle de la forme. Cassirer montre ainsi comment, pour découvrir les liens entre connaissance vraie et liberté, il fallait aller au-delà du problème de l’âme et dépasser le conflit entre “ nature ” et “ esprit ”. Dans le langage conceptuel particulier à Cassirer, qui commande toute sa vision de l’histoire de la philosophie et des sciences (3), “ un changement ne se fait jour que lorsque peu à peu commence d’être mise à l’écart la présupposition qui préside aussi bien à la psychologie spiritualiste (Ficin) qu’à la psychologie naturaliste de la Renaissance (De l’immortalité de l’âme, de Pomponazzi), lorsqu’au lieu de la relation “ substantielle ” du “ corps ” et de l’“ âme ”, survient une relation “ fonctionnelle ” (p. 182). Or, ce passage de la substance à la fonction, qui ne sera opéré que plus tard dans la philosophie, avec Kant, se trouve préfiguré dans la science et l’art, avec Galilée et Léonard de Vinci. L’art et la science ont, déjà, l’exigence de la forme pure et s’opposent par là à la “ vision mystico-magique de la nature ”, car “ toute forme – qu’on l’entende en un sens théorique ou esthétique – réclame d’être limitée et fixée ”. “ Quand la nature doit être (...) saisie par la pensée comme soumise à la nécessité des lois, le panthéisme (...) ne suffit plus ” (p. 216). “ L’espace mental logicomathématique, tout comme l’espace plastique esthétique, n’est possible que par la distance qu’on maintient entre le sujet et l’objet. ”
Ainsi, la vraie philosophie de la Renaissance trouve son expression la plus novatrice, non pas dans quelque vision métaphysique et panthéiste, mais au contact des arts et des sciences, dans une nouvelle conception de l’espace. Nicolas de Cues, dans une perspective religieuse, Galilée ou, bien avant, les peintres florentins de la perspective, nous font passer de l’espace-substance, de l’espace-chose, à l’espace fonctionnel, à l’espace comme “ architecture linéaire idéale, librement élaborée ” (p. 231). Avec le “ stéréométrie des volumes ” de Kepler, l’espace “ se dépouille de ses dernières traces de matérialité ”. Il devient une “ structure ordinale pure ” et ouvre la voie à la notion de coordonnées, œuvre de Fermat et de Descartes.
Livre déjà ancien, puisque publié en 1927, Individu et cosmos mériterait d’être étudié, prolongé et peut-être critiqué en fonction des travaux sur la Renaissance qui ont été publiés ensuite. Il suffit peut-être de rappeler, pour en souligner l’importance, que Panofsky s’est explicitement référé à Cassirer et à la notion de forme symbolique dans La Perspective comme forme symbolique. De toutes les manières, Cassirer a apporté une contribution irremplaçable en soulignant l’intérêt de la figure de Nicolas de Cues, et en rendant accessible un texte important du cardinal de Saint-Pierre-aux-Liens.
Il est vrai que, quelles que soient la sobriété et l’honnêteté universitaire de sa démarche, Cassirer est un Aufklärer militant qui place sur les pensées de la Renaissance un schéma de l’évolution de la raison qui peut paraître critiquable. Les auteurs de la Renaissance sont jugés et mesurés à l’aune de l’idéalisme kantien, en fonction d’une théorie de la connaissance si impérieuse qu’elle organise toute l’histoire de la philosophie, dans Das Erkenntnisproblem, et sert d’ossature aux Formes symboliques. Cassirer ne cherche pas à décrire la “ mentalité ” de la Renaissance, ni à faire revivre celle-ci dans sa vie diverse et colorée. Maître de philosophie par excellence, il suit avec enthousiasme un fil directeur qui lui permet de reconstruire les œuvres qu’il analyse. Sa langue est académique, mais il incarne avec force et dans défaillance une tradition philosophique “ cartésienne ” dont les éléments constitutifs – le souci de la méthode, l’idéalisme, la science comme idéal de connaissance – faisaient, précisément en 1927, l’objet d’une critique radicale, dans L’Être et le temps de Heidegger.
Individu et cosmos n’est donc pas seulement un ouvrage d’histoire de la philosophie, un travail d’érudition. En étudiant la pensée œcuménique et tolérante du “ premier penseur systématique allemande ”, Cassirer cherchait à revenir à l’origine même d’un mouvement dont il fut peut-être le dernier représentant. Nicolas de Cues ouvre une période qui s’est close avec Cassirer. »
(1). Le troisième tome de cette histoire de la philosophie du point de vue de la connaissance vient d’être traduit à l’initiative du Collège de philosophie (MM. Renaut, Ferry et alii) et publié aux Presses Universitaires de Lille.
(2). Dans la conclusion de son Essai sur l’homme (Éditions de Minuit, p. 317), Cassirer reprend à son compte le thème cher à Nicolas de Cues de l’harmonie des contraires : “ La philosophie (...) ne méconnaît pas les tensions et les frictions, les fortes oppositions et les profonds conflits entre les différent, pouvoirs de l’homme (...). Mais (...) toutes ces fonctions sont complémentaires. Chacun ouvre un nouvel horizon et nous montre un nouvel aspect de l’humanité. Le dissonance est en même temps harmonie. ”
(3).Substance et fonction. Éléments pour une théorie du concept (Éditions de Minuit, 1977).
Michel Field (Les Nouvelles, 1984)
Renaissance de la philosophie
« Si la Renaissance est depuis longtemps un terrain privilégié de l’histoire de l’art (la somme “ classique ” de Burckardt, comme les ouvrages contemporains d’André Chastel ou de Pierre Francastel sur le “ Quattrocento ” en témoignent), il n’en va guère de même dans l’histoire de la philosophie : la Renaissance y reste largement méconnue, quand elle n’y est pas simplement ignorée. C’est non seulement commettre une réelle injustice sur une époque d’intense bouillonnement intellectuel et scientifique, de questionnements audacieux et de radicales transformations dans la vision du monde, mais c’est aussi se priver des clefs essentielles à la compréhension de la philosophie classique : Michel Serres l’avait bien vu qui, dans son ouvrage sur le Système de Leibniz, analysait “ le paradigme pascalien ” et la quête du “ point fixe ” commune aux pensées du XVIIe siècle à partir de Nicolas de Cues et de Giordano Bruno.
C’est dire l’importance d’un ouvrage majeur d’Ernst Cassirer, Individu et Cosmos dans la philosophie de la Renaissance (1927) que publient les Éditions de Minuit dans une traduction de Pierre Quillet. Livre expressif de la tradition des grands penseurs allemands, qui allient à une profonde connaissance des textes une élaboration conceptuelle permettant d’en saisir les enjeux. Ici, l’érudition n’est jamais gratuite ou pesante : elle assure au contraire à la réflexion son fondement, ses repères historiques et épistémologiques, prouvant que la “ vie de la pensée ” est inséparable de son histoire.
Partant d’une analyse de l’œuvre de Nicolas de Cues (dont le texte De la pensée est publié à la fin de l’ouvrage, à côté du surprenant Le Sage, de Charles de Bovelles), Cassirer élargit progressivement son propos à l’influence et au rayonnement de Nicolas de Cues dans l’Italie du XVe siècle – et au-delà –, puisque “ les doctrines cosmologiques que le cardinal de Cues établit en 1440 dans La Docte Ignorance sont les mêmes que celles qui, un peu plus d’un siècle et demi plus tard, conduiront Giordano Bruno à la mort et vaudront à Galilée les poursuites ecclésiastiques et l’excommunication ”. Sans prétendre résumer une étude aussi dense, on peut dire que l’enjeu essentiel de ce bouleversement théorique est l’émergence d’un nouveau statut de l’individu, du sujet, tel qu’il sera finalement théorisé par les grands systèmes philosophiques du XVIIe siècle. Autrement dit encore : l’émergence de l’idée de liberté, constitutive de la modernité. Cet enjeu permet de mesurer l’incroyable complexité des problèmes soulevés et l’enchevêtrement de leur expression dans la philosophie, la littérature et la peinture : problèmes indissociablement cosmologiques et religieux, philosophiques, scientifiques et esthétiques – vu le rôle aristotélicien dans la doctrine de l’Église. Mais, en même temps (et c’est l’un des points forts du livre de Cassirer), la pensée moderne en gestation durant ces siècles ne se rapporte pas à Aristote sur le mode d’une simple opposition : réactiver la philosophie d’Aristote contre le système dogmatique issu de sa lecture scolastique, c’est élaborer une nouvelle démarcation entre Platon et Aristote d’une part, entre Platon et le néo-platonisme d’autre part. D’où l’audace de la réflexion du Cusain : puisque, si le diamètre d’une circonférence augmente, la courbure de celle-ci diminue à proportion, cercle et droite, à la limite, coïncident. La terre n’est plus au centre d’un cosmos ordonné, l’homme n’est plus au centre de la terre.
“ Si le monde avait un centre, il aurait aussi une circonférence et contiendrait en lui début et fin, et ce monde serait limité par un autre monde... Où que se situe l’observateur, il se croira au centre de tout ”, écrit de Cues dans La Docte Ignorance (II, 2). C’est tout l’ordre médiéval qui commence à vaciller. Bien plus – et cet aspect intéresse particulièrement le penseur de l’idéalisme allemand qu’est Cassirer – c’est toute une nouvelle rationalité qui cherche à se fonder, dépassant la logique aristotélicienne, s’émancipant du principe d’identité et de non-contradiction : le tout est aussi dans la partie, l’universel dans le singulier. Il n’y a plus d’accord préétabli entre l’individu et le monde : “ l’Homme en face de l’univers, le moi en face du monde, apparaît à la fois comme l’englobant et l’englobé ; les deux déterminations sont également indispensables pour exprimer son rapport au cosmos. Ainsi s’établit entre le moi et le monde une constante conversion de l’un dans l’autre ”, dont la conséquence majeure est que, désormais, “ l’esprit égale le monde qu’il conçoit ” (p. 241). On peut se demander si, pour une part (à l’exception de Pascal, sans doute), les entreprises systématiques du XVIIe siècle ne perdront pas cette sensibilité intuitive à la contradiction, aux relations entre contraires, si caractéristiques de la philosophie de la Renaissance : mais l’ouvrage de Cassirer montre magistralement que c’est à partir d’elle, et grâce à elle, que l’homme se donnera bientôt pour tâche de devenir maître et possesseur d’une nature qu’il aura mis quelques siècles à radicalement repenser. »
Du même auteur
- La Pensée mythique. La Philosophie des formes symboliques II, 1972
- La Phénoménologie de la connaissance. La Philosophie des formes symboliques III, 1972
- Le Langage. La Philosophie des formes symboliques I, 1972
- Langage et mythe, 1973
- Essai sur l'homme, 1975
- Substance et fonction, 1977
- Individu et cosmos dans la philosophie de la Renaissance, 1983
