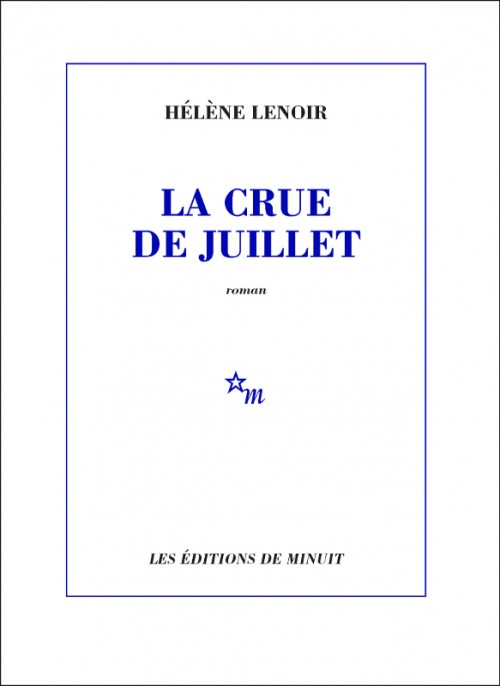
Hélène Lenoir
La Crue de juillet
2013
160 p.
ISBN : 9782707322678
14.50 €
30 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Début juillet, orages et pluies diluviennes ont soudain transformé le fleuve en torrent, provoquant un accident qui a fortement ému la ville.
Thérèse vient d'arriver. Étrangère, elle a soigneusement préparé son week-end dont le temps fort doit être une entrevue avec un peintre célèbre. Mais, dès le premier soir, rien ne se passe comme prévu.
Surmontant sa contrariété, elle s'installe à la terrasse d’un bistro, non loin de Karl Ritter, un quinquagénaire fatigué, qui, frappé par sa beauté, la regarde.
ISBN
PDF : 9782707325419
ePub : 9782707325402
Prix : 10.99 €
En savoir plus
Patrick Kéchichian, La Croix, 21 février 2013
Pour son dixième livre, Hélène Lenoir situe son intrigue dans une ville qu’on pourrait croire autrichienne, troublée par un fait divers, alors que les pluies de juillet ont fait monter les eaux du fleuve.
Imaginons qu’une importante instance littéraire, éditoriale par exemple, ait convoqué Hélène Lenoir à venir piocher dans un chapeau, sous la forme d’indications aléatoires, les éléments de son prochain roman. Le temps accordé à l’impétrante pour composer son œuvre est désormais passé. Les critiques sont réunis, qui ont lu La Crue de juillet. Ils s’observent sans bienveillance. Et le jugement tombe… Hélène Lenoir quitte la salle avec les félicitations du jury et sous les applaudissements – anticipés, puisque le livre sort à peine en librairie – des lecteurs.
Que ce début un peu désinvolte ne trompe personne, et surtout pas ces lecteurs à venir. Le jeu cache une gravité, et même un nœud de gravité, perceptible dans la tension des premières pages, puis serré plus fort à mesure que le récit se déploie, s’ordonne en une étrange figure – le mot « improbable », qu’il faut bannir de nos vocabulaires, s’imposerait presque. Car ces éléments disparates qu’Hélène Lenoir a assemblés, qu’elle a élevés à la dignité du roman, sont ceux qui se retrouvent dans le désordre, dans les drames, énormes ou minuscules, de chacune de nos vies. Pas d’héroïsme, pas de grands ou nobles sentiments. Pas d’emphase. Mais la multitude émiettée, incohérente, à la fois comique et d’une noirceur sans bornes, des malaises et des contrariétés de l’existence la plus commune. Les unes et les autres mélangées sans hiérarchie. En cette matière, le réalisme d’Hélène Lenoir est sans défaut.
Une jeune femme, Thérèse, journaliste d’occasion, arrive dans une ville non nommée – d’Autriche croit-on comprendre vers la fin du livre –, où l’on parle une autre langue. Envoyée par Sylvain, amant et patron, elle doit interviewer l’« immense » et très rare Will Jung, artiste de grande notoriété, que l’on dirait tout droit sorti d’un roman de Houellebecq. Dora devait l’accueillir et l’introduire auprès de la vedette, mais elle a ses propres problèmes… D’emblée rien ne marche comme prévu. C’est le week-end, il fait chaud. Un drame s’est produit « avant-hier »: une femme tchétchène s’est noyée dans le fleuve, cette « bonne grosse rivière ennuyeuse et tranquille » soudain gonflée par les orages des derniers jours, en voulant sauver sa petite fille de « sept ou huit mois ». Le corps de la mère a été retrouvé, « ici, en ville, près du pont Radetzky ». Les journaux ne parlent que de ça, toutes les conversations dans les cafés, les taxis, y ramènent. C’est dans un café justement que Thérèse fait la connaissance de Karl Ritter, « quinquagénaire fatigué », vaguement nostalgique des charmes féminins… Mais il se méfie, se renferme. Un lien chaotique s’établit, hésitant, fait de maladresses et de brusqueries. En toile de fond, le passé, les souvenirs, souvent mauvais et douloureux, des deux protagonistes. Rien ne va de soi. Le naturel ne semble pas de ce monde…
Inutile d’en dire davantage, car le récit accumule une foule de détails, tous parfaitement vraisemblables – ces éléments aléatoires cités plus haut. Tout prend ou fait sens, du vol d’un avion aux malentendus répétés, accumulés, de toute relation amoureuse ou érotique. Cela se produit en des temps et en des lieux dûment précisés et décrits, « comme si c’était il y a des semaines ou des années et à la fois maintenant ». Une tension dramatique s’installe peu à peu, dont on ne peut déterminer précisément les données.
Le grand art d’Hélène Lenoir, qu’il faut saluer comme étant arrivé, ici, par rapport aux livres précédents à une sorte de plénitude complexe, presque magique, s’exprime en une double et complémentaire direction. Formelle d’abord, par la grâce d’une écriture qui entrelace style direct et indirect, souvent dans une même phrase. L’auteur ordonne, avec une perfection funambulesque qui donne le vertige, une narration à la fois éclatée et supérieurement cohérente. De contenu ensuite, avec une empathie et une connaissance immédiates pour les personnages, envisagés moins comme profils psychologiques, que comme figures de nos drames intimes, de nos invisibles et perpétuels tourments.
Norbert Czarny, La Quinzaine littéraire, 16 février 2013
Le lieu : une petite ville du sud de l’Allemagne, non loin de l’Autriche. Le moment : un week-end de juillet, particulièrement chaud ; Voilà au moins deux repères pour situer La Crue de juillet, le nouveau roman d’Hélène Lenoir. On s’interrogera jusqu’aux dernières pages sur cette crue, qui n’est pas seulement celle des eaux d’un fleuve capricieux.
Elle l’est toutefois pour commencer, quand Thérèse arrive dans la ville pour rencontrer Will Jung, un « immense » artiste, peintre âgé qui n’ouvre guère sa porte aux étrangers. Elle doit l’interroger, réaliser un reportage sur son œuvre et sur lui. Elle arrive en taxi en longeant le fleuve, dont la crue brutale vient de provoquer un drame : Madina S., une jeune femme d’origine tchétchène, vient de mourir noyée, ainsi que l’un de ses enfants tombé à l’eau et qu’elle essayait de sauver. Le fait divers a bouleversé la population locale et l’on ne cesse de parler de ces corps flottants dans les eaux agitées, descendant le fleuve sur de nombreux kilomètres.
Entre-temps, le soleil de juillet est revenu et c’est dans la canicule que se déroule le séjour de la jeune femme. Elle ne parle pas allemand, a du mal à se débrouiller, d’autant que son amie Dora, qui lui prête son appartement et devait l’accueillir, n’est pas là et est difficile à joindre par téléphone. Puis, assez vite, la rencontre qu’elle avait longuement préparée devient improbable, et impossible. Elle doit alors passer un long week-end dans ce lieu aimable mais sans agrément particulier, sinon la fondation dédiée au peintre, qu’elle ne visitera pas, et un concert qui permettra à la société locale de se retrouver.
Une rencontre change tout : Thérèse sent « presque violement le regard » de Karl Ritter sur elle. Il est assis près d’elle, à une table de restaurant. Il s’approche et ils font connaissance. La suite, ce samedi et ce dimanche passés non loin de Salzbourg où elle pourrait prendre son train pour rentrer à Paris, nous laisserons aux lecteurs le soin de la découvrir en détail. On s’y laisse prendre, on s’y reconnaît, en tant que proie du sentiment, comme l’héroïne d’Hélène Lenoir : « si je le touche, il tombe » se dit Thérèse au milieu du roman. Lui craint plus que tout « l’horreur partagée d’un dimanche qui s’annonçait torride ».
Entre Thérèse et Karl Ritter, le lien est en effet vite tissé. Il a cinquante-trois ans, c’est un homme élégant, bien installé, ayant acquis une certaine réputation comme architecte restaurateur, mais pas seulement. Sa mère est considérée comme une folle, lui-même rendrait les femmes folles, et Hella, son ex-compagne, l’était assez pour qu’il ait peur d’elle, comme des autres femmes désormais. Cette peur sera l’un des moteurs de la relation avec Thérèse. Il préfère se comporter en « solitaire, grincheux et fatigué », mène une « vie d’homme traqué » passant son temps à faire des réussites ; il bat et rebat des cartes. Elle est plus jeune que lui, son statut est des plus précaire. Elle semble vivre (habiter serait plus juste) chez un homme qui la « paie en nature ». Pour être précis, il l’envoie en reportage sans la rémunérer, considérant sans doute son hébergement comme un paiement. Bref, elle manque de ressources et les heures qu’elle passe dans la ville étrangère lui coûtent plus cher qu’elles ne lui rapporteront. Rester une nuit supplémentaire ne lui est pas possible, et pourtant, quand elle doit quitter le logement que lui a prêté Dora, c’est nécessaire.
L’instabilité de Thérèse n’est pas que matérielle. Elle est attirée par Ritter, autant par son charme, la solidité qu’il incarne, que par sa fragilité. Dans une belle scène nocturne, le samedi soir, elle s’accroche à lui, et l’on se figure certains plans de Bergman, un fond de parc en été, la fulgurance des émotions, leur vanité soudaine et une scène presque triviale, qui se termine par une fuite éperdue. « Lass mich in Ruh », lance-t-il en s’éloignant. « Laisse-moi tranquille » : l’expression reviendra comme un leitmotiv au fil de ce roman qu’on entend, et qu’on voit, comme toujours chez la romancière. Entre le travelling d’arrivée dans la ville, le taxi longeant le cours du fleuve, et le moment de la rencontre, plan fixe sur la jeune femme vue par Ritter, comme on en avait dans Son nom d’avant, on est sensible à ce souci du cadre, et à celui de la bande-son qui accompagne les images. Elle est multiple, parfois confuse, à l’image de ces êtres qui ne savent pas, qui cherchent, qui veulent et ne veulent pas : monologues, phrases interrompues, échanges parfois directs, souvent en sous-conversation, on est pris dans cette trame sonore qui, par certains côtés, s’apparente à du marivaudage. Certes, pas à celui du dramaturge qui lui a donné son nom, mais à celui qui naît de l’incertitude qui pèse sur nos vies. Faut-il se livrer à l’autre ? Et jusqu’à quel point sans en devenir la dupe ? La relation que Dora, l’amie qui l’héberge, entretien avec « son Dragan » fait écho à celle que vivent Karl et Thérèse, le temps d’un week-end. Et on pourrait s’interroger sur le lien qui unit Jung à Yvonne, son épouse et Cerbère, les deux fonctions n’allant pas l’une sans l’autre.
Communiquer. Ca ne va jamais de soi dans les romans d’Hélène Lenoir. Cela ne fonctionne jamais comme on le voudrait et la technique joue son rôle dans l’échec. On ne compte pas les téléphones qui fonctionnent mal, les répondeurs qui parlent dans le vide, les messages qui n’arrivent jamais à leur destinataire. On ne décroche pas, on masque son nom… C’était le cas dans Pièce rapportée, sur un mode dramatique, c’est le cas dans ce roman plus léger, presque une comédie sentimentale. Et à ces objets qui ne remplissent pas leur fonction font écho les phrases torrentielles, mêlant pensées multiples et faits, brassant comme le fleuve les eaux tourmentées des sentiments. On se laisse emporter, sans jamais se perdre ; l’écriture d’Hélène Lenoir est toujours maîtrisée sous le dehors de la confusion, de l’excès.
À la fin du roman, la narratrice procède par séquences brèves, champ/contrechamp sur Karl et Thérèse, tandis que se déroule le concert, ses bis, ses applaudissements. Elle est dans la salle, sinon dans l’écoute de la musique ; il est chez lui, puis en chemin. Le rythme se fait haletant ; on attend l’issue.
Le mot « chaleur » clôt le roman. Ce n’est pas vraiment un hasard.
Claire Devarrieux, Libération, 4 avril 2013
Va et Vienne - Corps noyés et rencontre amoureuse dans un roman autour du Ring d’Hélène Lenoir
La mort et l’amour se télescopent dans La Crue de juillet, comme dans un roman de Marguerite Duras, période Moderato cantabile. D’ailleurs, il est dix heures et demie du soir en été, à la fin du nouveau livre d’Hélène Lenoir, lorsque le personnage masculin Karl Ritter évolue encore en amont de l’instant décisif. Il est chez lui, il descend acheter de quoi dîner un peu. Pendant ce temps, la femme qu’il a rencontrée la veille au soir, Thérèse, assiste à un concert grâce à l’invitation qu’il lui a donnée. La rejoindra-t-il ? Est-il encore temps ?
Chaleur. Un homme et une femme, vingt-quatre heures dans leur vie, à Vienne (si on considère qu’un «pont Radetsky» et un «Ring» sont des indices suffisants pour identifier cette ville provinciale qui parle allemand). Les thèmes habituels d’Hélène Lenoir sont en suspens, dissimulés dans le passé de Karl Ritter et de Thérèse. Il est séparé d’une épouse très folle qui lui veut du mal. Thérèse travaille pour un homme tyrannique, pervers, qui la défraie à peine pour ce déplacement. Thérèse est venue interviewer un peintre célèbre, âgé et rare, rendez-vous que lui a garanti une de ses amies, laquelle la loge de surcroît, mais ne sera pas aussi fiable que prévu.
Il n’était pas prévu non plus qu’il fasse si beau. La chaleur repeuple les parcs. Il y a du monde aux terrasses, les corps se détendent, les regards s’attardent, les tenues sont légères. Mais l’été n’efface pas la rumeur entêtante du fait divers. Une mère de famille, une réfugiée tchétchène, s’est jetée dans le fleuve en crue où venait de tomber la poussette de son bébé, qu’elle n’a pas pu sauver. La mère et le bébé sont morts noyés. On a retrouvé les corps à dix kilomètres l’un de l’autre. Photos et gros titres dans les journaux maintiennent la présence du drame dans l’espace où s’esquisse l’attraction amoureuse.
Nous entrons dans cette histoire en compagnie du personnage féminin. Thérèse est française, jolie, assez jeune. Elle fume avec naturel, ce qui nous la rend vaguement surannée. Elle est entreprenante, se méprend sur le désir de ce quinquagénaire séduisant dont elle a décidé de partager le dîner. Elle se fait rembarrer. La nuit, et le premier chapitre, se terminent sur une volée de mots grossiers dont la lecture étonne.
Bribes. Les pensées du personnage masculin prennent bientôt le relais. Karl Ritter conjure l’angoisse en multipliant les réussites sur son ordinateur. Il filtre les irruptions du monde extérieur au moyen de son répondeur téléphonique. Nous en savons davantage sur lui que sur Thérèse. Il a grandi à Lausanne, la langue française est celle de son enfance. Sa mère a disparu dans des circonstances qu’on ne comprend pas bien. Il est fils d’architecte. Lui-même se contente de réaménagements, métaphore de sa vie, peut-être : «Je ne construis pas, moi. Je retape, je bricole, j’essaie de freiner le délabrement.»
Les bribes de monologues intérieurs, les dialogues effilochés, contrastent avec la précision dans la description des attitudes et de l’environnement. Les personnages trébuchent sur leurs sentiments. Thérèse ne sait plus comment s’approcher davantage. Karl Ritter est «totalement dépassé». Alors, drôle de porte-parole surgi de nulle part pour commenter l’intrigue, un jeune employé d’hôtel «fait signe à Ritter, avec mimiques et gestes très expressifs, d’y aller, de se remuer, vite, c’est pas vrai, quoi !»
Du même auteur
- La Brisure, 1994
- Bourrasque, 1995
- Elle va partir, 1996
- Son nom d'avant, 1998
- Le Magot de Momm, 2001
- Le Répit, 2003
- L’Entracte, 2005
- La Folie Silaz, 2008
- Pièce rapportée, 2011
- La Crue de juillet, 2013
Poche « Double »
Livres numériques
- Pièce rapportée
- Bourrasque
- Elle va partir
- L'Entracte
- L’Entracte
- La Brisure
- La Crue de juillet
- La Folie Silaz
- Le Magot de Momm
- Le Répit
- Son nom d'avant
