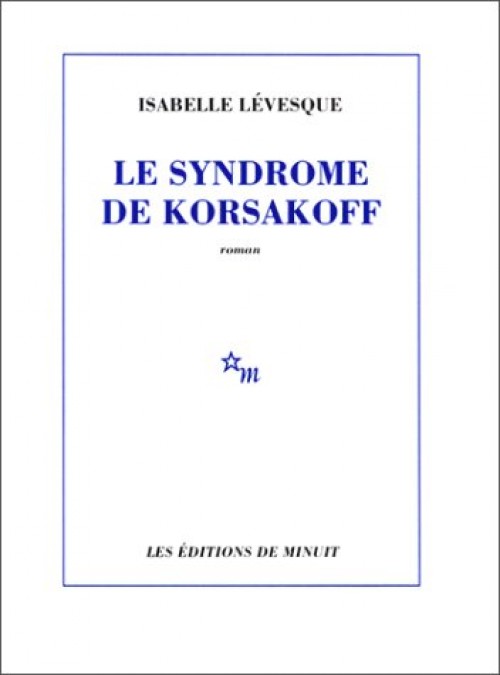
Isabelle Lévesque
Le Syndrome de Korsakoff
1994
128 pages
ISBN : 9782707314727
10.65 €
30 exemplaires numérotés sur Velin des papeteries de Vizille
Il y aurait Duc, veilleur, les nuits impaires, à l’usine laitière, et le jour, grand voyageur des trains de banlieue.
Il y aurait une vieille femme aux chaussures d’homme et au foulard léopard.
Il y aurait Korsakoff, pas Rimsky, le syndrome, qui laminerait la mémoire de Duc.
La vieille femme écrirait donc l’histoire de Duc, qui le fuirait, jour après jour.
Jean-Claude Lebrun (L’Humanité, 3 juin 1994)
Un homme appelé Duc, veilleur de nuit, apprend un jour qu'il est atteint d'un mal irréversible, qui va s'attaquer à sa mémoire et progressivement l'effacer. Celle du passé proche d'abord, puis celle de temps de plus en plus anciens. Jusqu'à ce que tout s'évanouisse au moment de franchir à nouveau, mais en sens inverse, le cap de la naissance...
Le Syndrome de Korsakoff, premier roman d'lsabelle Lévesque, s'attaque à un sujet délicat, guetté par la sensiblerie, et même le mélo, pour peu que la compassion se fasse trop lourdement envahissante. On n'en est que plus impressionné par la maîtrise d'écriture et le sens de l'économie du texte dont elle sait faire preuve. Sans compter sa capacité à surprendre in fine le lecteur, en lui ouvrant dans les dernière lignes une piste complètement inattendue. En deux ans, la maladie est venue à bout de Duc. Une vieille femme, qui était devenue son amie dans des circonstances assez rocambolesques, finit tout juste de mettre de l'ordre dans ses papiers ; un soir, dans une banlieue, Duc avait suivi une inconnue qui l'avait accueilli chez elle, il était ensuite régulièrement revenu chez elle, pour gagner sa course de vitesse contre le blanc de la mémoire. La vieille dame avait en effet accepté de noter, après chaque visite qu'il lui faisait, les récits de temps dont le souvenir allait se délitant. La chronique qu'elle en tiendrait ferait ainsi pièce à la perte annoncée et permettrait de le “ découvrir dans son intégrité, celle d'avant la maladie ”. Durant ces deux années, la confidente d'un genre un peu particulier va donc consigner par écrit ce qui permettra de reconstituer une histoire, de laquelle Duc s'absente lui-même de plus en plus. Sur la fin, elle devra se déplacer jusqu'à un établissement hospitalier ; Duc, s'étant acheminé “ doucement dans l'innocence vers le temps de la naissance ”. Au bout de son itinéraire régressif, il y attendait sa mort prochaine... On pense d'abord, lisant ce petit récit qui donne force d'évidence au bizarre, avec cette curieuse maladie qui fait repartir Duc en un sens inverse, aux fables minimalistes, mais chargées d'une symbolique complexe, de Marie Redonnet. D'autant qu'on avait pu apprendre au passage que Duc avait rêvé... d'écrire un livre : “ Raconter une histoire, ce n'était pas ce qu'il voulait faire. Longtemps, il n'avait voulu écrire qu'un livre vital : un livre qui aide à vivre ”. De même avait-on vu Duc dans un train de banlieue régulièrement stationné au même arrêt, qui fixait à chaque fois le même détail du paysage et se retrouvait empêché de jamais voir davantage parce que le train déjà repartait. Isabelle Lévesque paraît aimer ouvrir de telles pistes, qui ne sont pas non plus sans rappeler la façon qu'avait le Nouveau Roman de loger ses énigmes au cœur des choses vues.
La vieille dame, qui fait aussi fonction de narratrice, s'était donc retrouvée veillant sur un “ petit garçon d'un mètre quatre vingt-huit ”, dont la défaillance de mémoire rendait le comportement de plus en plus incohérent. Si bien qu'un jour, alors qu'il en était déjà revenu au stade du garçonnet, il s'en était allé main dans la main avec une fillette rencontrée dans un jardin public. On les avait retrouvés, au matin suivant, endormis dans un wagon du train qu'il avait accoutumé de prendre pour se rendre chez la patiente conservatrice de sa mémoire (“ Les souvenirs récents, ces dernières années, ces derniers mois, hier, là était en œuvre la déliquescence. Aussi Duc édifiait-il autour d'eux en priorité les fortifications de la parole. Me les racontant, il me faisait leur sentinelle ”). Duc se rapprochait à chaque fois un peu plus de sa fin, qui adviendrait quand la bobine de la vie serait revenue à son point initial, la naissance. Alors qu'aujourd'hui son amie évoque la marche à rebours de ce moi qui s'efface selon un irrémissible processus de déconstruction, elle porte aussi sur l'univers ambiant le regard dont il n'était plus capable, parce que trop requis par la mort lente en lui. Elle place par exemple à côté de lui dans le train des jeunes gens qui manifestent certains symptômes des maux du temps : “ Les filles et les garçons dans le compartiment paraissent légers et crânes et pourtant graves d'une inquiétude lourde d'adulte. Ils vont bridés dans des peurs qu'il n'a jamais connues, nourries chaque jours des gros titres alentour. Ils ont des estafilades bien nettes aux genoux de leurs jeans et des lunettes noires à leurs regards sans soleil, et peu de mots, qui servent à tout dire. ”
Ici le syndrome régressif de Korsakoff, là une dégradation et un appauvrissement de la parole : et si Duc ne faisait qu'anticiper un mouvement plus général ? Ce sont de réels motifs d'inquiétude que pointe aussi, mine de rien, ce premier livre soigneusement concerté. Car Isabelle Lévesque sait ménager ses effets, ainsi qu'en témoigne une dernière page intitulée “ Note de l'auteur ”, dont il faut laisser l'entière surprise au lecteur. Si celle-ci n'invalide certainement pas le sens du livre, elle en déplace en effet l'éclairage, le chargeant d'une émotion plus intense encore. Cette “ petite histoire mal ficelée, pleine de soubresauts et d'incohérences ” (petit clin d'œil en direction de Faulkner ?) de celui qui la nuit au début significativement veillait, ne se présente alors plus comme la chronique d'un mal incurable, mais comme une anticipation de la dissolution de la mémoire et de l'être, en vertu d'un retournement qu'il faut avouer empreint d'une diabolique habileté. Là encore Isabelle Lévesque laisse percer son talent. De sorte qu'au bout du compte Duc, qui semblait avoir atteint le terme logique de sa régression, et la veille dame, qui s'était présentée comme en tenant le récit, peuvent désormais apparaître dans une tout autre posture. Ce qui se profile comme rempart à toutes les possibles déperditions n'est rien moins maintenant que le travail d'invention littéraire lui-même. À cet égard la relative minceur du livre d'Isabelle Lévesque n'est pas celle d'un dénuement mais bien plutôt celle d'une économie des effets, qui donne à son livre sa densité et son nerf. De la même façon que son découpage en vingt-quatre séquences aux titres volontairement hétéroclites (“ Pas l'amorce d'un texte ”, “ Dans le train ”, “ Une épicerie ”, “ La passerelle ”, “ Rêves ”....), mises bout à bout comme les vingt-quatre images par seconde du cinéma, débouche sur une œuvre produisant un extraordinaire effet de réalité. On s'aperçoit que rien décidément ici ne peut relever de la gratuité. C'est dire combien, dans la vague plutôt réjouissante des premiers romans parus ces derniers mois, Le Syndrome de Korsakoff tient une place remarquable. Prouvant une nouvelle fois que la fertilité du sens peut se retrouver dans des modes d'écriture très divers, du baroque le plus extravagant jusqu'à la sobriété la plus extrême, à la condition qu'il en surgisse un regard inédit, surprenant et en quelque façon innovant, sur la réalité des choses.
Jean-Pierre Tison (Lire, avril 1994)
Écrire pour retenir ce qui s'enfuit : de cette volonté commune à beaucoup d'écrivains Isabelle Lévesque tire une histoire qui fait penser au trio Ripolin des anciennes réclames où chacun peint sur le dos de l'autre. La jeune romancière imagine un auteur. À son tour cet auteur imagine un jeune veilleur de nuit, Duc, qui est atteint d'une forme d'amnésie – le syndrome de Korsakoff – et qui demande à une vieille dame de fixer par écrit sa propre histoire avant qu'elle ne s'efface tout à fait.
La vieille dame note que Duc enviait Faulkner d'avoir écrit Tandis que j'agonise à trente-deux ans, en six semaines, pendant son emploi de nuit. alors que lui-même, Duc, “ n’était pas sûr d'être capable de raconter une histoire, avec un début et une fin. et au milieu quelque intrigue ficelée comme un rôti qui tienne le lecteur en joyeux appétit ”.
Isabelle Lévesque en est capable elle, et elle le prouve comme par jeu en conduisant son histoire, de manière mystérieuse, jusqu'à une de ces affaires de rapt d'enfant qui affriolent la presse spécialisée et font saliver les mégères.
Livre très maîtrisé, Le Syndrome de Korsakoff s'inscrit bien dans la vie, la “ vraie vie ” avec de rapides mais pénétrants portraits. Celui d'une jeune femme en particulier, Marie, qui a “ un penchant pour la passion ” et “ sort intouchée du pathos grâce à son sens du comique ”. Il y a aussi des croquis mordants où se révèle le décalage entre les gens qui font pitié et ceux qui ont pitié. Le gouffre qui sépare des créatures balzaciennes de l'univers dostoïevskien.
En dépit d'une construction qui veut protéger la pudeur de façon trop appuyée ou de la présence d'un vilain mot – désamour –, ce premier roman est convaincant. Il rappelle que, même sans la menace d'une quelconque affection neurologique, L’oubli talonne tout vivant. Et le rattrape souvent. D'où l'urgente nécessité d’écrire. Faire de ce plaisir un devoir.
