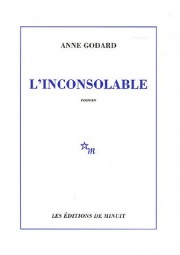
Anne Godard
L'Inconsolable
Grand Prix RTL/LIRE 2006.
2006
160 p.
ISBN : 9782707319401
13.70 €
25 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille,
* Réédition dans la collection de poche double
Ecoutez la rencontre avec Anne Godard à la librairie Mollat (Bordeaux le 23 mars 2006)
Tu n'aurais jamais cru que tu survivrais, mais tu vis pourtant, tu continues, de date en date, et depuis si longtemps. Tu vis contre son absence, contre la vie qui l'a permise, contre les autres, parce qu'ils oublient, et contre toi, qui ne peux rien effacer.
Malgré toi, tu restes en attente d'autre chose, mais quoi ?
ISBN
PDF : 9782707338341
ePub : 9782707338334
Prix : 6.49 €
En savoir plus
Jean-Maurice de Montremy, Livres Hebdo, vendredi 25 novembre 2005
Une femme s'est fixé la date anniversaire de son existence : celle de la mort de son fils. Magnifiquement inconsolable. Mais il y a des ruses, même dans le sublime.
Ses enfants la surnomment mater dolorosa. Depuis la mort de son fils aîné, le deuil lui est dû comme le droit fondateur de son existence. Elle est la femme en deuil. Tout doit s"ordonner autour du jour à jamais fixé. Tout se concentre autour de la chambre au fond du couloir, là où elle a trouvé son fils mort, à son piano - l’insaisissable, touchant et tempétueux adolescent.
Cela, le lecteur de ce premier roman d’Anne Godard ne le sait pas tout de suite. Le récit commence, en effet, par l’attente. La femme est seule. Les enfants ne vivent plus à la maison, le mari – un musicien manqué – a changé de vie. Elle attend le coup de téléphone. Elle attend les signes de compassion qu’elle exige de ses proches, selon des procédures complexes, puisqu’il ne faut pas que cela ressemble à de la compassion. Bref, elle attend que le monde tourne autour d’elle. Car c’est le jour, celui de la mort du fils, voici plus de vingt ans. Malheureusement, elle est bien la seule à célébrer ce culte dont les fidèles finissent par se lasser.
Tu te dis que tu as beaucoup souffert, d’habitude cela suffit, tu n’as pas besoin de penser plus concrètement. Au monologue intérieur, Anne Godard a préféré l’emploi de la seconde personne, tu. Cela peut, au début, sembler affecté. Mais on en est vite convaincu : c’est le meilleur choix.
Parlant à la première personne, la femme en deuil ne pourrait pas trahir certain signes de sa complexité intérieure, puisqu’elle est, à sa façon, une grande menteuse. A la troisième personne, le narrateur paraîtrait imposer sa grille au personnage : la femme en deuil ne serait plus qu’un cas . Avec la deuxième personne, il y a du je , il y a déjà du elle et l’indicible se glisse par cette demi-proximité, confidence mi-consentie, mi-extorquée.
Derrière la douleur, derrière le ressentiment contre les vivants – notamment contres les autres enfants –, le lecteur découvre, en effet, un nœud de vipères familial, une maison, des souvenirs, des grandes espérances, de non moins grandes illusions perdues et le besoin farouche de maintenir les chimères – dont la musique et le fils mort. On s’aperçoit aussi que la mort du fils est un chaudron de sorcière. Un suicide dont les causes sont le tissu même du récit, avec ses masques et son enfermement.
Ton fils s’est tué sans un mot, toi, tu te vengeras du silence du mort, par les mots que tu laisseras aux vivants. On approche du secret de la femme en deuil, mais on n’en brisera heureusement pas le mystère. Cette redoutable manipulation de la deuxième personne suffit à montrer que l’indicible est parfois ce qui s’impose le plus évidemment sans mots. Et l’on saluera l’écriture très accomplie à la fois puissante, précise et insinuante d’Anne Godard.
Nathalie Crom, La Croix, jeudi 2 février 2006
Mon fils, ma chère douleur
C’est à Thomas Bernhard, l’imprécateur, que ce roman emprunte, en guise d’épigraphe, ces quelques mots issus de Gel : Les liens de sang peuvent devenir subitement irréparables. Phrase énigmatique, lorsque la voici jetée seule sur la page blanche, au seuil d’une lecture qu’elle devrait annoncer, éclairer, préparer. Ce qu’elle fait, à plus d’un titre, mais on ne s’en rendra compte qu’ultérieurement, après quelques pages, quand, de l’écheveau des phrases, calmement posées sur le papier, émergeront une histoire, des personnages. Entre eux, des silences, de l’amour, de la haine. De l’enfance et de la mort. Du tragique. Entre eux, des liens de sang. Irréparables.
La figure centrale de L’Inconsolable, celle que désigne le titre même de ce premier roman d’Anne Godard – premier roman saisissant d’ambiguïté et de profondeur, d’une rare maîtrise formelle, d’une rare maturité –, est une femme. Elle est seule, dans une chambre, assise au bord du lit, lorsque s’ouvre le livre. Dehors, il fait encore jour, l’après-midi touche à sa fin, peut-être est-ce l’été, mais la pièce est plongée dans l’ombre et le silence, persiennes et porte closes. La femme attend.
Ce jour est un jour particulier, un anniversaire. Un jour tel que celui-ci, le téléphone devrait sonner, mais non, les heures passent et il reste muet. La date. Ils n’y ont pas vraiment songé Ce soir, ils sont pleins d’amnésie, mais demain ? Demain, ils se souviendront peut-être et ils s’en voudront de ne pas y avoir pensé à temps. Mais ils n’appelleront pas demain, parce que c’est le jour précis, n’est-ce pas, qui ne doit pas être oublié.
Ce jour, il y a des années de cela, la femme a perdu son fils aîné, mort alors qu’il était adolescent. Le voilà, l’anniversaire – la voilà, l’impossible consolation. Tu as la nostalgie de ces périodes anciennes où tu étais mieux célébrée dans le souvenir de ta perte. Car c’est une perte dont tout le monde admet qu’une mère ne puisse jamais se consoler. Tu es consciente de ta précellence, tu as su l’exploiter tout de suite. A la date anniversaire, pendant des années, tu as reçu des fleurs, toujours des lys blancs (…) Les lys blancs pour le jour de la mort, les lys blancs pour le jour du silence…
Inutile d’y voir une énigme à résoudre : on ne saura jamais qui parle, qui s’adresse ainsi à la femme, au moyen de ce tu répétitif, obsédant, entêtant, accusateur – L’Inconsolable est un long monologue sans narrateur.
Tu te souviens. L’intensité la plus grande jamais vécue, au-delà de toute sensation. Quelque chose qui serait la fin de toute pensée, la fin aussi de toute responsabilité. Un arrachement qui te sépare de toi-même. Horreur absolue et volupté de cette horreur. Ton enfant encore dans tes bras et déjà hors de toute atteinte. Et toi splendide, vaincue, grandiose, et seule… Dans la bouche de qui, ces mots effarants, scandaleux, presque intolérables ? Personne. Nul ne connaît jamais un être de telle intime façon, auscultant avec tant de finesse et d’assurance ses pensées, ses chagrins, ses perversités secrètes surtout, mettant tout cela en mots avec calme et netteté – avec un souci de vérité poussé à extrême, quelque chose comme une probité effrayante à force d’être radicale, quelque chose aussi comme une colère froide autant qu’exaspérée.
Son enfant mort, la femme s’est repliée sur sa douleur, sur son impossible deuil. Elle a congédié le monde : Des autres, tu ne pourras bientôt plus rien dire, ils seront fondus dans le brouillard, figurants dont la présence ne sert qu’à faire masse autour de toi, tandis que tu as un pouvoir nouveau, le pouvoir exorbitant, enivrant, de dire personne ne peut comprendre. Tu feras sentir à tous quel écart te sépare désormais de l’humanité.
Peu à peu, au fil du monologue à elle adressé, se dessine le portrait de cette femme douloureuse et égocentrique, abîmée et manipulatrice, possessive et pétrie de culpabilité. Portrait à charge, violent, excessif, et souvent dérangeant, d’une mater dolorosa – ainsi l’appellent ses enfants, les deux filles et le cadet – appliquée à ériger sa propre statue, à endosser le rôle de l’héroïne tragique, sorte de figure homérique de la maternité, dépositaire stoïque d’une souffrance qu’elle berce et choie et protège.
Une souffrance équivoque, désirée, source de fierté, une souffrance à nulle autre comparable, à jamais impossible à partager –fût-ce avec un mari, qui s’efface peu à peu, fût-ce avec des enfants qui choisiront de partir, de quitter cette cellule familiale devenue froide et silencieuse comme un tombeau.
Ainsi, dans la maison, ne demeure bientôt que la mère, en tête-à-tête avec l’adolescent mort – la chambre intacte, les photographies, les carnets de notes, le piano où le garçon, intelligent, vif, singulier, faisait ses gammes. Mais les souvenirs trop parfaits, la complicité posthume ne résisteront pas à ce huis clos. D’autres bribes de mémoire referont surface, fragments de passé torturés ceux-là, pleins d’indécision, de confusion et de vacarme.
Des images et des histoires où s’emmêlent désormais l’enfance de la mère et celle du fils, où se brouille et s’échappe le souvenir de ce dernier – comme sur cette photographie très ancienne où, sur le visage de l’enfant qu’il était, tellement petit encore, se lit un désarroi que la mère, alors, n’avait pas su voir, une détresse qu’elle n’a déchiffrée que bien plus tard, après qu’il fut mort – quand il était trop tard.
Sophie Avon, Sud-Ouest-Dimanche, 19 février 2006
La chambre du fils.
Anne Godard. L’Inconsolable est son premier roman. Sur le deuil d’un fils, récit implacable et terrible de la souffrance d’une mère.
C’est un roman qui aurait pu s’appeler la Tempête . Du nom de cette sonate de Beethoven que le fils jouait et rejouait avec obsession. C’est un roman dur et minéral, un récit de la souffrance limite et, en creux, le portrait d’une mère que la douleur conduit à la déshumanisation. D’ailleurs, elle rêve de mourir de la maladie de Niobé, cette pathologie où le corps se transforme en pierre. Elle a perdu son fils aîné, et, comme le titre le dit, en demeure inconsolable. Rien ne la sauve de l’autodestruction où elle se jette pour ne pas oublier. Ni son mari qui la quitte de guerre lasse, ni ses autres enfants qu’elle se met à haïr, ni le moindre secours de l’extérieur ne peuvent entamer la violence muette où elle sombre. Inconsolable elle est ; inconsolable elle se décrète. Statue de ressentiment, stèle de souffrance érigée à la mémoire de son cher défunt. Pourtant, c’est encore avec jalousie que tu te représentes le pire. Tu pressens que, si l’un des tiens perdait un enfant, il se réclamerait sur-le-champ de son malheur tout neuf pour reléguer le tien dans les limbes d’un temps révolu. Et cependant, tu ne peux t’empêcher de jouer avec cette idée ; elle rend ton deuil fragile et précieux comme un bijou ancien et elle te divertit de l’ennui qui t’envahit dès que tu souffres moins.
En 156 pages d’une implacable densité, Anne Godard fait entrer le lecteur dans cette glaciation de l’âme où une figure de mère se métamorphose en Médée potentielle. Ce n’est pas ici qu’on trouvera la complainte et la douceur de certains deuils. Cette femme-là, qui parle en se tutoyant, est de la trempe des héroïnes tragiques. Autocentrée jusqu’à la névrose, ensevelie vivante dans le caveau de sa douleur, elle n’est dupe de rien et ne s’apitoie que pour mieux se châtier. Tu as aimé sa mort tout de suite, tu t’y es sentie bien, comme si c’était enfin ta place, enfin le rôle qui t’attendait. Tu as aimé sa mort, qui te le donnait tout entier, plus que tu n’aurais jamais pu aimer sa vie. Il l’a su, dans son coma, il a su que tu voulais qu’il meure, il a su qu’il devait mourir pour que toi, sa mère, tu puisses le pleurer toujours.
Descente aux enfers. Rarement, un texte sur le deuil n’aura été aussi loin dans la noirceur, dans la lucidité, dans l’ambiguïté du chagrin, dans la faculté de montrer le ravage de la perte qui auréole et détruit dans le même mouvement. Avec une langue sèche, précise, avançant un scalpel à la main, Anne Godard descend toutes les marches du tombeau comme si, derrière son personnage, plus rien ne pouvait rester en vie. C’est une descente aux enfers qui n’autorise aucune respiration dans son dos, une condamnation personnelle qui se nourrit d’une éradication générale. Il faut un courage de guerrière et le talent d’un écrivain accompli pour se défaire à ce point du désir d’apitoyer, pour renoncer aux larmes, et foncer dans les ténèbres du sentiment maternel, celui de la possession absolue. Tu voudrais voir tes enfants le jour où ils découvriront que ta mort n’est pas une disparition, pas une libération, mais l’inscription en eux de ton emprise.
Maurice Mourier, La Quinzaine littéraire, 1er mars 2006
L’Inconsolable est le titre d’un poème étonnamment prosaïque que Raymond Roussel composa à titre d’exercice de prospection littéraire après l’échec cruel de La Doublure, son premier livre (en vers), publié le 10 juin 1897. On peut lire aujourd’hui ces quelques vues du carnaval de Nice dans Comment j’ai écrit certains de mes livres. La géante du défilé festif, dont la description, d’une maniaque précision, constitue la première de ces vues , représente, avec l’outrance carnavalesque de rigueur, une Veuve inconsolable dont l’ostentation de désespoir ( elle pleure/A faire déborder trois cuvettes à l’heure ), censée provoquer le rire, suscite plutôt cette légère angoisse si familière au lecteur de Roussel, dont la plupart des œuvres mettent en scène, avec un humour noir inquiétant, toutes sortes d’horreurs.
Anne Godard a-t-elle rédigé son étrange (et à bien des égards saisissant) roman en forme de clin d’œil à l’auteur malheureux de Parmi les noirs et autres textes incompris ? Peut-être pas, car l’espèce de journal intime tenu au fil des jours par son unique personnage (les autres se réduisent au statut de comparses n’ayant d’existence que dans son discours) a quelque chose de si placidement sauvage et de si âpre qu’on est tenté – je pense à tort – d’attribuer au moins une part de cette violence à un choc traumatique subi par la narratrice, voire par l’écrivaine elle-même.
N’est-ce pas la plus douloureuse histoire possible, celle d’une femme qui a perdu le seul fils qu’elle ait aimé, et qu’un inconsolable et presque inconcevable deuil force à faire peu à peu le vide autour d’elle, bannissant de sa maison, ou dégoûtant par l’intensité renouvelée de son chagrin la totalité de ses proches : amis, mari, enfants ayant eu le tort de survivre ? On n’a guère envie de plaisanter avec cela et la pente est forte qui conduirait le lecteur à glisser, de sa condition objective d’amateur de romanesque – unique position tenable pour qui lit une fiction –, à celle de suiveur de corbillard qui, vu ses liens avec le défunt et la maman de celui-ci, compatit sincèrement et y va de son pleur à l’unisson de la pleureuse.
Or ce serait trahir absolument un livre retors, qui n’émeut que pour mieux rendre l’émotion du lecteur suspecte à lui-même, un vrai roman en somme, de vraie et bonne littérature. La perversion intime et fort bien agencée de ce récit qui a toutes les apparences d’une confession édifiante de Mater Dolorosa tient au doute qui peu à peu envahit la lecture. Et si cette femme était un monstre, de méchanceté et d’orgueil, utilisant le drame qui a brisé sa vie pour détruire celle des autres, incapable de tout amour qui ne soit pas dévoration de l’être aimé ? Et si ce fils qui s’est suicidé sans que jamais la litanie gémissante de sa mère s’interroge sur le pourquoi de cet acte définitif, était mort pour échapper en fait à la camisole d’un amour féroce ?
Ou bien : et si cette femme qui s’est murée dans une sorte d’extase du trépas, qui vit entourée de vieilles photos qu’elle finit par briser, obsédée par la musique évanouie que jouait le fils prodige (prodige pour elle seulement), remâchant avec délectation les circonstances rêvées de sa disparition future, heureuse à en crever de désoler ainsi les enfants qui lui restent, leur faisant payer au centuple le scandale d’encore exister après l’élu, si elle était folle à lier, mortifiée, mortifiante, magicienne et sorcière experte en philtres de malheur ?
Le malaise intense que les impeccables mécaniques rousselliennes engendrent, malaise devant le vivant changé en mannequin, la tête de carton d’où coulent de véritables larmes, cette terreur voilée dont le texte de Locus Solus s’entoure comme d’une chape protectrice et glaçante, on les retrouve ici, produits par une écriture bien différente mais presque aussi efficace que celle du suicidé du Grand Hôtel et des Palmes. Ce n’est pas un mince compliment.
Jacques-Pierre Amette, Le Point, 2 mars 2006
La Grande marée du passé
Imaginez une vaste et belle demeure ancienne, avec des persiennes qui forment pénombre à l’intérieur, un jardin avec des platanes, la chaleur de fin de journée, la léthargie. Une femme parle, troublée, désorientée, envoûtée, captive d’un deuil, harcelée par sa mémoire. Elle se souvient d’un monde disparu, du versant ensoleillé de sa vie. Il y avait aussi la visite du médecin, régulière. Cette femme se détruit-elle ou se reconstruit-elle en se souvenant d’un proche qui jouait La tempête de Beethoven, et qui imprègne et imbibe chaque pièce ?
Chaleur étouffante, mémoire étouffante. Mais le passé revient comme une marée, avec son cortège de photos, de scènes nettes dans un couloir, un grenier, une chambre, un escalier. Le livre enfante aussi des sensations et des murmures : terre mouillée, odeurs de cave, couleurs anciennes de vitraux, murs charbon, planches moisies, champignons, photographies, carnets, partitions. La maison devient continent, ruine, lieu profond et spectral. Elle se transforme en nécropole, en terrain archéologique, en sépulcre, en reposoir d’ombres qui incite à la germination mentale baroque. Chaque pièce devient un continent. Ce premier roman révèle un écrivain fiévreux, musical, inspiré, prodigieusement tactile, d’une dignité qui impressionne en ces temps d’édition camelote. Profonde humanité, ton ardent, maîtrisé. Anne Godard est l’une des plus belles découvertes dans l’histoire des Editions de Minuit.
