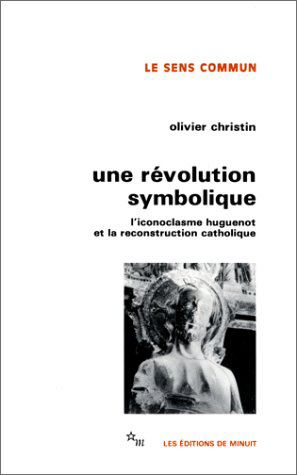
Olivier Christin
Une révolution symbolique
L’iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique
1991
Collection Le sens commun , 336 pages, 16 hors-textes
ISBN : 9782707313911
22.40 €
À partir des années 1530, et pendant près d’un demi-siècle, catholiques et protestants français s’affrontent à propos d’un enjeu en apparence minime, les images saintes. En quelques années, la question de savoir si l’on peut représenter les sujets sacrés, problème théologique complexe mais limité, provoque de brèves escarmouches, menées par des extrémistes des deux bords, puis s’enfle aux dimensions de la guerre civile qui ravage bientôt le royaume. Comment une telle mobilisation des théologiens, des juristes, des artistes mais aussi et surtout des simples fidèles a-t-elle été possible ? C’est seulement en retrouvant dans les ouvrages de controverse, dans les récits d’émeutes, dans les poursuites judiciaires et dans les œuvres d’art, l’enjeu véritable du conflit que l’on peut proposer une réponse et comprendre enfin ceux qui s’entretuèrent pour des images.
‑‑‑‑‑ Table des matières ‑‑‑‑‑
Avant-propos.
I. Le défi
1. La mobilisation iconoclaste : Les avant-gardes – Les formes élémentaires de solidarité – La construction théorique de l’iconoclasme – 1e Le modèle anglais – 2e La découverte des Libri Carolini – Une politique de l’iconoclasme – Naissance d’une vulgate ? – Émeutes et guerres civiles – L’impossible bilan.
2. La révolution religieuse : L’alliance des notables et des classes populaires – Le sac de la cathédrale du Mans – Un iconoclasme officiel ? Conflits, profits – Un acte de rupture – 1e L’idole mise à mort – 2e La réitération du martyre.
3. L’iconoclasme, théologie pratique : Rites d’humiliation et de souillure – La sélectivité des destructions – 1e Le calendrier du sacrilège – 2e Le relief et la couleur – 3e Le choix des sujets.
II. La riposte
1. La recharge sacrale : Le système des réparations – Processions et sermons – Qui châtiera les coupables ? – Massacres – L’assurance du dogme – Division – L’image et l’idole – Les pièges de la vénération.
2. La revanche liturgique et esthétique : Les miracles au secours des images – Une politique artistique dans l’Église ? – Les interventions des théologiens français – Le rappel à l’ordre du clergé – Conseil aux fidèles – La reconstruction : une épreuve.
Conclusion – Annexes : figures, illustrations – Cartes – Sources et bibliographie.
‑‑‑‑‑ Extrait de l’avant-propos ‑‑‑‑‑
Les hommes n’ont pas porté de tout temps le même regard et les mêmes jugements sur les objets et les monuments que nous admirons aujourd’hui : s’il peut sembler illusoire de vouloir reconstruire la perception de l’œuvre d’art qui était celle des chrétiens des XVIe et XVIIe siècles, il paraît néanmoins indispensable de mettre pour un temps en suspens les catégories esthétiques qui sont devenues naturelles à l’homme moderne. La constitution relativement récente de l’œuvre d’art en objet de jouissance esthétique pure, détaché de toute fonction instrumentale, a en effet contribué à déformer les analyses de l’iconoclasme, les historiens et les historiens d’art qui se sont penchés sur celui-ci étant longtemps restés prisonniers d’une définition étroite de l’œuvre d’art, d’autant plus contraignante qu’elle était inconsciente.
Jusqu’au milieu du XXe siècle, leurs études se complurent ainsi aux genres apparemment opposés de la déploration et de la plaidoirie : d’un côté, des auteurs comme J. Rey (1839), D.-A. Virac (1867), L. Niepce (1881), J.-B. Blin (1888), et plus tard encore M.-S. Briggs (1952) et L. Réau (1959), associaient la description des destructions et la condamnation de ceux qui en avaient été les auteurs ; à l’inverse, E. Despois (1868), N. Weiss (dans le Bulletin de la Société d’histoire du protestantisme français à la fin du XIXe siècle) ou P. Beuzart (1912-1913) s’attachaient à disculper les révolutionnaires ou les réformés des accusations qui pesaient sur eux.
En fait, ces deux approches contraires avaient en commun de légitimer la définition moderne de l’œuvre d’art dont elles étaient le produit : que ce soit en présentant les iconoclastes comme des barbares insensibles aux vertus du Beau, ou en cherchant à défendre les accusés (par exemple en exaltant l’apport culturel et artistique de la Réforme ou de la Révolution), les adversaires s’accordaient à juger scandaleuse la mutilation des statues, des peintures et des édifices. L’invention de l’œuvre d’art émancipée de ses usages politiques et religieux et étrangère à toute querelle d’intérêt prive ainsi l’iconoclasme de tout sens et le condamne à n’apparaître que comme un geste irrationnel dirigé contre des objets gratuits.
Didier Éribon (Le Nouvel Observateur, 12 décembre 1991)
La guerre des images
Comment la Réforme fit vaciller l’Église catholique sur le socle où elle avait établi ses symboles et sa statuaire : un essai d’Olivier Christin apporte des lumières nouvelles sur cet épisode violent de l’histoire des religions.
Puisque l’histoire de l’art aujourd’hui sait si bien explorer les arcanes de la création et de la perception des œuvres, il fallait bien qu’elle en arrive aussi à s’interroger sur les phénomènes de destruction, qu’on range communément sous le terme d’iconoclasme. Les saccages, les mutilations ont toujours été une énigme difficile à résoudre, surtout quand il s’agit d’actes collectifs où des foules se mobilisent pour lacérer les images et briser les statues. Pour comprendre ces mouvements, il faut d’abord renoncer à les juger, comme le faisaient jusqu’ici les historiens qui clamaient leur indignation devant les faits qu’ils étudiaient. C’était encore le cas dans les années 50, quand Louis Réau dénonçait le “ vandalisme ” des “ êtres inférieurs qui haïssent tout ce qui les dépasse ”. Avec de telles catégories de pensée, l’analyse ne pouvait évidemment pas aller très loin.
Le livre d’Olivier Christin sur “ l’Iconoclasme huguenot et la reconstruction catholique ”, est à l’opposé de cette manière d’écrire l’histoire. Car c’était commettre un magnifique anachronisme : la constitution des œuvres en objets esthétiques purs, détachés des usages politiques ou religieux, est tout à fait récente. Il faut donc renoncer à projeter nos propres modes de pensée sur les époques antérieures si l’on veut comprendre pourquoi l’œuvre d’art a pu être le centre de luttes acharnées et sanglantes au moment de la Réforme et de la Contre-Réforme. L’auteur est un historien de la religion qui a frotté son travail à celui des meilleurs historiens de l’art actuels, tels Enrico Castelnuovo et Salvatore Settis à Pise ou Martin Warnke à Hambourg. Mais, tout comme ces éminents spécialistes, il a su féconder sa recherche par une forte connaissance des méthodes de la sociologie, de l’anthropologie et de la science politique. Le résultat est un ouvrage magistral qui renouvelle totalement l’approche de la question.
On sait que la querelle tourne autour de l’idolâtrie et du culte des images dénoncés par les protestants. Olivier Christin s’attarde bien sûr très longuement sur les textes théoriques fondateurs du mouvement. Pour montrer surtout que la nécessité de briser les images n’y est pas toujours aussi présente qu’on a pu le croire, et surtout que l’activité iconoclaste a fait l’objet d’un intense débat chez les “ Réformateurs ”. C’est donc à l’aspect “ politique ”, si l’on ose dire, que Christin va s’attacher tout particulièrement : l’iconoclasme est l’instrument de mobilisation des différentes couches de la population qui se reconnaissent dans la religion nouvelle, et les élites urbaines y jouent souvent un très grand rôle. D’où l’idée, qui donne son titre à l’ouvrage, d’une “ révolution symbolique ” : “ Le renversement des images, écrit Olivier Christin, s’apparente à une véritable conquête du pouvoir. ” L’iconoclasme est avant tout une manière de donner une visibilité à la conquête des villes par les franges de la population qui avaient dû jusqu’alors célébrer leur culte de manière clandestine ou hors les murs. “ C’est une appropriation progressive, écrit encore Christin, de l’espace urbain. ”
Mais, évidemment, on ne peut réduire l’iconoclasme à sa fonction politique de mobilisation. Il faut aussi en déceler les motivations religieuses profondes. Elle relève, dit Christin, s’appuyant sur Max Weber, d’une sorte de “ théologie pratique ”, d’une piété en acte : c’est un geste qui accroît sur terre la gloire de Dieu, ou, au moins, essaie d’empêcher qu’Il ne soit injurié. Même si, dans la réalité, les comportements s’écartent souvent de ce modèle : la vengeance ou le pillage peuvent avoir leur mot à dire.
Mais Olivier Christin ne se contente pas d’étudier l’iconoclasme de la Réforme. Il veut aussi, et en même temps, comprendre ce qu’a été la réaction catholique. Il montre à merveille comment il s’est agi pour les prélats et les princes catholiques de contrer l’effet de la mobilisation politique en organisant de grandes cérémonies solennelles de remise en ordre, de resacralisation des images et du pouvoir qui les soutient. Là aussi, les débats sont intenses et les positions complexes et contradictoires. Mais à suivre les récits et les commentaires de Christin, on voit peu à peu se définir une théorie esthétique dans laquelle l’Église entend veiller au contenu des image, Les sujets sont prescrit, il faut exalter les sacrements, par exemple, et exclure tous les sujets annexes. Poussin va faire merveille dans ce domaine. Mais, dans le même mouvement, l’Église est conduite à rejeter tout critère de beauté et d’originalité dans l’évaluation des œuvres : seule la valeur fonctionnelle de représentation d’une scène sacrée pourra donner à une œuvre sa légitimité. Dès qu’elle cesse de remplir cette fonction, l’œuvre doit cesser d’être vénérée.
On comprend alors que le livre puisse s’achever sur l’évolution du champ artistique. Sur les cendres de l’iconoclasme vont naître des projets différenciés. Dans le monde des réformés, l’art va s’orienter vers les sujets profanes (le portrait, le paysage, les vanités…), tandis que dans le monde catholique l’art va se réorganiser selon deux systèmes opposés. D’un côté, l’univers de la commande privée, où la fantaisie du commanditaire et bientôt de l’artiste sera prédominante, C’est là que vont se concentrer la création et l’invention et que l’on verra peu à peu émerger le milieu artistique tel que nous le connaissons. De l’autre, l’univers de la commande d’Église, ancré dans le respect d’une orthodoxie sévèrement contrôlée. Ce qui conduira l’art religieux à son étiolement. Toutes ces perspectives ouvertes par Olivier Christin en disent long sur ce qu’a été l’importance de l’iconoclasme. Et aussi sur ce qu’est l’importance de son livre.
Jean-Maurice de Montremy (La Croix, 13 janvier 1992)
Un révolution symbolique
Les œuvres rescapées de l’iconoclasme révolutionnaire, recueillies symboliquement au musée des Monuments français, témoignent d’une rupture radicale. Il ne s’agit plus d’objets qu’on profane ou qu’on vénère mais d’objets détachés de leur fonction, entrés en esthétique et laïcisés. L’Angleterre connut, sous Cromwell, des ravages comparables qui contribuèrent, un bon siècle avant notre romantisme, au goût des ruines et aux mélancolies d’un “ gothique ” à jamais disparu.
Pour qui s’intéresse au phénomène, né à Constantinople avec la fameuse querelle des Images (730-843), l’ouvrage d’Olivier Christin marque une étape importante. Ici, comme en politique, les guerres de religion frappent profondément. Situé dans la longue durée, l’iconoclasme des années 1790 n’est que l’ultime soubresaut d’une violence éclatante au long des années 1560. “ Révolution symbolique ”, écrit justement l’historien : la phrase doit se comprendre au sens fort des deux mots. En s’attaquant à l’Image, les réformés s’attaquent à la fois au pouvoir et aux théologiens.
Il ne s’agit nullement de barbarie mais (si l’on peut dire) d’actes symboliques mûrement réfléchis. Tout comme seront volontaires les esthétiques de la Contre-Réforme.
Avec rigueur, mais sans nulle obscurité, Olivier Christin présente les écrits théoriques des huguenots et des catholiques. Il analyse, en divers lieux du royaume, plusieurs journées de martèlement et de destructions. Il suit aussi l’œuvre de restauration ou de ré-animation entreprise, avec de subtiles nuances, par les divers courants catholiques. Il n’oublie d’ailleurs jamais les liens qu’entretiennent les œuvres d’art avec les liturgies qui, d’un camp à l’autre, s’opposent de manière virulente.
Mieux, il montre aussi comment l’art ne sort pas indemne de ces tensions. Côté Réforme, le portrait ou l’univers personnel du paysage et de l’objet emportent l’adhésion. Côté catholique, l’incroyable vitalité du baroque ne doit pas tromper. C’est dans la sphère privée, là aussi, que l’art multiplie ses prestiges, avec le monde fastueux des collectionneurs et des mécènes, fussent-ils, ou non, hommes d’Église.
En revanche, l’art sacré proprement dit se trouve désormais encadré par les décrets du Concile de Trente : c’est un art délibérément fonctionnel qui refuse d’avance les futures prétentions d’une “ création ” artistique ou d’une idéologie de l’art pour l’art.
Claude Mazauric (Révolution, 3 janvier 1992)
Protestantisme, la révolution symbolique
Olivier Christin nous donne un vrai beau livre d’histoire : ampleur du sujet, acuité du regard, précision de l’écriture et non-conformisme ne nous laissent cependant pas ignorer que l’auteur a procédé à un vaste inventaire parmi les travaux récents et mis à jour des sources nouvelles ou de nouvelles manières d’en utiliser d’anciennes. Olivier Christin, voilà un nouveau nom d’historien français a suivre avec attention ! Cette “ révolution symbolique ”, dont il nous parle, compagne vers les années soixante du seizième siècle de la poussée huguenote puis de son refoulement catholique, figure en contrepoint des grandes transformations sociales et culturelles d’un Occident aspiré par la phase d’expansion qui suit la Renaissance. On y lit tous les phénomènes de déstabilisation idéologique et culturelle puis de réarmement moral et religieux, corrélatifs à cette période de crise profonde qui a conduit, pour la France un siècle plus tard à une mise en orthodoxie relative sous le contrôle de sa Majesté très “ absolutiste ” et “ très chrétienne ”. Quoique l’objet précis du livre ait été d’analyser “ l’iconoclasme protestant ” (première partie du livre, pages 15-175) puis “ la reconstruction catholique ” (deuxième partie, pages 175-287), le traitement ample des questions balaie avec aisance tout le champ des pratiques sociales, des représentations mentales et de l’esthétique. Et puis le thème de l’iconoclasme retrouve de nos jours une sorte d’actualité, notamment en Europe de l’Est quand on assiste au déboulonnage vengeur des statues de Lénine, à l’effacement des images du bolchevisme ou de l’antifascisme, a la destruction d’une onomastique stalinienne, produite elle-même par une volonté affirmée naguère de rompre les amarres avec ce qu’on croyait être les vestiges trop éloquents de l’ancien régime des sociétés despotiques et de classe mais qui étaient en même temps la culture des peuples. Le bicentenaire de la Révolution française avait aussi conduit nombre de bons auteurs à reprendre la fameuse question du “ vandalisme révolutionnaire ” comme forme singulière, d’ailleurs limitée, d’une entreprise, de “ révolution culturelle ” par laquelle on crut en 1792 et l’an III achever la “ régénération ” de l’homme commencée en 1789 avec la révolution politique et l’abolition de la “ féodalité ”. Cependant, on l’a constaté. si le retour aux appellations “ ci-devant ” et nombre de renonciations radicales n’ont pas conduit à ruiner les apports essentiels de la Révolution française, c’est que celle-ci ne fut pas qu’une “ révolution symbolique ”, inscrite dans la seule sphère du mental ou de la culture politico-mythique, mais qu’elle fut aussi un transfert massif de biens matériels, de droits et de pouvoirs au profit de couches sociales et de milieux qui, au-delà de symboles juges peu de temps après superfétatoires, n’entendirent pas s’en laisser déposséder ; la reconstruction directoriale, bonapartiste puis napoléonienne, à la différence de la “ reconstruction catholique ” des seizième et dix-septième siècles, n’eurent pas seulement à reconstruire des appareillages symboliques, à combattre des habitudes ou des mentalités, ni même a édifier des musées – ce qu’elles entreprirent – mais à gérer un ensemble révolutionné d’institutions, de règles de droit et de structures de contrôle social, d’équilibre de forces. Et cela fait une sacrée différence avec la longue période qui suit la crise iconoclaste des années 1650 !
La révolution symbolique du protestantisme et le protestantisme lui-même, n’auraient-ils été qu’une révolution manquée, ou partielle, ou l’aurore masquée d’un mouvement de transformation de longue durée comme le voyait Michelet ? Serait-on passé, de la Réforme à la révolution faite, à la mise en œuvre d’un “ monopole de la violence symbolique aux mains du législateur ”, comme l’écrit Olivier Christin en conclusion (p. 291 ) ? L’actualité, celle de 1944 en France par exemple, celle de 1956 en Hongrie, ce qu’on a vu au cours de la décolonisation politique (politique) ou ce qui se montre aujourd’hui dans la ci-devant URSS, conduisent à penser que ce processus s’il existe, ne va pas sans un effort de récupération – reformalisation de l’apport des protestations symboliques qui viennent de la société elle-même. Le grand mérite du livre d’Olivier Christin est d’inviter à une réflexion large et distancée dont je n’ai ici en vue que d’indiquer de possibles pistes.
Étudiant “ l’iconoclasme huguenot ”, l’auteur en montre les origines et les fondements théoriques et pratiques, élaborant, au vrai, une pragmatique de l’action sur les symboles comme manifestation d’une subjectivité religieuse ayant force de conviction identitaire. Attentif à l’événement iconoclaste lui-même, le livre de Christin en décrit les procédures concrètes dans les années 1560-1652 et au lieu où elles sont mises en œuvre (Rouen, Le Mans, Lyon etc.) : il nous donne à voir l’ampleur et les limitations mises à la destruction des images. Il montre comment cet effort suppose, contradictions, compromis, “ alliance ” même, entre le peuple et les notables (pp. 86-87) autour d’un projet, assume et en fin de compte maîtrise. Ce faisant, l’auteur replace l’iconoclasme huguenot dans son temps, et cette entreprise “ historienne ” de recontextualisation systématique lui permet de dégager une structure explicative qui nous place aux antipodes du discours “ expiatoire et pédagogique ” d’un réactionnaire comme Louis Reau par exemple, dont l’œuvre régna sur nos études au temps de notre jeunesse folle. De cette belle partie, à la fois récits minutieux et enquêtes en chemin, il ressort que les iconoclastes savaient ce qu’ils faisaient, n’étaient donc pas la figure embryonnaire du “ singe grimaçant ” dont nous parlera Hyppolite Taine à propos du paysan insurgé ou du sans-culotte. Au-delà d’ambiguïtés innombrables, ce que nous voyons, ce sont des acteurs assez lucides et qui maîtrisent fort bien leur projet (cf. pp. 137-147). L’effort méthodique qu’ils poursuivent remplit une fonction de “ recomposition de la sacralité ”(p. 174) révélant du même coup les limites d’une révolution symbolique dont la fonction sinon le but religieux sans pouvoir échapper aux “ contiguïtés ” inévitables avec la tradition des Saturnales ou des revanches sociales carnavalesques comme les analysa Bakhtine, a toujours été exclusive. En analysant l’établissement d’un possible “ iconoclasme officiel ” à Lyon singulièrement où opéra le célèbre baron des Adrets, Olivier Christin nous montre le passage du “ gaspillage joyeux ” (p. 106) à “ l’entreprise lucrative ” de démolition et à la mise en œuvre de la politique “ iconoclaste bien tempérée ” (p. 111 ) d’un Théodore de Bèze, grand ordonnateur d’un robuste calvinisme à la française.
Si l’iconoclasme huguenot fut d’abord et presque exclusivement d’ordre symbolique, la “ riposte ” (p. 175) catholique, appuyée par l’État, sa Sorbonne, ses cours et parlements mais surtout ses argousins, fut d’une rare violence. Contrairement à beaucoup d’historiens bien pensants qui minimisent aujourd’hui les massacres de réformés, cette vague pluridécennale plus que passagère de Saint-Barthélémy qui se multiplièrent principalement de 1562 à 1572 – en traita fort bien naguère Jeannine Garrisson dans un beau livre [Protestants du Midi (1559-1598), 1980] montrant que cette fureur massacreuse ne connut de faiblesse que dans le Midi où leur organisation protégea les réformés – Olivier Christin n’hésite pas à parler de “ tueries ” (p. 208) et insiste sur la complicité (p. 205) des autorités civiles et religieuses avec des groupes d’assassins (à Rouen, au Mans, à Paris... ) poussés par la passion de la vengeance qui animait des masses catholiques fanatisées, heurtées dans leurs superstitions par la vague iconoclaste antérieure. La phase sanguinaire passée, l’Église et la monarchie encouragèrent la reconquête catholique. “ Contre-réforme ” véritable, cette action favorisa la recherche d’une authentique “ recomposition ” doctrinale qui fut à la fois rénovatrice, quoique souvent bricoleuse, dans l’interprétation du dogme et la définition des articles de la foi, critique et polémique dans la controverse où excellaient les pasteurs protestants (cf. pp. 232-253), mais surtout organisationnelle dans l’esprit des premières décisions du Concile de Trente et des instructions très intelligentes du fameux cardinal Bellarmin (p. 253).
Nous le savions : la France a mis beaucoup de lenteur et suscite beaucoup d’obstacles avant de se soumettre à cette nouvelle manière post-tridentine d’être catholique que préconisait Rome avec le soutien de la Compagnie de Jésus et celui du lobby pontifical dominé par la prépondérante Espagne très catholique. Il reste cependant qu’en moins d’un siècle, ici comme ailleurs, peut-être mieux ici qu’ailleurs en raison des enjeux de pouvoir que révélait la menace de la partition confessionnelle du royaume au regard de la volonté d’ordre de la monarchie, la nouvelle orthodoxie s’imposa à l’abri des “ piéges de la vénération ” (p. 228). Elle conduisit à évacuer la nécessité de la symbolique au profit du magistère de l’Église (p. 264-265). Motu proprio, cette “ revanche liturgique et esthétique ” (titre du chapitre II, 2) favorisa l’éclosion d’une nouvelle période de l’histoire de l’art, notamment pictural (cf. p. 250-255) marquée par “ l’exaltation des sacrements ” (p. 285), une iconographie respectueuse et l’évacuation des scènes annexes où le peintre figurait les traits des donateurs. Peut-être devrons-nous à cette réaction une part de l’œuvre du Caravage, des frères Le Nain ou de Poussin : le pire ne produit heureusement pas que le pire et les voies du seigneur sont bien impénétrables !
Que veut l’iconoclasme ? Démoraliser, désinformer les adeptes de la croyance jusqu’alors dominante. “ Reconquête de la sacralité ” (p. 287), il agit sur les cadres et dans l’ordre symbolique pour révéler l’impuissance réelle de l’adversaire et instituer dans le champ de l’intersubjectif un processus de reconnaissance intime de la nécessite d’un nouvel ordre des choses. Mais à n’être que symbolique, l’iconoclasme révèle aussi sa faiblesse et exhibe alors une maladresse et une nervosité qui sont celles du néophyte. C’est pourquoi les révolutions ne peuvent être principalement des entreprises symboliques et quand elles le deviennent, c’est alors qu’elles montrent leur caducité prochaine ou leur objective immaturité. Les huguenots agirent quelquefois comme des “ révolutionnaires ” du seizième siècle : ils ne furent pourtant que des reformés porteurs d’idées et de pratiques nouvelles mais qui allaient bien au-delà de la sphère à laquelle ils limitèrent leur engagement. De là cette rage qu’ils suscitèrent et simultanément la faiblesse et l’étroitesse de leurs moyens de défense. Par contre, la contre-reforme comme les contre-révolutions ne sont jamais principalement symboliques : quelques gestes démonstratifs suffisent à annoncer la mise en place immédiate d’un contrôle social plus prosaïque qui s’appelle répression contre les hommes et institution de cadres de pouvoir renouvelés et efficaces. À cette ultime réflexion inspirée par le livre percutant d’Olivier Christin, on voit que les questions évoquées n’ont pas perdu toute forme d’actualité.
