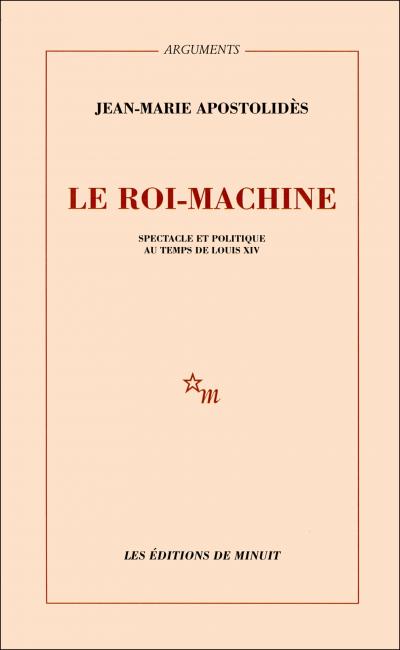
Jean-Marie Apostolidès
Le Roi-machine
Spectacle et politique au temps de Louis XIV
1981
Collection Arguments , 160 pages
ISBN : 9782707306012
20.00 €
La minorité privilégiée issue des trois ordres, bénéficiaire de l’accumulation primitive du capital, ne s’est pas pensée comme une classe pendant le règne de Louis XIV : elle constitue une nation, incarnée dans le corps du monarque. Celui-ci est l’intermédiaire obligé par lequel s’énonce tout pouvoir et tout savoir.
Les arts, contrôlés par l’État, sont mis à contribution pour rendre tangible l’imaginaire de ce corps symbolique. Metteur en scène de la représentation, roi machiniste qui fait de Versailles un décor permanent, Louis XIV engendre des courtisans qui, doués d’une sensibilité et d’un langage spéciaux, évoluent comme des satellites autour d’un astre lumineux.
Mais la politique et l’économie, en s’autonomisant, acquièrent une puissance qui n’est plus contrôlable par un seul homme. Le rapport entre privé et symbolique s’en trouve modifié et l’inorganique envahit le corps du roi. Le prince se change dès lors en roi-machine tandis que la place royale est peu à peu investie par l’administration.
‑‑‑‑‑ Table des matières ‑‑‑‑‑
Introduction
Première partie : Le roi machiniste
Chapitre I : Le corps du roi – Chapitre II : L’organisation de la culture – Chapitre III : L’homme de cour – Chapitre IV : La mythistoire – Chapitre V : Les plaisirs de l’île enchantée – Chapitre VI : L’avènement de l’Histoire
Deuxième partie : Le roi-machine
Chapitre I : La fixation de l’image – Chapitre II : Le fonctionnement spectaculaire
Conclusion
Michel Thévoz (Le Monde, 1981)
La mise en spectacle du corps du roi est l’aspect le plus manifeste de l’idéologie de la représentation qui travaille le corps social en profondeur, notamment en neutralisant les pouvoirs féodaux. Apostolidès donne à cet égard une analyse très perspicace des jeux, des spectacles, des courses et tournois organisés à Paris.
Mona Ozouf (Le Nouvel Observateur, 26 décembre 1981)
L’ordonnateur des pompes princières
Nos monarques étaient des virtuoses de l’étiquette, ce jeu sérieux et mélancolique .
(…) Un roi a donc à faire le roi. Métier de chien, sans morte-saison ni jours fériés. Deux livres en même temps racontent comment l’exerçait celui de nos rois qui a mis le plus d’esprit de système et attaché le plus de magnificence à manifester ce qui le séparait des autres hommes. Jean-Marie Apostolidès décrit au long du grand règne un cérémonial follement fastueux qui peu à peu s’ankylose. Louis Marin répertorie les objets qui convergent vers la gloire royale et coud ensemble de brillantes explications de textes et d’images. (…) Plus historique pour le premier, plus sémiologique pour le second, les deux livres ont le même propos : dire comment le roi exhibe son corps immortel dans son corps mortel et obtient en retour l’amoureuse ferveur de ses sujets.
De ce théâtre nul n’a été meilleur ordonnateur que Louis XIV, même si l’on admet avec Jean-Marie Apostolidès que, vers la fin du règne, saisi et raidi dans ses propres engrenages, il se fait machine plus que machiniste. Le vieux tournoi chevaleresque, Henri IV en gardait encore l’esprit rude quand il proposait au duc de Guise un affrontement personnel, “ malgré l’inégalité des rangs ”. En 1662, un tel défi est devenu inimaginable, le tournoi s’est mué en carrousel. Louis le Grand en imperator emmène le quadrille des Romains, il occupe le centre de la scène, la lumière est son arme, le soleil sur son bouclier, chacun de ses mouvements entraîne les peuplades improbables, Persans, Turcs, Indiens, sauvages d’Amérique, qui gravitent autour de lui. Le combat est une parade, l’issue ne fait de doute pour personne. Comme le soleil disperse les nuées, pour vaincre Louis n’a qu’à paraître.
La même logique du prodige est à l’œuvre dans les fêtes de cour : les parterres s’embrasent, les bosquets s’enguirlandent, les collations, comme chez Dame Tartine, surgissent sur les tables soudain dressées. Une armée de serviteurs invisibles – ce rêve de tout pouvoir, même domestique – a échafaudé en dansant les pyramides de nougat, les châteaux de massepain. Le roi escamote la trace du travail et du temps qu’il faut ordinairement pour produire les choses. C’est la définition même du miracle : comme Dieu, par la simple immédiateté de sa présence, le roi est capable de l’accomplir.
Dans ces conditions, que peuvent espérer les simples mortels, sinon accrocher un éclat de cette gloire surnaturelle ? Louis Marin raconte la réception à l’Académie de l’abbé Colbert, second fils du ministre. L’abbé devrait normalement faire l’éloge de l’illustre Assemblée, mais comme elle est institution du roi, c’est vers le roi que monte la louange. Quant à Racine, qui devrait faire l’éloge du récipiendaire, il aperçoit surtout en lui “ le zèle pour le Prince ”, marque de fabrique de la famille Colbert. Les deux discours sont bien d’accord : être serviteur du roi est le seul trait qui puisse désigner un homme à l’admiration publique. Un siècle plus tard, et rien ne fait mieux voir l’eau qui a coulé sous les ponts, le fabricateur attitré d’éloges, Thomas, s’excuse presque d’avoir à louer Maurice, prince de Saxe : “ Je ne puis point dissimuler qu’il était né du sang des rois. ” Ce n’est désormais plus aux rois mais aux grands hommes que va l’hommage de la patrie reconnaissante.
Le vent a-t-il tourné si vite ? Dans l’escalade d’ostentation sacrale que décrivent Apostolidès et Marin, devait déjà remuer, sourdement à l’œuvre, le sentiment que tout roi a besoin de la consécration des hommes. L’entassement des emblèmes, des couronnes et des gloires ne pouvait cacher tout à fait ce que dit aussi la fiction des deux corps du roi : qu’être à la fois homme et dieu impose au roi de montrer en lui l’homme. Il est probable, comme l’a senti Michelet, que le peuple adorait dans le roi non tant la dissemblance éclatante mais la défaillante ressemblance : “ Ce qu’il y voit d’humain, loin de s’en choquer, il le remercie. Il croit qu’il en sera plus près de lui, moins fier, moins dur. Il sait gré à Henri IV d’aimer Gabrielle... ”
D’où vient l’intérêt que notre temps porte au roman juridico-politique des deux corps du roi, hier encore curiosité marginale ? Apparemment, nous ne vivons plus sous une autorité dissemblable mais toute semblable à nous, et sans nom : les démocraties n’incarnent le pouvoir dans aucune personne singulière. Mais précisément : nous constatons avec surprise que le pouvoir n’en a pas été affaibli et qu’une coercition anonyme n’est pas forcément plus lâche. Surtout, dans le théâtre démeublé et sur la scène désertée de la représentation royale, nous avons vu réapparaître des Césars, des sauveurs suprêmes, des pères du peuple, des idoles totalitaires, de monstrueuses personnalités qui réclament leur culte, et nous ne pouvons plus désormais, pour contenir leur délire, en appeler à l’autorité supérieure d’un Dieu. Si nous cherchons à percer les secrets de cette étrange royauté classique, boitant entre nature et surnature, corps immortel et corps mortel, c’est pour mieux comprendre, peut-être conjurer, un vertigineux besoin d’incarnation qui n’a toujours pas disparu.
