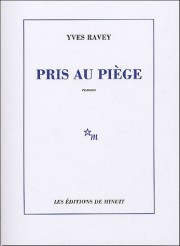
Yves Ravey
Pris au piège
2005
112 pages
ISBN : 9782707318978
10.15 €
25 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Si personne n'est convaincu par les deux hommes qui débarquent rue Jouffroy d'Abbans afin de régler ce fléau des parasites qui ont envahi les charpentes des maisons, en revanche, tous se laissent prendre au piège de leur manie madame Domenico et son désir de plaire, monsieur Domenico et sa jalousie, monsieur Carossa et la coupe de son bois ; quant au petit garçon, lui, il va devenir leur otage.
ISBN
PDF : 9782707326072
ePub : 9782707326065
Prix : 7.49 €
En savoir plus
Patrick Kéchichian, Le Monde, 7 janvier 2005
On ne peut aborder sans inquiétude et perplexité un roman d'Yves Ravey. Une inquiétude qui ne cesse d"augmenter et de se confirmer tout au long de la lecture : qu'y a-t-il à comprendre dans ces histoires au réalisme décalé, grippé, troublé et tremblant ? Quel est le sens de ces fables dont le sujet même, parfois, s"évapore - comme dans le deuxième roman, Le Bureau des illettrés Minuit, 1992) ? Où donc l’auteur veut-il en venir, ou nous emmener ? La brièveté des livres - le sixième roman d’Yves Ravey, Le Drap, Minuit, 2002), qui racontait la mort de son père, compte moins de 80 pages – ne diminue pas ce sentiment d’étrangeté. On cherche à retenir quelque phrase décisive, à souligner un passage, à corner une page qui serait enfin une sorte de clef… Impossible, et l’on poursuit la lecture comme hypnotisé.
Car cette perplexité qui pourrait nous pousser à désirer des évidences plus tangibles, des romans au sol plus solide et à l’architecture mieux dessinée, se métamorphose vite en une sorte de fascination. Cette étrangeté n’appartient donc pas à un monde inconnu, elle nous est proche, comme familière. Sommes-nous, sans nous en apercevoir, « pris au piège » ?
Soit une rue, de province ou de banlieue, une rue avec un nom : Jouffroy d’Abbans. Petites maisons, petits jardins, population de familles modestes. L’une d’elles, les Domenico ; lui, Robert, est jaloux de sa femme et supporte mal l’idée obsédante qu’elle s’en aille en vélo commettre, avec le marchand de lait ou le directeur de l’hôpital, on ne sait quelle turpitude adultère ; elle, Angèle, coquette aimant les belles robes, reste patiente et raisonnable face à la brutalité de son époux. Pas plus que les autres protagonistes, madame Domenico n’est décrite physiquement – à l’exception de ce maître nageur au début, monsieur Barre, au « bronzage uniforme », « à la différence de monsieur Domenico qui laissait voir les marques de son maillot de corps sur ses épaules ».
Lindbergh est le nom du narrateur (déjà présent dans Le Drap, avec le même patronyme) qui n’a pas douze ans et à qui madame Domenico donne de petits cours de mathématiques ou de français. Mais ce qu’elle préfère, c’est lui lire les pages de Madame Bovary ou lui apprendre le nom des fleurs… On la sent constamment au bord de la confidence, mais en revanche nageant dans le « bovarysme » : « … Lindbergh, écoute-moi, parfois, on ne sait plus ce qu’on fait, on est avec sa robe du dimanche devant la caisse, on perd la tête… » Il n’y aura guère d’aveux plus explicites.
Un jour, deux individus, qui se présentent « en qualité d’inspecteurs », cherchent à convaincre les habitants de la rue que des parasites, des « capricornes », sont en train de ronger des charpentes, qu’il est plus que temps d’agir, de traiter le bois, et qu’il sera aisé d’obtenir des prêts intéressants à la banque, pour peu que tous les propriétaires se décident. Monsieur Domenico est prêt à se laisser berner… Pendant ce temps, la jalousie de Robert à l’égard d’Angèle monte, monte… Le détail que nous venons de donner de l’intrigue et de son erratique développement, ne rend que très partiellement compte de ce roman.
Ravey ne joue pas avec nos nerfs ou notre perspicacité de lecteurs. Il ne pose pas une énigme – tout est transparent, au contraire, dans son récit. Il se contente de raconter une histoire, en lui ôtant tout caractère saillant ou spectaculaire, pour ne retenir qu’une courbe d’intensité, une violence sans ostentation, assourdie par les usages sociaux, culturel, familiaux… une certaine figure de la réalité en somme. Celle que l’on néglige habituellement. C’est à partir de la matière la plus banale, la plus terne, que l’écrivain fait venir au jour cette figure inaperçue du réel.
Dans un texte surprenant, Pudeur de la lecture, Yves Ravey donnait sa conception de la littérature. Il écrivait par exemple : « On ne fait pas l’expérience d’un livre en découvrant le reflet de sa propre expérience, c’est le livre qui vient à nous et nous traverse, qui se découvre dans notre expérience. C’est le souvenir de ce que nous fûmes qui est à l’origine du livre. » Cela ne constitue pas une « méthode » de lecture mais donne bien la direction d’un projet et d’une volonté. « Ce qui est à l’extérieur du livre, c’est le livre » affirmait aussi Ravey. C’est donc le dehors tout entier, la réalité même qui nous piége…
Jean-Maurice de Montremy, La Croix, 13 janvier 2005
C’est un village comme partout, avec son lotissement comme partout – pas trop récent, puisqu’une équipe d’exterminateurs de termites tente d’y vendre son produit. Il faut, pour cela, convaincre les habitants que toutes les charpentes ont besoin d’un traitement. Du coup, les voisins discutent de l’affaire les uns avec les autres pour prendre, ou ne pas prendre, une décision collective. D’autant que les tueurs d’éventuels termites n’inspirent pas vraiment confiance.
Vue par un enfant – le narrateur est un petit garçon -, l’affaire prend du relief, car les adultes sont, pour lui, des puissances, et la moindre perturbation des habitudes fait événement : des insectes xylophages, dont les parents parlent aussi comme de « capricornes » ; des bruits d’obscures galeries qu’il faut surprendre dans l’épaisseur des poutres ; des rumeurs sournoises sur la maison qui la première aurait abrité des termites, contaminant ainsi les autres… Voilà de quoi préoccuper le petit garçon.
Observateur, le jeune Lindbergh (car il s’appelle Lindbergh) note au passage bien d’autres choses sur tel ou tel, sans trop y penser et sans voir à mal. Le lecteur, pour sa part, déduit de ces quelques informations qu’il existe une microsociété non dépourvue de malveillance ou d’envie.
Les plus curieux, pour l’enfant, sont M. et Mme Domenico. Il est instituteur. Elle est secrétaire à l’hôpital. Elle fait travailler Lindbergh : lecture, leçons, exercices. Elle lui lit aussi quelques extraits de ses romans favoris, sentimentaux à point. Perplexe, mais intéressé, le garçon doit parfois donner son avis sur les vêtements ou le maquillage de Mme Domenico. Toujours en l’absence de son mari. Car M. Domenico est un jaloux maladif, obsessionnel – manipulateur pervers que l’on devine capable de violence.
L’air de rien, avec une finesse implacable, le lecteur se trouve pris, comme Lindbergh, dans l’affaire angoissante des termites et dans l’enchaînement oppressant des jalousies de M. Domenico. Lesquelles sont peu à peu contrepointées par les coquetteries moins naïves qu’il ne semble de la « pauvre Mme Domenico », dont tout le lotissement pense, comme l’enfant, qu’elle est bien à plaindre.
Les grandes personnes se préoccupent peu du garçon. Il est presque invisible pour elles. Mais l’enfant, lui, voit tout – sans vraiment voir. Il est bientôt « Pris au piège » des mensonges ou cachotteries des uns et des autres, y compris de ses propres parents.
Posée, claire et presque neutre – non dénuée, au second degré, d’ironie sombre – la narration, censément faite par l’enfant, laisse deviner l’anxiété puis l’effarement qu’il ne sait pas encore nommer. Et l’on admire la maîtrise d’Yves Ravey autant que l’économie de moyens employés pour donner le vertige jusque dans l’ultime surprise. Il y a quelque chose de rongé dans le lotissement banal. Comme le disent les tueurs de termites, mécontents d’être éconduits : « On reviendra, on trouvera autre chose, ne vous en faites pas, il y a toujours une maladie qui traîne, un parasite… »
Fabrice Gabriel, Les Inrockuptibles, 25 janvier 2005
Les livres d’Yves Ravey ne ressemblent vraiment à rien de connu. Cet énergumène plutôt discret s’est inventé un monde de fables floues, empruntant à la réalité la plus triviale des accents provinciaux, sans doute autobiographiques, pour les transformer en une sorte de puzzle inquiétant, jamais totalement fini. Pris au piège ne fait pas exception à cette règle qui n’en est pas une : le récit semble couper une centaine de pages, presque au hasard, dans une matière livresque interminable, répétitive et obsédante, hypnotique même à force de petites perturbations accumulées, qui font basculer le banal dans le bizarre. Il y est question d’un enfant prénommé Lindbergh (déjà présent dans Le Drap, son précédent roman), qui observe les turpitudes du couple Domenico — elle coquette, lui buveur et jaloux —, tandis que deux mystérieux inspecteurs proposent au voisinage d’intervenir pour éliminer d’improbables parasites, les « capricornes », qui auraient envahi les charpentes des toits de tout le quartier… C’est à peu près tout. Cela suffit pour créer une atmosphère absolument singulière, qui se resserre de séquence en séquence jusqu’à la plus parfaite angoisse, quand l’enfant est effectivement « pris au piège » des adultes, dont il ne sait comment se défendre. Il subit le charme de madame Domenico, qui lui fait la lecture et se rêve en nouvelle Bovary, mais redoute la folie de son mari violent, souvent poussé jusqu’au délire par sa suspicion maladive… Cette peur un peu trouble, qui peut faire penser parfois à La Nuit du chasseur, donne au roman sa drôle de force décalée : on y tremble de ne pas comprendre d’où vient ce danger que l’auteur a su, si subtilement, nous rendre familier.
Jean-Claude Lebrun, L’Humanité, jeudi 27 janvier 2005
Yves Ravey publie depuis 1989. Il a signé à ce jour sept romans et trois pièces de théâtre. Sans tapage, une œuvre prend consistance, qui mériterait la reconnaissance d’un plus vaste public. Mais l’écrivain bisontin et son scrupuleux éditeur n’ont pas choisi de calibrer le « produit » selon ce que les nouveaux marketeurs de l’édition croient savoir d’un prétendu goût moyen. S’il est question dans ses livres de nous et de notre temps, la vision n’est pas celle du décorateur simplement chargé d’ornementer de beaux mots et de jolies phrases les menus faits du quotidien commun. Ni celle, à l’apparent opposé, de l’exagéré à la prose grandiloquente, quelquefois même amphigourique, qui noie sous un déluge verbeux le ressenti du réel. Yves Ravey a en effet choisi de se tenir dans un registre de précision et de retenue. Et sa prose, du coup, porte loin. Ne cesse de dévoiler les crevasses insoupçonnées et les mirages sur lesquels des vies, tant bien que mal, se sont construites. Cela se passe toujours dans la même province de l’est de la France, à une époque où l’on pouvait repérer encore « les phares blancs des voitures allemandes qui descendaient sur la Côte d’Azur », et voir passer, au rythme des équipes, « le car des usines Peugeot ». En ce temps-là, quelque part vers le milieu des années soixante, celui qui raconte n’avait pas encore douze ans. Malgré son prénom de Lindbergh, déjà utilisé ailleurs par Yves Ravey, il ne semblait pas destiné à connaître de grands envols, dans cette rue pavillonnaire au nom – Jouffroy-d’Abbens – qui sonnait si prétentieux. Son père travaillait dans une fonderie de la zone industrielle. En quelques pages, nous voici donc en plein dans l’univers d’Yves Ravey. Un quotidien terne, un horizon industriel sans véritable échappée, et les mots mal ajustés, en l’espèce trop grands, de ceux qui se trouvent l’habiter. Comme cette Madame Domenico qui possède avec son mari la maison voisine. Du charme et des formes troublantes. Secrétaire à l’hôpital. Un jour, les parents du garçon, le père surtout, conviendront avec elle qu’elle l’aidera à faire ses devoirs de maths et qu’elle lui fera faire quelques lectures. C’est l’été, l’année scolaire tire à sa fin. Le Tour de France est déjà parti. À touches précises, Yves Ravey délimite ainsi son périmètre narratif, fait surgir, de l’imaginaire ou des souvenirs enfouis, des images et des ambiances. Le tricot de corps de Monsieur Domenico à la maison, le sciage du bois pour l’hiver, la timbale du lait cherché à la ferme, l’étape du Tour à la radio, la combinaison rose de Madame Domenico… Un jour, deux types descendent d’une fourgonnette immatriculée dans le Haut-Rhin. Toujours cette précision du détail. Ils se proposent d’inspecter les charpentes car dans la région sévit le capricorne, un parasite ravageur. Très vite, le doute s’installe sur leur honnêteté. Le récit, sur le terrain préalablement préparé, semble maintenant lancé. Sauf que l’affaire reste en suspens. Car le narrateur, qui rend régulièrement visite à Madame Domenico, trouve infiniment plus intéressant à observer. Par exemple les scènes sadomasochistes entre la jolie voisine et son mari jaloux, ou encore certains accès de langueur que celle-ci lui manifeste, quand lui-même la regarde d’un peu près, et plus encore quand elle s’en va chercher à la cave un vieux livre et qu’à chaque fois elle lui relit « la scène où l’héroïne achète des tissus à un marchand ambulant ». Sur ces pages d’un temps ancien, elle peut plaquer le souvenir de sa première rencontre avec Monsieur Domenico. Mais surtout procéder à sa sublimation, dans une manière d’inconsciente identification avec cette Emma Bovary, puisqu’il s’agit d’elle, déchirée entre le sublime de ses rêves et le sordide de leur accomplissement. Comme celle-ci, Madame Domenico a d’ailleurs pris un amant, que son mari cherche à identifier en vain. Plus apte cependant à déjouer les manœuvres des escrocs chasseurs de capricornes qu’à voir ce qui se trame pratiquement sous son nez. C’est au narrateur, un jour obligé de rester dissimulé dans le grenier de la maison — il s’y était glissé à l’insu du voisin —, que la stupéfiante réalité se trouvera, au plein sens du terme, dévoilée. Tout cela ne constitue pas, à proprement parler, une histoire. Fait cependant bien plus : inscrit le banal dans un récit laissant pressentir du sens, quand l’anecdote paraît d’abord tenir seule le devant de la rampe. L’art d’Yves Ravey tient dans cette capacité à suggérer une complexité forcément à l’œuvre, à débusquer, comme ici dans la rue pavillonnaire de la petite ville de l’Est, les désirs et les aspirations cachés qui gouvernent les vies et les font tenir plus ou moins droit. À montrer aussi le rôle qu’y tiennent les livres, ceux du passé et ceux d’aujourd’hui, qui offrent au réel sa réalité, ou du moins en organisent la représentation. La prose d’Yves Ravey, d’apparence si tranquille, ne cesse jamais de jouer et de travailler en profondeur.
Jean-Baptiste Harang, Libération, 10 février 2005
Le septième roman d'Yves Ravey, Pris au piège, n'est pas aussi court qu'il paraît puisque, pour en tirer pleine satisfaction, il faut absolument le lire deux fois (au dam de l'éditeur, ces deux lectures peuvent se faire à l'aide du même exemplaire). On découvrira ainsi deux romans différents. Le premier raconte une histoire que l'on situe, pour connaître les habitudes de l'auteur, dans un quartier modeste de la périphérie de Besançon, rue Jouffroy-d'Abbans, à une époque où des Peugeot 202 circulaient encore mais étaient déjà démodées. Un jeune garçon dont on ne connaît pas l'âge, mais qu'on devine n'avoir guère passé les dix ans au regard des problèmes de géométrie de ses devoirs du soir, qui répond si on l'apostrophe au prénom de Lindbergh et dont le père se nomme Florian Carossa, est le narrateur du livre. On précise ces noms afin que les lecteurs du Drap, le roman précédent de Ravey, les reconnaissent, Lindbergh adulte en était déjà le récitant et y disait en termes poignants de simplicité la mort de son père. On retrouve donc ces deux-là et quelques autres deux ou trois décennies plus tôt, dépouillés de la dimension dramatique de l'agonie, mâtinée de l'espièglerie de l'enfance et de la détermination de la force de l'âge. L'intrigue de cette première lecture se construit autour de l'arrivée dans le quartier de deux personnes se présentant rue Jouffroy-d'Abbans comme des inspecteurs sanitaires qui vont convaincre, avec des moyens fort persuasifs, les riverains que les charpentes de leurs maisons sont entièrement dévorées par des capricornes et qu'il faut les traiter au xylophène dans les plus brefs délais et à grands frais. Ce sont des escrocs et l'enjeu de l'histoire est de savoir qui se fera ou non prendre à ce piège qui ne donne pas au livre son titre. Face à la maison des Carossa vivent les Domenico qui font figure de bourgeois dans le quartier, lui est instituteur, mais il a débuté comme commis voyageur, représentant placier, vendeur de plein air, elle est secrétaire du directeur de l'hôpital. Les Domenico logent monsieur Barre, maître nageur et pas pour longtemps car Domenico n'apprécie pas qu'il exhibe ses pectoraux bronzés sous les yeux de sa femme Angèle, il le congédiera et le fera même renvoyer de son emploi. Robert Domenico est d'une jalousie maladive, violente et alcoolisée. De l'autre côté de la haie, monsieur Barclay tond sa pelouse pendant les heures que son travail de chef d'agence à la Caisse d'épargne ne lui prend pas. Le fromager, Rêvemoy, habite en face, mais Domenico est fâché et madame Domenico doit faire une heure de bicyclette pour aller chercher le lait à la ferme Rysacher au risque de faire des rencontres que Robert Domenico ne supporte pas. Dans la rue, le scieur de bois Tribonnet a dix stères à couper avant la nuit (c'est lui la 202) et le bruit qu'il fait est propice à couvrir de plus vilains vacarmes.
Voilà, une belle tranche de réalisme d'après-guerre, vive et prenante sous la plume d'un auteur impeccable. Au mitan du livre, des circonstances plausibles (il s'agit de rapporter un échantillon vivant de capricorne là où on l'a pris) concourent à enfermer le jeune Lindbergh dans le grenier des Domenico (d'où le titre, Pris au piège) où, jusqu'à la fin, il verra ce qui ne doit pas être vu. Les trois pages pénultièmes claquent comme un coup de théâtre que la dernière vient apaiser.
Reprendre maintenant la lecture au début (on peut laisser reposer un jour ou deux, voire une bonne semaine, ces trésors-là portent ferment). C'est un autre livre et vous êtes un autre homme : vous savez. Vous savez ce qu'on ne dira pas, ce qui ne devait pas être vu et le coup de théâtre en coda. Vous savez que le scénario des inspecteurs n'est qu'un leurre, que l'intrigue est ailleurs et bien plus intrigante, des phrases qui s'insinuaient à l'aveugle à la première lecture, tel le capricorne qui grignote sa solive en salivant, prennent alors toute leur saveur, on comprend mieux pourquoi la belle Angèle lit à Lindbergh un livre qui n'aurait jamais dû quitter la cave, «une histoire qui se passe dans un village, la femme d'un notaire en est le personnage principal», les dires de la grand-mère, «Oh, je sais, madame Domenico est élégante, c'est la plus belle femme du quartier, certains pensent même que sa beauté est connue au-delà de la route nationale». On entend différemment les bris de vaisselle sur le carrelage (c'était le service de Lunéville), et «madame Domenico qui ne se plaignait jamais et ma mère qui disait : Elle sait pourquoi elle ne dit rien». Vous aussi maintenant vous savez pourquoi. Angèle dit à l'enfant : «Mon mari ? Mon pauvre Lindbergh, il est fou. Le directeur de l'hôpital a dit neurasthénique. Un jour ou l'autre il se pendra». Mais on a déjà lu le livre, on sait bien qu'il ne se pendra pas, qu'il n'en aura jamais le courage, un coup de théâtre de ce calibre ne s'annonce pas : il vous oblige. Il vous récompense par cette seconde lecture en toute complicité.
Du même auteur
- Bureau des illettrés, 1992
- Le Cours classique, 1995
- Alerte, 1996
- Moteur, 1996
- Monparnasse reçoit, 1997
- La Concession Pilgrim, 1999
- Le Drap, 2003
- Dieu est un steward de bonne composition, 2005
- Pris au piège, 2005
- L'Épave, 2006
- Bambi Bar, 2008
- Cutter, 2009
- Enlèvement avec rançon, 2010
- Un notaire peu ordinaire, 2013
- La Fille de mon meilleur ami, 2014
- Sans état d'âme, 2015
- Trois jours chez ma tante, 2017
- Pas dupe, 2019
- Adultère, 2021
- Taormine, 2022
Poche « Double »
- Enlèvement avec rançon, 2013
- Un notaire peu ordinaire, 2014
- La Fille de mon meilleur ami, 2015
- Trois jours chez ma tante, 2019
- Pas dupe, 2021
- Le Drap, 2022
- Adultère, 2023
- Taormine, 2024
Livres numériques
- Alerte
- Bambi Bar
- Bureau des illettrés
- Cutter
- Dieu est un steward de bonne composition
- Enlèvement avec rançon
- L'Épave
- La Concession Pilgrim
- Le Cours classique
- Monparnasse reçoit
- Moteur
- Pris au piège
- Un notaire peu ordinaire
- La Fille de mon meilleur ami
- Sans état d'âme
- Pas dupe
- Trois jours chez ma tante
- Adultère
- Pas dupe
- Le Drap
- Taormine
- Adultère
- Taormine
