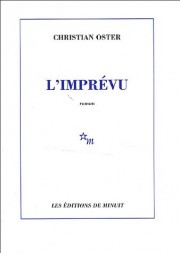
Christian Oster
L'Imprévu
2005
256 p.
ISBN : 9782707318985
16.75 €
45 exemplaires numérotés sur Vergé des papeteries de Vizille
Nous roulions vers l'île où Philippe fêtait son cinquantième anniversaire quand Laure se mit à éternuer. C'était son premier rhume. C'était la première fois, en outre, quand nous eûmes pris une chambre d'hôtel, qu'elle me priait de la laisser seule. Puis, le lendemain, de poursuivre le voyage sans elle. Sans voiture, également. Toutes choses que je n'eusse jamais imaginées mais auxquelles je me pliai, le pouce bientôt levé au bord de la nationale.
ISBN
PDF : 9782707331755
ePub : 9782707331748
Prix : 11.99 €
En savoir plus
Nathalie Crom, La Croix, jeudi 3 mars 2005
Les histoires de Christian Oster sont des histoires simples - du moins si l'on entend par là des histoires qui, résumées, tiennent en quelques mots. Dans le cas de L'Imprévu, un tel résumé donnerait quelque chose comme ça : le narrateur et sa compagne Laure sont partis en voiture, dans le but de passer quelques jours en Bretagne, sur un île du golfe du Morbihan où vit un ami qui fête son anniversaire ; en cours de route, Laure, enrhumée, décide de renoncer, le narrateur continue seul son chemin, fait quelques rencontres, arrive sur l’île le lendemain. Voilà, ce serait à peu près cela, et pourtant, L’Imprévu, c’est tout autre chose. Peut-être une sorte d’odyssée minuscule, interrompue en cours de route, et sans retour vers le point de départ. Une mise en mouvement, un authentique déplacement, qui n’est pas que géographique. Car au-delà des faits, il convient bien entendu de prendre en compte le regard de Christian Oster sur ses personnages, les mots qu’il emploie pour dire ce qu’il voit, le rythme changeant de sa phrase qui respire d’un même souffle que celui de son narrateur. Lequel, enrhumé perpétuel vivant avec une femme qui ne connaît pas ce désagrément de santé, a d’emblée l’intuition que le refroidissement soudain dont elle souffre, aux premières pages du roman, lorsqu’ils roulent ensemble vers la mer, est un très mauvais présage. Laure est de mauvaise humeur, lointaine, distante, et dès avant qu’elle s’alite à l’hôtel et lui demande de continuer seul la route, flotte déjà dans l’air un incontestable et tenace parfum de rupture.
La suite de l’histoire, une série de rencontres, traitées par Oster sur le mode léger et drolatique qu’on lui connaît, semble guidée par le hasard, l’imprévu – « si l’on veut bien appeler hasard l’orientation que prennent nos vies quand elles nous échappent », note le narrateur, toujours en route vers la mer, et ce presque malgré lui, son désir avoué étant plutôt de revenir vers Laure. Encore que ce ne soit pas si simple, bien sûr, et la complexité des sentiments de notre homme, face au constat de cet amour qui s’enfuit, l’écrivain s’entend magistralement à en rendre compte, auscultant en quelque sorte son âme au travers de ses faits et gestes minutieusement observés – ce qui, littérairement parlant, s’appelle du grand art.
Patrick Kéchichian, Le Monde, 1er avril 2005
Plus que dans une intrigue, les héros des romans de Christian Oster sont inscrits dans une trajectoire. Ils vont d’un point à un autre point, c’est tout, et dans l’intervalle le roman a lieu. L’histoire reste hors champ. On peut l’imaginer, ou s’en désintéresser. En revanche, ce court segment qui va amener le personnage à rejoindre le terme que l’auteur lui a fixé est si plein d’événements microscopiques, si riche de réactions, de pensées et de sentiments liés à ces événements qu’il ne faut pas trop d’un roman de taille raisonnable pour les détailler.
Christian Oster est passé maître dans l’art d’organiser l’aléatoire. L’Imprévu est pour lui une sorte de divinité dont il aime chanter les louanges, tant elle lui ouvre d’univers, d’espaces, de possibles. Il sait mieux que personne fondre et enchaîner les éléments. Ainsi, ses romans se composent de liens et de nœuds savamment orchestrés. Puis, il regarde l’effet produit, qui peut être drôle, cocasse, incongru, tragique. Tout cela à égalité.
Dans L’Imprévu, la liste de ces éléments, qui vont souvent par deux, vaut résumé : un rhume qu’un homme repasse à sa compagne, Laure ; un hôtel de province qui va devenir le lieu de leur rupture ; un téléphone mobile, puis un second ; deux anniversaires, dont l’un chez des inconnus où le narrateur se retrouve après avoir quitté l’hôtel en auto-stop ; une autre femme, Florence, et cette nuit imprévue qu’il passe dans son lit ; une chute et une jambe douloureuse ; une île bretonne enfin, où le second anniversaire a eu lieu la veille… Puis, le roman se termine à l’instant où le héros est invité à décliner son identité. « Ah, ah, dis-je, c’est toute une histoire. Pas drôle du tout. Je ne pourrais même pas la raconter, si je voulais. »
Creux et méandres
Dans les creux et les méandres de cette histoire qui ne peut se raconter, Oster circule avec une impressionnante aisance. En fait, nous sommes dans une variante moderne et hypertrophiée du roman psychologique. « J’ouvris le lit. La nuit s’installait, pas moi encore. Je me préparais. Je ne savais pas à quoi. A tout. A l’exagération. A l’excès. Au non-sens. Au mystère du lendemain. Le mieux serait de dormir me dis-je. » Tout se construit et progresse, comme le montre ce paragraphe, à l’intérieur de l’esprit du narrateur. Les circonstances et les personnages sont, à chaque instant, des questions que le monde lui pose et auxquelles il tente d’apporter des réponses. Sans jamais y parvenir. D’où ce sentiment de solitude et de détresse que l’humour de Christian Oster ne fait que souligner davantage. Et il faut prendre à la lettre cette affirmation que l’auteur met dans la bouche de son héros : « J’avance dans un travail d’effacement, me disais-je. »
Jean-Claude Lebrun, L’Humanité, jeudi 19 mai 2005
Dans son onzième roman, Christian Oster continue d’arpenter les territoires qu’il affectionne : ceux des malentendus et des petits ébranlements laissant deviner des failles de la sphère intime. A ceux qui font la fine bouche et revendiquent des sujets d’une plus considérable ambition sociale, l’on rétorquera qu’il n’est guère que la littérature pour permettre de telles représentations des désastres existentiels qui occupent l’humain. Ainsi qu’à l’ordinaire, pourrait-on dire – sauf que rien n’est ici ordinaire -, voici donc l’une de ces figures empêtrées avec soi-même, obligées par quelque force intérieure de se lancer dans des aventures déconcertantes qui tournent au burlesque. Incapable de jamais réagir « normalement », s’inventant les obstacles les plus inattendus pour ne pas emprunter la simple ligne droite. Un personnage comique du temps du muet, qui aurait seulement substitué aux maladresses du corps les embrouilles en cascade de la parole, dans de longs monologues intérieurs et des bribes de dialogues.
Le narrateur et Laure, qui depuis un an vivent ensemble, ont pris la route pour Quiberon, d’où ils doivent embarquer pour une petite île. Un ami les y attend, pour fêter son cinquantième anniversaire. Avant Laure, il y avait eu Agnès, d’autres encore. Toutes, au contact du narrateur, s’enrhumèrent, tombèrent malades. Guéries, elles le quittèrent toutes. Ainsi se présente notre homme au début du livre. Dans la voiture, alors qu’ils s’éloignent de Paris, Laure commence d’éternuer. L’éternelle histoire est donc en passe de se reproduire. Tout semble maintenant vouloir se dérégler. Revenir en somme à la normale et permettre au narrateur de s’illustrer à nouveau tel qu’en lui-même. L’on est entré en plein dans l’univers dégingandé de Christian Oster. Car les événements dès lors s’enchaînent avec l’implacable obstination d’un mouvement d’horlogerie. L’état de Laure empire. Il faut quitter l’autoroute, s’arrêter dans un hôtel, faire venir un médecin. Au matin, elle demande au narrateur de continuer seul. Les autres rompaient quand elles guérissaient, celle-ci le lâche en tombant malade. Depuis quelque temps, cela n’allait plus très fort entre eux. Le début de rhume a extériorisé la crise.
Christian Oster ne pratique pas la psychologie des profondeurs. Il opte plutôt pour une approche comportementaliste, qui crée en même temps du burlesque et de l’absurde. Aux attitudes du narrateur, à ses postures contre toute logique se mesure l’ampleur de ses dérives intérieures. Il laisse Laure à l’hôtel et lui abandonne la voiture. Se retrouve à faire du stop, est invité à l’anniversaire d’un automobiliste de passage. Par politesse, accepte. Pour ne pas froisser, s’installe dans une des chambres de la maison. Son rhume chronique prend une forme soudain plus aiguë. Il va devoir rester un peu. A force de ne pas vouloir gêner, il est en train de devenir franchement importun. Son monologue intérieur, à mesure que se succèdent les épisodes incongrus, se présente comme un sommet de drôlerie imperturbable et grinçante. S’il comprend la situation, il ne croit s’en sortir qu’en s’y enfonçant davantage. Ce qui correspond à sa complexion et explique ses fréquents changements de partenaires. Cet homme semble posséder dans tous ses raffinements l’art de l’enlisement. Parmi les invités du soir, chez ses hôtes d’occasion, une jeune femme élancée l’entreprend. Dans un brouillard fiévreux et alcoolique, il l’entend lui proposer de le conduire le lendemain sur l’île au large de Quiberon, où elle-même doit se rendre. Il l’accompagne chez elle, la rejoint dans son lit, par politesse ou désir inavoué. Toujours guidé par une autre volonté, à laquelle il ne cesse d’opposer une vaine résistance. Il passe pour un original bougon, alors même qu’il se voudrait résolu réfractaire. Ses grandes révoltes se perdent dans des combats minuscules. L’achat d’un téléphone mobile, en cours de route, devient avec la conductrice le sujet d’une nouvelle et irrésistible guerre picrocholine.
Au beau milieu du roman, le narrateur avait lâché cette phrase : « Je n’avais jamais envisagé l’ennui comme une distraction. » Ce comique impassible délivrait du même coup le sens de la succession des malentendus : une technique du temps pour faire front à la mélancolie. Quand Don Juan, pour les mêmes raisons, pratique la séduction à la chaîne, lui choisit de se laisser porter et de vivre de futiles aventures. Car il y a, dans ce roman à l’écriture subtilement déséquilibrée, qui sans cesse pratique l’art du retournement, la profondeur d’une vision. Sur le vide au cœur du trop-plein. Sur l’insignifiance au cœur de la multiplication des signes. Et sur le malaise, avide de divertissement, qui en résulte.
Jean-Baptiste Harang, Libération, jeudi 16 juin 2005
Une des rares choses que l’on sache du narrateur, c’est qu’il ne s’appelle pas Serge. Et encore, il aura fallu qu’une situation imprévue le force à se nommer. Va pour Serge. Et encore, on ne s’y attendait pas lorsque, à la page 78, sur sollicitation comme on dit dans les procès-verbaux, il lâche ce prénom d’emprunt qui lui va comme le sien qu’on a bien failli connaître si le livre avait duré une ou deux lignes de plus, puisqu’à la dernière phrase, une femme, médecin à l’île de Braz, lui dit : « Je voudrais savoir comment vous vous appelez », suivent six pages de blanc et la quatrième de couverture. Le lecteur n’est pas déçu, il vient de lire une histoire désabusée et prenante qui finit là comme elle avait commencé après que le titre l’avait prévenu, L’Imprévu, que tout pouvait arriver mais qu’il ne fallait s’attendre à rien, confirmé à la page 52 par l’expression « sauf aux imprévus », à propos d’un autre docteur, mais c’est une autre histoire. Sauf qu’elle, la doctoresse de l’île de Braz, elle ne pouvait pas savoir que notre homme ne s’appelait pas Serge.
D’ailleurs notre Serge ne s’appesantit guère sur les noms propres, ni le sien, ni celui de Laure, son amour enrhumé, ni Florence, à part les Traversière et les Neufincq, et Philippe, à la fin qu’il faudra bien appeler Fabre pour demander son chemin, et encore. C’est surtout lui, le soi-disant Serge, qui est enrhumé, et sa triste manie de refiler son rhume aux femmes qui l’aiment, aux femmes qu’il aime, et, puisqu’on a cité la dernière phrase au risque de dévoiler la fin, voyons les premières qui, au fond, disent tout le livre, et même toute la vie du faux Serge : « Les femmes, à mon contact, tombent malades. Elles s’enrhument. Elles éternuent. Il arrive aussi que leur gorge soit prise. Pour elles, c’est la première fois. Leur bonne santé me précède. C’est ma faute. Le rhume ne me quitte pas. A force, elles l’attrapent. Une fois guéries, ce sont elles qui me quittent. Je reste avec mon rhume à moi. Ça occupe.(…)Le gros rhume noie bien le chagrin. Il le dilue. Laure était avec moi lorsque, pour la première fois de sa vie, elle éternua. » Donc, cette fois c’est Laure. Ils vivent ensemble depuis plus d’un an, partent pour la troisième fois de leur histoire en voyage automobile (comme pour le nom des gens, les modèles de voitures ne sont pas nommés, ce qui, pour un lecteur fidèle de Christian Oster, est un peu frustrant, mais bon), en voyage, donc, pour une île bretonne où ils prévoient de fêter le cinquantième anniversaire de Philippe. C’est très imprudent de prévoir quoi que ce soit dans un livre intitulé L’Imprévu.
Et tout à trac Laure éternue. Le lecteur qui, lui, a lu le début, sait qu’un amour est en danger. Ils s’arrêtent dans un hôtel, Laure veut rester seule, chambre à part, garder la voiture et envoyer le supposé Serge la représenter à l’anniversaire du demi-centenaire. Le voilà sans fiancée, sans auto, sans téléphone, avec un cadeau d’anniversaire et des cartouches de mouchoirs en papier au fond du sac, à lever le pouce dans une zone industrielle en route pour une île à trois cents kilomètres de là. Serge n’a guère plus d’emprise sur son destin qu’un bouchon au fil de l’eau et on voudrait vous y voir à flotter comme liège dans le flux glacial de la vie avec un rhume pareil. Bon, l’imprévu prend parfois des airs de bonne coïncidence, le Gilles qui le prend en stop fête justement son anniversaire ce soir, le trente-cinquième, ce n’est pas exactement ce qu’il avait prévu mais reconnaissez que c’est déjà ça. Serge (c’est seulement maintenant qu’il s’appelle Serge), avec ce prénom d’un autre qui sème un peu de confusion dans sa tête, s’incruste un peu, pas trop, surtout qu’il a un cadeau de disponible (on ne sait pas quoi mais des indices sérieux rendent plausibles l’hypothèse d’un grille-pain, vous verrez), il boit un peu, se prend les pieds dans le tapis, boite beaucoup et se raccroche à l’épaule de Florence qui, par chance, part le lendemain pour l’île de Braz. Ils vont acheter un portable et une canne en T, sciée sur mesure par le pharmacien du Plessis-Saint-Georges. Vous ne voudriez tout de même pas qu’on vous raconte la suite ?
Page 119 : « Je m’ennuyais. C’était inespéré. Je n’avais jamais imaginé l’ennui comme une distraction. » Voilà le véritable imprévu et le vrai talent d’Oster, nous dire avec force détails et décomposition de mouvements (voire de postures immobiles) l’irresponsabilité de vivre. A la fin, il n’arrive presque rien. C’était à prévoir.
Du même auteur
- Volley-ball, 1989
- L’Aventure, 1993
- Le Pont d’Arcueil, 1994
- Paul au téléphone, 1996
- Le Pique-nique, 1997
- Loin d'Odile, 1998
- Mon grand appartement, 1999
- Une femme de ménage, 2001
- Dans le train, 2002
- Les Rendez-vous, 2003
- L'Imprévu, 2005
- Sur la dune, 2007
- Trois hommes seuls, 2008
- Dans la cathédrale, 2010
Poche « Double »
Livres numériques
- Dans la cathédrale
- Dans le train
- L'Imprévu
- Le Pique-nique
- Les Rendez-vous
- Mon grand appartement
- Paul au téléphone
- Sur la dune
- Trois hommes seuls
- Une femme de ménage
